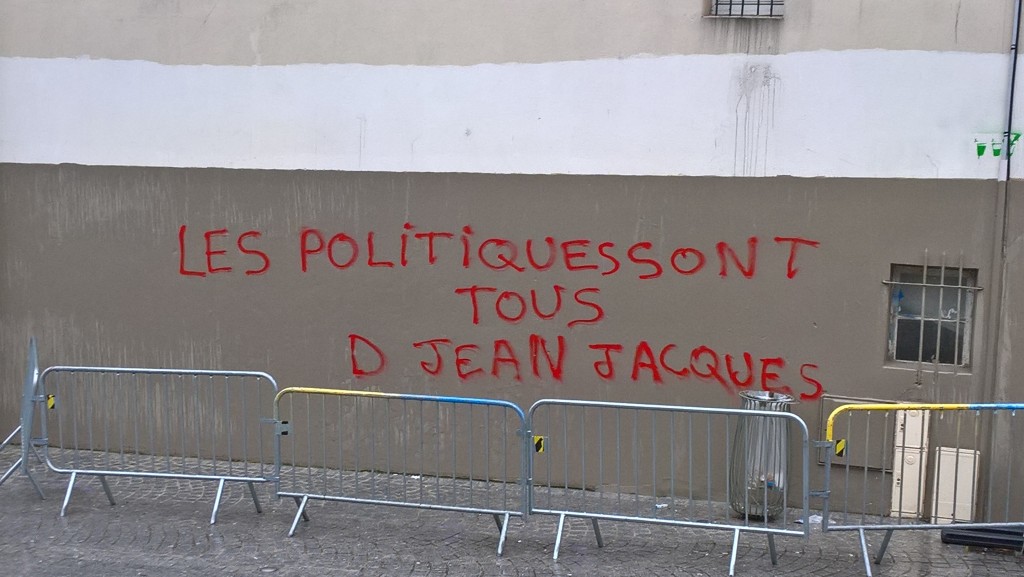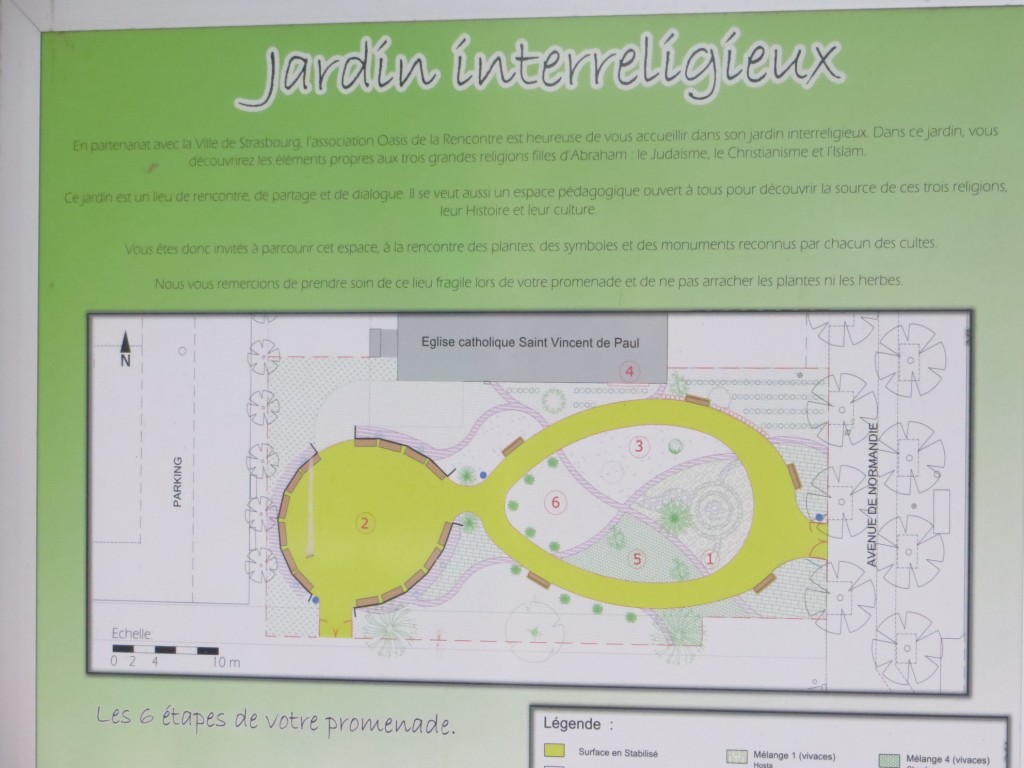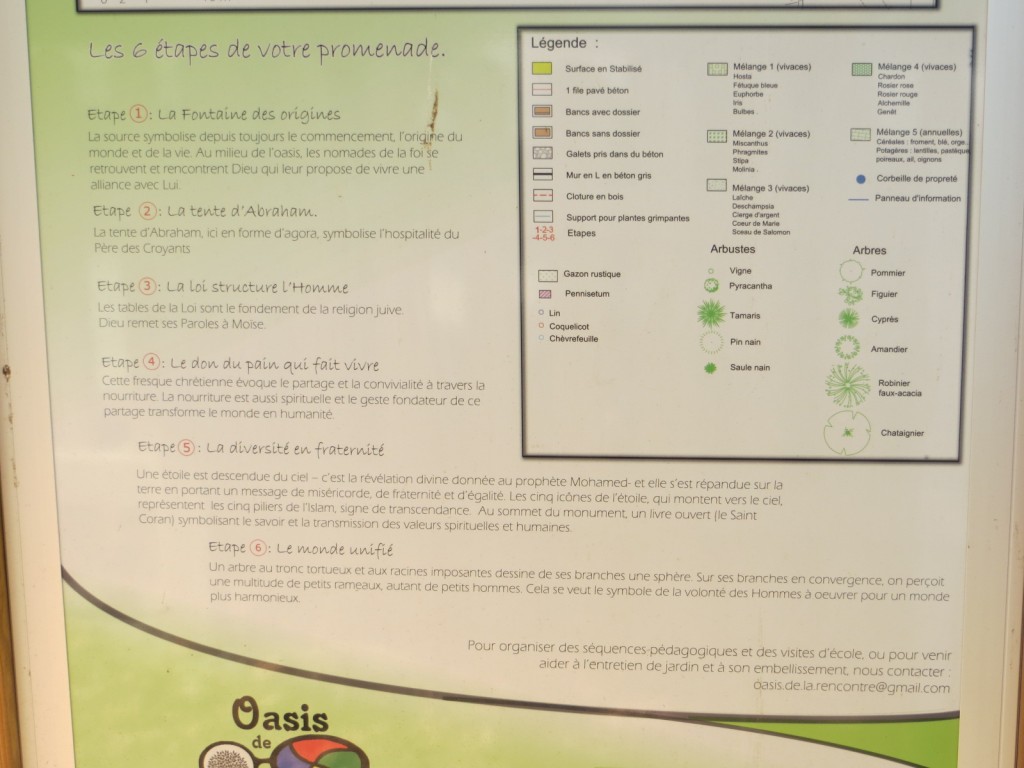Dania Tchalik poursuit ici son analyse, engagée en 2012 et 20131, des mesures technocratiques qui détruisent délibérément l’idée même d’enseignement dans le domaine de la musique. Il en révèle, sous les oripeaux « pédagogues » et bienpensants, le double langage, la logique marchande, la politique méprisante et asservissante. Et c’est toujours avec humour que sa plume acérée traque la novlangue qui remplace Bach, Beethoven, Debussy et autres valeurs patrimoniales obsolètes par des parcours loisir et des projets transversaux ayant pour vertus principales de ne pas traumatiser les publics et surtout de redéployer les ressources – ce qui est aussi l’occasion de mettre toute une profession (trop élitiste) au pas.
« Les enseignants sont là au service des enfants comme la caissière est là au service des clients», Paul Raoult2
« La guerre contre la démagogie est la plus dure de toutes les guerres », Charles Péguy3
Le constat est sans appel : dans le monde musical comme ailleurs, la pédagogie n’a pas toujours bonne presse. Si les étudiants continuent à s’inscrire dans les départements dédiés des CNSM et autres Cefedem tout en sacrifiant deux précieuses années d’exercice musical intense, c’est que nécessité fait loi : avec la disparition des CA et DE externes, il s’agit du passage quasi obligé pour prétendre accéder (un jour…) à un emploi stable de professeur.
De la (vraie) pédagogie… …et des « pédagogues »
Que les professeurs désavouent eux mêmes la pédagogie en étonnera plus d’un. Mais avant de nous en expliquer, rappelons ce que le sens commun et le corpus philosophique4 désignent par pédagogie et par son corollaire, l’évaluation. Un bon pédagogue ne se contente pas de connaître à fond sa discipline : il se doit également d’ordonner et de reformuler ces connaissances en partant du savoir élémentaire, celui qui se suffit à lui-même tout en rendant possible sa propre extension (c’est pourquoi le législateur a veillé à intégrer cette tâche « invisible » dans son temps de travail). Il envisage ainsi l’élève comme celui qui ne sait pas encore pour l’amener à terme à en savoir autant que lui ; ce faisant, il l’institue en tant que citoyen éclairé, prêt à se constituer comme membre à part entière de la chose publique. Si ce processus libérateur se situe à l’exact opposé d’une relation de pouvoir (comme d’une prestation de services), il ne va pas sans contrainte : celui qui est appelé à s’élever se décentrera au préalable de ses distractions et de penchants dictés par l’environnement social (on ne peut aimer ce qu’on ne connaît pas encore) et exercera patiemment ses gestes, sa mémoire et ses facultés critiques – tout musicien sait de quoi il en retourne. Et au bout de ce chemin exigeant, le maître pourra à bon droit faire taire le reproche communément fait à l’école par la sociologie critique, celui de reproduire les inégalités5.
Quant à l’évaluation, terme politiquement correct ayant tendance à remplacer celui de contrôle des connaissances, il ne s’agit que de s’assurer dans ce contexte que le programme étudié durant une période de référence (le trimestre, l’année…) a bien été compris.
Ces principes humanistes sont bafoués depuis plus de trente ans par des experts qui ne se disent pédagogues que pour mieux servir le pouvoir. Selon les sciences de l’éducation « le savoir ne se transmet pas » et doit faire l’objet d’une « construction personnelle » de la part d’un « apprenant »6 sommé de le réinventer ex nihilo tel un chercheur confirmé. Au nom de Bourdieu, la pédagogie ne cesse donc de promouvoir le poids de l’implicite et de l’idéologie du don (pourtant largement dénoncés par ce sociologue) en jetant l’opprobre sur l’académisme laborieux de la discipline scolaire7 : cruel paradoxe et bel exploit ! Ainsi, en musique, on trouvera parfaitement raisonnable de négliger les savoirs élémentaires et leur ordonnancement progressif en faisant par exemple pratiquer la composition (ou l’improvisation) libre à un débutant (ou à un étudiant de Cefedem, voire de pôle supérieur) manifestement incapable d’entendre les principaux intervalles, alors que par ailleurs, le temps alloué aux études musicales est loin d’être extensible.
Plus encore, la déconstruction n’épargne pas le savoir lui-même : puisque le monde change, l’enseignement « ne repose plus uniquement sur une grammaire préalable » et « n’admet plus de norme »… tout en « s’inspir[ant] de la création d’aujourd’hui » 8 (sans doute la suppose-t-on dépourvue de lois propres…). Cette vulgate progressiste se décline en deux versants : le premier, dur et idéologique, est issu de l’État Culturel9 forgé par Malraux. Il n’en finit pas de dénoncer la référence persistante au système tonal dans l’imaginaire collectif : en plus de déformer l’oreille, elle émane d’un passé à jamais coupable de compromission dont il faut faire table rase. Par trop sérieux, il tend cependant à se renier lui-même au profit d’un second courant, un post-modernisme cool qui reprend sur un mode cette fois relativiste le nihilisme, c’est-à-dire l’essentiel, de son prédécesseur. La ruine des idéologies (et de l’État Culturel) aidant, il ne s’agit plus de rééduquer les élèves et le public à coup de création de l’avant-garde subventionnée, et pour cause : il est tellement plus tendance de ne plus l’instruire tout court… Former l’oreille ? Allons donc : cela ennuie les élèves, leurs parents, jusqu’au ministre lui-même ! « La culture se conçoit alors non plus pour s’élever par le rapport personnel à l’œuvre » mais comme « l’exercice de ses droits culturels »10, autrement dit une simple reproduction des données sociales. Pour assurer le vivre-ensemble, remplaçons Bach, Beethoven, Debussy… mais aussi les chefs d’œuvre du jazz, par un parcours loisir11 ou (plus pudiquement) personnalisé composé de force créativités et musiques actuelles. Après tout, ce répertoire patrimonial, dont la prééminence est fort heureusement contredite par la demande des publics, relève d’un « modèle obsolète hérité d’un autre temps ». Sans compter qu’il faut prendre garde à ne pas infliger une violence symbolique à l’apprenant et brimer sa culture : son destin est, bien malgré lui et néanmoins du berceau jusqu’à la tombe, celui d’un amateur autonome et responsable.
La critique de « l’élitisme », ses non-dits et ses angles morts
C’est donc en toute logique qu’on s’attaque en priorité à la partie la plus visible de l’édifice : les examens et les concours, qu’on prend bien soin d’amalgamer au passage. Synonymes de compétition effrénée, voire d’un dopage organisé, ils constituent les instruments de tri au service d’un système dit élitiste « où seuls restent les meilleurs »12. Dans le même temps, nos formateurs qui s’indignent chaque fois qu’ils entendent le mot « sélection » (il y en a toujours trop, y compris au collège unique où le passage dans la classe supérieure est désormais de droit) et qui, comme un seul homme, portent au pinacle le modèle finlandais (où l’on sélectionne pourtant dès le lycée) n’ignorent pas – et pour cause – que, dorénavant, ces pratiques « archaïques » « ne sont pas représentatives de l’enseignement spécialisé dans son ensemble »13. Mais alors, beaucoup de bruit pour rien ?
Face à ce double discours, rien de tel que de rappeler les faits. Effectivement, seule la poignée de grands conservatoires (situés pour la plupart en région parisienne) où se concentre l’essentiel des élèves se préparant à l’enseignement supérieur pourrait un jour être concernée par cette description apocalyptique rappelant les pires heures de la formation sportive de l’ex-RDA. Tous les autres ont déjà plus ou moins intégré la demande de la tutelle politique : la réforme des cycles et la place croissante dévolue au contrôle continu ont depuis longtemps réduit la place des examens de fin d’année. Dans certains établissements, on évite autant que possible le recours aux jurys extérieurs ; dans d’autres, les épreuves « maison » ne constituent même plus l’ultime recours afin de convaincre un élève peu assidu de se mettre au travail ; ailleurs, « il n’y a simplement plus d’évaluation »14, passée par pertes et profits au bénéfice de la garderie des projets transversaux… A noter toutefois que ce changement bien tempéré15 s’est déroulé durant plus d’un quart de siècle dans un certain consensus. Les grands conservatoires ont été plutôt épargnés par les réformes tout en ayant largement bénéficié de la faillite programmée de leurs concurrents de taille plus modeste ; quant à ces derniers, ils ont vu leur corps professoral largement renouvelé par de nouveaux publics issus des Cefedem16 et ont parallèlement vu fondre leurs effectifs de grands élèves aptes à suivre un parcours professionnel. La réforme pédagogique a donc délibérément favorisé un élitisme d’autant plus pernicieux qu’il est implicite. Conformément aux principes du libéralisme économique, cette concentration n’a fait que renforcer les inégalités d’un système qui, à l’évidence, fonctionne désormais à plusieurs vitesses, les finalités des différentes catégories de conservatoires (CRR, CRD, CRC/CRI) étant à présent distinctes. Cela ne dérange visiblement en rien nos pédagogues qui se plaisent par ailleurs volontiers à afficher bruyamment leur antilibéralisme. Ils ne sont pas davantage gênés par la persistance, voire le développement d’un marché parallèle de l’admission dans les cursus les plus prestigieux à travers stages d’été et autres cours particuliers, un phénomène récurrent dans les cursus instrumentaux les plus demandés. Mais qu’à cela ne tienne : « [leur] action ne se limite plus au seul enseignement spécialisé »17. Le petit provincial doué mais insuffisamment fortuné pour s’exiler et/ou intégrer ces circuits officieux, ou bien ne connaissant pas l’existence des bonnes classes au bon endroit, restera amateur toute sa vie et personne n’en saura rien.
Imaginons un instant que l’on souhaite s’attaquer de front à cette compétition cantonnée au sommet de la pyramide. Comme elle ne fait que refléter la réalité d’un marché de l’emploi saturé comme jamais, l’unique réponse sincère aurait consisté à faire intervenir l’État de manière à accroître les subventions publiques aux organisateurs de concerts ou à augmenter le nombre de postes mis au concours dans les orchestres et les conservatoires. Or, par temps de crise, nous assistons précisément au phénomène inverse : l’État se désengage. La question reste alors entière : pourquoi cet acharnement contre une réalité (la sélection dans les conservatoires) que l’on reconnaît par ailleurs largement surestimée ? Subsistent alors deux options : ou bien nos réformateurs ont effectivement dans l’idée de purger ces établissements d’élite des musiciens de haut niveau qui les peuplent, au risque de rompre un accord tacite (donc de mécontenter beaucoup de monde) et de se tirer une balle dans le pied en se privant de la possibilité de se reproduire socialement (les projets transversaux, c’est bon pour les enfants des sans-dents !) ou bien, cas le plus probable, il a été décidé en haut lieu de finir le travail en transformant l’ensemble des conservatoires non adossés à un pôle supérieur en succursales d’une garderie améliorée à vocation socioculturelle, le tout dans le cadre de la réforme territoriale à venir et dans une vision typiquement social-libérale d’un service public réservé aux catégories défavorisées. Qu’importe alors si la finalité de l’école ou du conservatoire (qui, en tant qu’école d’art, n’a rien d’un service public comme on l’a vu précédemment) se voit profondément altérée par cette mutation. La récente suppression de la subvention étatique à ces mêmes établissements semble donc valider cette deuxième solution, la réforme imminente de l’évaluation étant alors une manière de sonner la charge.
Ce qu’évaluer veut dire
Le conservatoire comme l’école sont ainsi devenus des services publics prêts à être reversés le moment venu au secteur marchand, en accord avec des « textes internationaux »18 sur lesquels il est toujours temps de se défausser. C’est alors qu’intervient l’évaluation, non plus pour compléter l’enseignement mais pour s’y substituer. Telle Janus, elle présente deux visages : le premier, tout de bienveillance, s’adresse à l’enfant dont on défendra pieusement l’intérêt. Les concours et les examens – mais aussi la salutaire expérience de l’erreur, nécessaire pour comprendre la vérité d’un énoncé – traumatisent un jeune dopé aux bêtabloquants à force de stress19. Il devient alors urgent de supprimer tout ce qui, de près ou de loin, rappelle que les capacités des élèves ne sont pas égales, tandis qu’au contraire, la socialisation par les pratiques collectives présente l’immense mérite de flatter l’instinct grégaire qu’on leur prête. La « référence unique de niveau »20 est déclarée nulle et non avenue ; l’effort répété, la mémorisation (le fameux par cœur) et l’automatisation aussi précoce que possible du geste sont dénigrés au nom de la nécessaire primauté du sens musical ; mais à vouloir dissocier artificiellement l’idée musicale du ressenti et du geste, donc de sa traduction à la fois physique et technique, ne finit-on pas par la rendre désincarnée, donc insaisissable pour l’élève ?
De même, a-t-on attendu les pédagogues pour savoir que le renfort de l’accompagnateur en cours d’instrument21 ou la pratique du piano complémentaire, notoirement insuffisants dans les conservatoires pour des raisons matérielles, étaient déterminants pour développer l’oreille et la sensibilité musicale des instrumentistes monodiques ? Plus largement, l’impératif consistant à relier l’enseignement à la réalité musicale et à son contexte appartient-il en propre à l’innovation pédagogique22 ? La justification musicale de la réforme a donc ses limites… et les pédagogues le savent bien. Pour preuve, ils n’en usent que pour faire bonne mesure face à un public averti de musiciens23, alors que dans la vraie vie des établissements, où l’on assène à satiété une logique essentiellement administrative et idéologique (pour ne pas dire de parti unique) au gré des réunions pédagogiques et autres mémoires de Cefedem, cette réflexion n’a pas lieu d’être et la rhétorique post-moderne du loisir et du vivre-ensemble reprend aussitôt ses droits24. La primauté de l’instrument étant jugée par trop discriminante, on décrète ainsi la formation globale ; l’histoire de la musique et l’analyse évoluent vers une culture musicale volontiers transversale ; le solfège est remplacé par une FM qui, pourtant initialement dotée de contenus solides25, se voit elle-même volontiers avalée à son tour par le trou noir de la pédagogie de projet ; l’écriture musicale et la composition par l’invention, sans oublier la panacée du numérique. Contre le manque de travail, hors de question d’engager la sanction scolaire, confondue délibérément avec l’autoritarisme : rien de tel que le dialogue, de préférence sous la forme d’un contrat de confiance négocié préalablement. Pour mieux traiter les causes de la fièvre, cassons le thermomètre ; pour éradiquer l’échec, rien de tel que de supprimer le savoir et décréter la réussite pour tous.
Pour autant, l’évaluation ne disparaît pas : elle ne fait que se déplacer de l’acquisition des savoirs vers le savoir-être et les valeurs, en d’autres termes l’attitude. On se replie alors sur le « comportement musicien »26, vague promesse d’une réalisation musicale aboutie. Mais ne mesure-t-on pas le risque de faire subir aux élèves une forme insidieuse de dressage, à force de solliciter leur affect et leur motivation ? C’est ici que se situe l’essence de l’évaluation contemporaine : infantiliser, rendre servile et conformiste27. Car évaluation des élèves et évaluation des professeurs sont fondamentalement de même nature – bien qu’on soit moins prodigue de bons sentiments envers ces derniers depuis que les experts ont établi que « c’est en repensant l’évaluation qu’on [pourra] espérer modifier les pratiques pédagogiques »28 – pour preuve, la prescription aux uns et aux autres de l’auto-évaluation, cette si saine incitation à l’esprit (d’auto)critique. Ces professeurs, qui furent un jour artistes et qui sont devenus à leur insu cadres intermédiaires, sont invités à « se défaire des représentations inappropriées »29 en multipliant les réunions pour co-construire des protocoles et autres grilles de compétences dûment critériées inspirées du socle de compétences, cette usine à gaz qui sévit dans l’enseignement général. On les évalue alors non plus sur l’étendue de leurs connaissances et leur aptitude à les transmettre, mais sur tout autre chose : le dynamisme, le sens du dialogue et de l’initiative, les capacités de travail en équipe, d’évolution et d’adaptation ; au besoin, on leur fait suivre une formation pédagogique30 ; on leur rappelle à l’occasion que la réforme des rythmes scolaires et l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC)31, cet horizon ultime de l’enseignement musical spécialisé, réclament leur lot d’enthousiastes qui ont d’autres valeurs que l’argent. Et le cas échéant, on leur fait valoir une toute autre discipline que celle de l’esprit : celle du projet d’établissement. L’usage veut alors que l’on s’attaque d’abord aux non-titulaires – or, cela tombe bien : cette denrée est de moins en moins rare dans nos conservatoires.
Un écran de fumée
« Ouvrir le grand chantier de l’évaluation »32: voilà qui rappelle étrangement les réformes en cours à l’Éducation Nationale où la ministre, toute soucieuse de ne pas infliger des « blessures d’ego » aux élèves, vient de faire un sort au redoublement et aux notes avant même la fin de la concertation citoyenne organisée pour l’occasion33. Ce n’est donc pas pour rendre la pédagogie des conservatoires plus efficace (au hasard, la relier davantage au fait musical) qu’on rivalise d’activisme de part et d’autre : la coïncidence dévoile une séquence savamment orchestrée aux desseins autrement plus politiques. Car pendant qu’on s’amuse à communiquer sur les vertus des gommettes rouges (et, incidemment, sur la malveillance naturelle du prof), le Ministère de la Culture décide de ne plus verser un centime aux Conservatoires alors que l’État prévoit parallèlement une baisse drastique des dotations aux collectivités locales. Nul besoin d’être Cassandre pour prévoir un assèchement de l’offre et des capacités d’accueil des conservatoires dans les prochaines années34. Mais il y a plus retors : c’est précisément parmi le concert de lamentations sur la fin annoncée de ce financement étatique35 que l’on trouve la voix de ces défenseurs du service public qui, depuis toujours, ont joué les premiers rôles dans ce processus orwellien de démocratisation culturelle36. Et c’est au nom de valeurs de gauche que se doit de professer l’héritier exemplaire que Bruno Julliard, adjoint à la Culture à la Mairie de Paris, accuse les conservatoires parisiens, pourtant littéralement submergés par une demande pléthorique, de « bien porter leur nom » et de « n’être pas à l’image de la société parisienne »37 – on admirera au passage l’appréciation toute objective de la sociologie de la capitale. La dérive démagogique des conservatoires ne pouvait pourtant manquer d’entraîner cet abandon logique ; quant à la pureté affichée des intentions, elle n’a d’autre fin que de diaboliser le contradicteur tout en entretenant savamment la confusion des esprits.
Mais ne faisons pas de mauvais procès à M. Julliard qui ne fait guère preuve d’originalité par sa surenchère démagogique. Si l’État promeut aussi activement les pratiques collectives, la volonté d’optimiser le taux d’encadrement doit sûrement y être pour quelque chose. Si la pédagogie officielle pourfend les examens et le niveau, en commençant par les petits conservatoires où les résistances sont moindres et les esprits plus malléables, c’est (aussi) pour parvenir à une meilleure efficience des ressources humaines. Les jurys extérieurs comme les profs trop diplômés pèsent sur les budgets de collectivités sommées, en ces temps de disette, d’arbitrer entre le rond-point et le bac à fleurs ; par ailleurs, il est toujours bon que le savoir critique du prof en rabatte devant le pouvoir du chef : le modèle de l’entreprise ne s’applique pas là où l’on croit. Enfin, si le ministère s’interroge très officiellement sur le taux d’abandon des élèves (essentiellement à l’adolescence) et la faiblesse de la pratique amateur adulte pour, finalement, trouver une parade à moindre frais en traquant l’élitisme dans les conservatoires, c’est pour mieux faire oublier ses propres travers : le manque de classes à horaires aménagés, la lourdeur de l’emploi du temps au lycée (alors que les options musique y sont depuis longtemps sur la sellette), les aléas des études supérieures et de l’entrée sur le marché du travail ne permettent tout simplement pas à une grande partie des élèves – et avant tout aux moins doués, donc précisément aux futurs amateurs – de pratiquer la musique autrement que par intermittence. Sans compter que la vie active offre sans doute bien d’autres soucis au Français moyen par temps de crise, surtout s’il appartient aux nouveaux publics ; il n’a peut-être pas le temps ni la disponibilité d’esprit de s’investir dans des projets amateurs et citoyens organisés sur son territoire. Mais prenons garde : tout à leur quête éperdue d’une amorce de l’inversion de la courbe du chômage (et accessoirement de contrôle social), nos bureaucrates pourraient très bien finir par trouver le levier de croissance idéal, à savoir l’idée de recruter les futurs participants à ces ateliers… participatifs parmi les personnes à la recherche d’un emploi, une fois épuisé le stock déjà bien maigre des postulants aux TAP !
Vœux pieux, mépris et langue de bois
On pourrait poursuivre à l’envi la litanie des solutions spécieuses apportées à de justes constats. À l’inquiétude légitime soulevée par la suppression des examens, le pédagogue répond que « ce n’est pas le propos » tout en prescrivant aux professionnels de l’enseignement musical de « respecter le rythmes d’apprentissage des élèves » en les évaluant « quand ils sont prêts »38 (c’est-à-dire jamais ?). Une idée à donner des cheveux blancs aux régisseurs et aux préposés à la répartition des salles : par temps de crise, rien de tel que de désorganiser une institution qui fonctionne bien pour mieux la fusionner. Autre exemple qui en dit long : « l’articulation entre nouveaux rythmes scolaires et intervention des conservatoires dans l’éducation artistique » que les auxiliaires du pouvoir en place décrivent comme « un objectif largement partagé »39. Mais à l’évocation de la « peur » légitime « ressentie par les agents de ne plus faire de l’enseignement artistique mais de l’animation »40 en TAP, le ton se fait plus mielleux : on leur susurre qu’ils seront accompagnés, « entendus » et « rassurés » tels des enfants, tout en leur imposant sans contrepartie41 de « faire autre chose », cette autre chose dont on sait seulement que « l’objectif est moins « apprendre » » 42 [sic]. Et c’est bien sûr pour « conserver toute sa place sur le champ de l’enseignement artistique spécialisé » 43 que le Ministère se désengage des conservatoires tout en les impliquant dans une animation socioculturelle locale qui n’est pas de leur ressort : « Comme les moyens sont contraints… les autres doivent « se serrer » un peu… ! » 44 Quand le sophisme le dispute à la double-pensée, la pédagogie devient la négation d’elle-même et se met à singer les pires travers de la politique, tandis que la politique use des vieilles ficelles de la pédagogie pour mieux dissimuler son impuissance. Elles engendrent alors les figures respectives et indissociables de l’amateur, autre nom de l’ignare conformiste, et du gestionnaire féru de pilotage et de politique du chiffre, et toutes deux finissent par se discréditer à force d’offrir le spectacle de l’incompétence et d’un souverain mépris de l’humain comme de l’intérêt général.
Rompre l’illusion du consensus
L’abus de consonance nuit à la bonne tenue du discours musical ; de même, la recherche d’un faux consensus, si prisée des managers, constitue la négation même de toute politique45. De jour en jour se dessine le triomphe du mépris et de la mystification démagogique consistant à fabriquer des consommateurs ignares – autant d’électeurs dociles – au prétexte de les rendre heureux ; et dans le domaine qui nous intéresse, ce n’est assurément pas l’amour de l’art et de la musique qui anime nos décideurs et autres pédagogues. Pourtant, ce n’est pas hier que Condorcet a montré qu’un citoyen non éclairé était susceptible de se faire son propre tyran et d’engendrer cette même violence que l’on prétend juguler par le contrôle social. C’est pourquoi, si l’on veut réellement échapper à ces sombres lendemains, il faut (plus que jamais) instruire ; or, cet ambitieux dessein implique que l’enseignement dispensé aux élèves comme les formations en pédagogie retrouvent nécessairement leur nature disciplinaire et remettent à l’honneur la précieuse expérience des musiciens les plus qualifiés et des maîtres les plus chevronnés. Mais le mal vient de plus loin ; c’est bien toute l’architecture du système qu’il faut repenser. A l’opposé du chaos bureaucratique engendré par une décentralisation mal pensée46, il est temps que l’État prenne enfin ses responsabilités et octroie à l’enseignement musical spécialisé sa tutelle protectrice face à ses propres dérives comme à celles des pouvoirs locaux, comme il a su le faire en son temps pour l’école publique.
Annexe. Liste des acronymes
- ARIAM : Association Régionale d’Information et d’Actions Musicales de la région Île-de-France
- CeFEDeM : Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique
- CA : Certificat d’Aptitude
- CNSM : Conservatoire National Supérieur de Musique
- CRR/CRD/CRC/CRI : Conservatoire à Rayonnement Régional/Départemental/Communal/Intercommunal
- DE : Diplôme d’État
- EAC : Éducation Artistique et Culturelle
- TAP : Temps d’Activités Périscolaires. On dit aussi NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
Notes