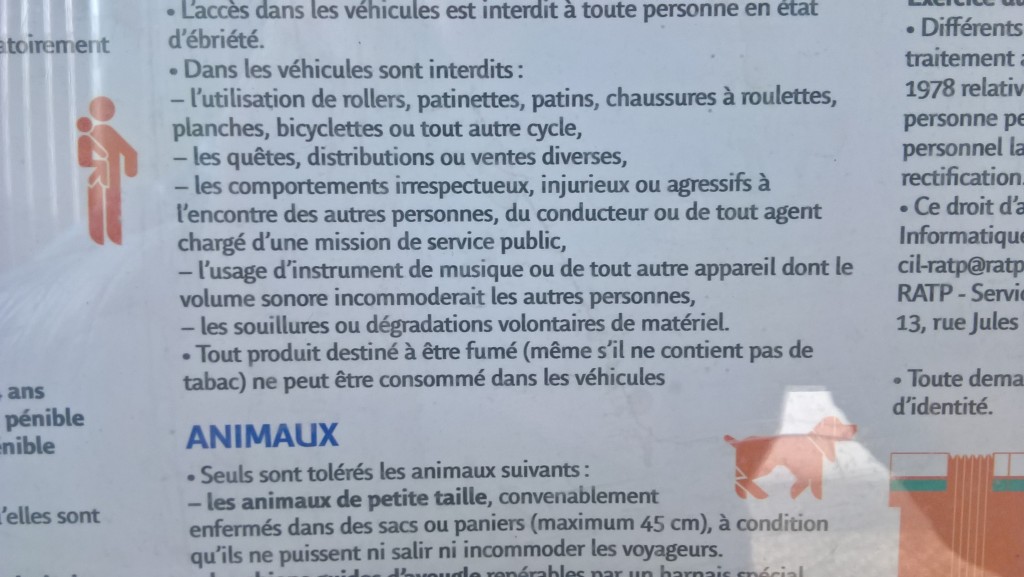Une partie du plaisir que nous prenons à jouer et à faire du sport relève de la fiction : être ailleurs, vivre comme si on était un autre, entrer dans un monde qui, pour un temps, nous soustrait à l’univers infini de notre vie quotidienne. En ce sens, le sport est une activité libérale et réflexive. Mais qu’il soit perverti et retourné, comme dans le roman de Perec et selon des critères empruntés à Roger Caillois, en un univers sur-réel sans fin, et il devient un cauchemar où nous ne rêvons pas : nous y sommes rêvés. Sans la co-présence du réel et du fictif, il n’y a plus de place pour la moindre parcelle de liberté.
Une version différente de ce texte a été publiée dans Regards sur le sport. Hommage à Bernard Jeu, textes réunis par Jean-Marc Silvain et Noureddine Seoudi, Villeneuve d’Ascq : Presses de l’Université de Lille-III, collection Travaux et recherches, 2002.
1 – Relire le roman de Perec à la lumière d’un ouvrage de Roger Caillois
Tout amateur de sport éprouve une fascination en lisant le roman de Georges Perec W ou le souvenir d’enfance, qui se présente en deux récits parallèles et alternés.
L’un est un récit à la première personne de l’enfance de l’auteur, un petit garçon juif réfugié à Villard de Lans sous la garde de ses parents adoptifs. L’absence de souvenirs d’enfance, la pauvreté de son histoire personnelle, il la doit à l’Histoire, la grande, «avec sa grande hache» qui, en faisant de son père un soldat mort au front et de sa mère une victime des camps de concentration, a coupé de lui toute mémoire. Alors qu’il avait treize ans, ce petit garçon avait inventé une histoire fondée sur le fantasme olympique : celle de W, un îlot proche de la Terre de Feu où vit une société «exclusivement préoccupée de sport».
L’autre face du roman est une narration romanesque classique. Gaspard Winckler, le narrateur, y est conduit à rechercher la piste d’un enfant disparu, dont il a sans le savoir usurpé l’identité. Atteint d’un mal mystérieux, sourd, aphasique et prostré, cet enfant a été embarqué par sa mère dans une croisière désespérée à l’autre bout du monde : elle nourrit l’espoir qu’un événement déclenchera chez son fils le processus de guérison. Mais le navire a sombré près de la Terre de Feu à la suite d’une collision. Seul, le corps de l’enfant n’a pas été retrouvé. La mère s’est épuisée, les reins brisés par une malle, à tenter d’ouvrir la porte de sa cabine : les sauveteurs la retrouvèrent morte, ses ongles en sang ayant entaillé la porte de chêne.
Ce détail, comme bien d’autres, noue les deux récits parallèles qui convergent vers l’univers concentrationnaire.
Le narrateur part à la recherche de l’enfant. Puis, à partir de la page 85, qui signale une coupure dans le roman, son récit se transforme en description. On y voit l’île de W, «là-bas, à l’autre bout du monde», où la vie est exclusivement consacrée au sport. Cette description mobilise une multiplicité de procédés «oulipiens» chers à Perec (combinatoires, calculs, jeux sur les noms propres, entrecroisements de signifiants). La cité de W est fondée sur une organisation olympique rigoureuse, où la vie de quatre villages est réglée par des compétitions d’athlétisme rituelles qui se succèdent dans un savant chassé-croisé où toutes les possibilités de rencontre sont exploitées systématiquement. Les différents types de championnats sont soigneusement hiérarchisés et donnent lieu à une taxinomie dont les athlètes tirent leurs noms – car ils n’ont pas de noms propres. Tout est orchestré par une organisation suprêmement habile et inaccessible, tout jusqu’à la nourriture des athlètes, un régime savamment déficitaire en sucre qui les met en perpétuel état de demande sans les abrutir complètement. Tout est calculé, jusqu’aux irrégularités qui viennent apparemment troubler et fausser les compétitions. Dans certaines rencontres en effet, la règle peut changer brusquement, un système inédit de handicaps peut être soudainement mis en place à l’insu des participants, de sorte que qui perd gagne et inversement.
Plus la description s’avance et plus la mécanique de ce réglage devient opaque et étouffante jusqu’à l’horreur. Ici, on apprend que les vaincus sont exposés à des humiliations et des brimades «en principe interdites» mais en réalité tolérées et encouragées par les organisateurs ; cela va du simple gage aux sévices plus sérieux et jusqu’à la mort par lapidation. Plus loin, c’est une description apocalyptique du partage et du viol des femmes sur un stade à l’issue d’une course truquée où tout est permis et où chacun, entièrement nu à l’exception des chaussures de course, est exposé aux coups de crampons soigneusement aiguisés pour l’occasion.
Inutile d’atteindre la fin du roman (qui se termine par une citation du livre de David Rousset L’univers concentrationnaire) pour comprendre que ce paradis olympique n’est autre qu’un camp de concentration.
Une fois sa lecture achevée, le lecteur se livre à une lecture rétrospective de déchiffrage dans laquelle il peut relever des signes conduisant à cette fin. La géographie de W est une allusion limpide à la géographie infernale de la littérature classique fabuleuse. Citons encore le vêtement des athlètes, leur nourriture, l’organisation minutieuse de l’injustice, la démarcation à la fois étanche et étrangement poreuse qui sépare les athlètes des Officiels, la devise, le système de nomenclature, le doublage des noms par des sobriquets, l’emploi emphatique des majuscules initiales pour désigner les fonctions administratives. Le tout se cristallise dans le signifiant «W» qui donne son titre au roman et qui noue aussi ses deux fils parallèles. Ce W, qui frappe le vêtement des athlètes, est, sur l’autre versant du livre, l’objet d’une combinatoire où il se métamorphose en insigne nazi.
Je m’intéresserai à la description de la société athlétique de W, non pas pour montrer qu’elle renvoie à l’univers concentrationnaire, mais pour étudier les procédés de ce renvoi, grâce à un rapprochement avec un ouvrage de Roger Caillois, Les jeux et les hommes, où Caillois dégage les propriétés du jeu, et où il en étudie les corruptions.
Cela donne lieu à une première thèse, technique. Pour obtenir les propriétés de l’univers concentrationnaire, il suffit de faire subir au sport les perversions des caractéristiques qui l’apparentent au concept de jeu tel qu’il est décrit par Caillois. D’une activité éminemment agréable, le sport devient un enfer, de sorte que tout se passe comme si Perec avait emprunté à Caillois les critères du jeu, les avait attribués au sport, et les avait systématiquement pervertis.
Mais la différence est que Perec va beaucoup plus loin : plus que de perversion, on pourra parler d’hyperbole. De ce fait son roman nous en apprend davantage sur le jeu, sur le sport et sur le plaisir que nous en tirons et surtout sur les conditions qui rendent ce plaisir possible et qui, si elles sont désavouées ou retournées, transforment jeux et sports en enfer. C’est la thèse philosophique qui suivra de la thèse technique. En revenant à des textes classiques comme les Maximes et réflexions sur la comédie de Bossuet et Les Passions de l’âme de Descartes, on pourra y esquisser une théorie du frivole et de la «frime».
2 – Le principe de corruption
Le malaise grandissant éprouvé par le lecteur à mesure qu’il avance dans la description de la vie à W peut se comparer à un sentiment de trahison du sport. Mais trahison signifie aussi une forme de fidélité et une sorte de révélation. Examiner les lois de déformation qui gouvernent cette trahison, c’est en même temps remonter à l’objet d’origine qui se trouve perverti. Cette remontée régressive s’effectue aisément si on s’appuie sur le concept de jeu tel que Roger Caillois le définit et l’étudie dans son ouvrage Les jeux et les hommes. Les déformations satisfont à un principe général que Caillois expose au chapitre IV et qu’il appelle «corruption du jeu». L’auteur l’énonce ainsi, en parlant du jeu : «toute contamination avec la vie courante risque de corrompre et de ruiner sa nature même».
L’idée fondamentale est que le jeu est une activité à part, séparée du reste de l’existence. On joue pour être soustrait un moment au réel infiniment envahissant de la vie ordinaire – cela s’applique à la pratique du sport amateur, fondement du concept olympique, et donc au fantasme olympique dont W est, de l’aveu même de l’auteur, expressément inspiré.
J’appellerai irréalité cette séparation que le jeu découpe sur la vie ordinaire (Caillois parle aussi de réalité seconde) : il s’agit d’un moment où nous vivons sur le mode de la fiction, comparable en partie à celui sur lequel nous vivons la fiction esthétique. Il existe par ailleurs, comme Caillois le précise aussi, des jeux qui utilisent la fiction comme principe (jeux de rôles, poupées, etc.), mais cela n’empêche pas tout jeu d’entretenir un rapport essentiel à la fiction, en ce sens que l’espace et le temps du jeu font que nous avons l’impression d’être ailleurs, de vivre une autre vie, et même parfois d’être un autre. Cette irréalité a donc aussi une propriété cosmologique : jouer, c’est produire un monde, quelque chose de délimité, de clos, qui a ses règles propres.
La pratique libérale et dilettante du sport présente évidemment cette propriété, qui explique en grande partie son agrément. Cela ne signifie nullement que nous ne prenons pas le sport au sérieux, mais que ce sérieux (celui avec lequel je choisis et j’entretiens avec soin mon matériel de randonnée, avec lequel je prépare mon sac de montagne, avec lequel je choisis l’itinéraire, je scrute la météo) est entièrement tourné vers la production d’un autre monde, dans lequel je m’habille autrement, je parle autrement, je fais autre chose, un monde qui se distingue de mon activité ordinaire.
Mais cette séparation ou irréalité s’accompagne d’un corollaire : c’est l’idée de contamination. Monde à part, vécu sur une modalité irréelle, certes, mais pour que cela soit possible et pour que cette irréalité ne soit pas une hallucination, pour que cette fiction soit distincte d’une illusion (car l’illusion et l’hallucination, à la différence de la fiction, sont vécues sur le mode du réel), encore faut-il qu’il y ait un réel, un référent sur lequel s’enlève le monde du jeu, avec lequel il contraste, mais avec lequel il entretient des relations. La vie ordinaire forme la toile de fond sur laquelle je découpe le jeu, aussi bien dans le temps que dans l’espace. Et cette vie ordinaire côtoie le jeu, de sorte que bien souvent le jeu la singe, l’imite (un enfant joue à être aviateur, maîtresse d’école, médecin) tout en l’idéalisant. Il existe donc un rapport de structure, à la fois d’opposition, de distinction et de parallélisme entre le monde ludique et la vie ordinaire.
Caillois parle de corruption du jeu chaque fois que ce rapport structural entre jeu et vie ordinaire est brouillé : si le jeu, pour une raison ou pour une autre, ne peut plus être distingué de l’activité ordinaire, il est corrompu.
Il écrit, page 101-102 (chap. IV) :
[…] « il peut être intéressant de se demander ce que deviennent les jeux, quand la cloison rigoureuse qui sépare leurs règles idéales des lois diffuses et insidieuses de l’existence quotidienne perd sa netteté nécessaire. »
Il donne des exemples, notamment celui du joueur professionnel, pour qui le jeu n’est plus une activité ludique, mais une activité ordinaire. En réalité, le jeu lui-même ne perd pas sa nature : le joueur professionnel ne change pas la nature du poker ; ce qui est modifié, c’est le rapport de l’agent au jeu. Le joueur professionnel ne joue plus, il travaille, il réinjecte dans le jeu le souci ordinaire de la vie, le sérieux et l’amertume de la vraie vie.
Je prends un autre exemple, emprunté à ma propre pratique en amateur d’une activité sportive. La randonnée en montagne est agréable tant que le rapport réel/irréel est tel que le réel alimente l’irréel, ou alimente le fantasme d’irréel sans l’envahir. Je n’apprécie pas trop (sauf à des fins d’entraînement) une promenade totalement exempte d’imprévu ou de danger. Mais cet imprévu et ce danger ne doivent pas menacer le monde légèrement euphorique que je me construis dès que je mets mes chaussures et que j’endosse mon sac. Un orage, passe encore, mais si je vois la foudre frapper un rocher à 100 m de moi, c’est trop : je suis happée par une dimension qui détruit le monde ludique en me ramenant sévèrement aux soucis du réel. Le réel reprend ses droits et peut transformer la promenade en cauchemar.
3 – Aspect morphologique : les perversions
Muni de ce principe structural emprunté à Caillois qui articule le monde ludique (fini) à l’univers ordinaire (sans limite), on peut examiner les procédés mis en place dans W. On peut éclairer de façon nette une distinction que Caillois suggère et emploie, mais qu’il ne théorise pas de façon explicite : la distinction entre corruption et perversion. La corruption, comme on vient de le dire, c’est le fait qu’il y a contamination du jeu par la vie ordinaire, de telle sorte que le joueur n’a plus le sentiment d’être dans un espace et un temps spécifiques, abstraits d’un univers sérieux et infini. La corruption est donc un effet moral. Si on se demande à présent comment cette corruption s’introduit, comment elle est produite, on constate que c’est toujours par un ou des procédés de déformation d’une ou plusieurs propriétés du jeu : ou encore par perversion, détournement. La perversion est donc un paramètre de type morphologique qui agit sur la forme même du jeu, c’est un mouvement, une modification dont l’effet est corrupteur.
Prenons les caractères qui, selon Caillois, entrent dans la définition du jeu. Il en dénombre six, au nombre desquels il place le caractère fictif (sentiment d’irréalité), sur lequel je ne reviendrai pas. J’illustrerai chacun des autres par un ou deux exemples de perversion puisés dans W.
1° Le jeu est une activité libre.
Il suppose une adhésion volontaire et implique aussi que l’on puisse s’en retirer librement. Cela l’oppose aux activités contraintes de notre vie ordinaire, même si, par ailleurs, il nous arrive d’y prendre un certain plaisir. Le moins qu’on puisse dire est que ce n’est pas le cas du sport à W, qui y revêt le caractère, non pas obligatoire (car on peut s’obliger volontairement à une règle librement acceptée), mais nécessaire d’une activité allant même au-delà de l’activité professionnelle. Le sport à W est hyper professionnel, en ce sens général qu’il n’y a pas d’autre horizon et pas d’autre choix mais aussi en ce sens particulier que la répartition des athlètes selon leurs spécialités n’offre aucune latitude, aucun jeu précisément, et cela même contre toute logique ou tout calcul sportif, c’est-à-dire que l’hyper professionnalisme contrarie le concept même de sport (chap. XIV, p. 113-114).
La perversion se révèle double : de ludique, le sport devient réel, mais cette réalité, en contredisant les lois mêmes du sport professionnel, devient une sorte de sur-réalité. Les habitants de W ne vivent ni dans un espace fictif, ni dans un espace réel, mais dans un espace sur réel, comme celui d’un cauchemar.
2° Le jeu suppose des limites dans le temps et dans l’espace, précises et fixées à l’avance.
Si ces limites deviennent floues, «ce n’est plus du jeu», et de même si le jeu envahit totalement l’existence de quelqu’un, ce n’est plus une activité ludique, mais le jeu devient une réalité de substitution.
Les compétitions de W satisfont à peu de chose près ce caractère: comme les rencontres sportives normales, elles ont lieu sur des terrains délimités et durent un certain temps. Et pourtant, c’est l’intégralité de la vie, avec tous ses moments et en tous lieux, qui est habitée et hantée par la compétition. Cela apparente partiellement la vie des athlètes de W à celle des sportifs professionnels, qui doivent faire attention constamment à leur régime alimentaire, à leur mode de vie. Mais cela va bien au-delà, puisque cette contamination prend la forme, non d’une professionnalisation relevant d’une vie maîtrisée, d’une vie humaine en laquelle on peut se reconnaître, mais d’un destin pesant sur l’athlète avant sa naissance et pendant toute sa vie. Tout dans la vie de l’athlète est marqué par l’activité sportive : son appartenance, ses adversaires, la spécialité qu’il pratique, les vêtements qu’il pourra porter, les noms qu’il pourra recevoir, le sort qu’il subira à l’issue heureuse ou malheureuse d’une rencontre, sa retraite et la façon dont il mourra. Tout n’est pas prévisible, loin de là (et c’est même l’une des dimensions d’horreur de la vie à W), mais tout est pris dans les filets de l’activité sportive qui, en ce sens, n’a ni commencement ni fin.
Du reste l’histoire de W n’est pas situable dans un temps historique linéaire, mais plutôt dans un temps mythique circulaire : elle n’a pas à proprement parler d’origine, elle ne connaît ni progrès ni révolution, tout est ainsi depuis toujours et tout sera ainsi pour l’éternité.
Là encore, on peut remarquer une perversion à double torsion. Le sport pratiqué à W s’éloigne doublement d’une activité ludique, d’abord parce qu’il ressemble à une activité professionnelle réelle, et ensuite parce qu’il pousse celle-ci à son point de sur-réalité : il devient le seul réel qui compte, au mépris de toutes les lois du réel.
3° Je regrouperai ici deux caractères que Caillois distingue dans son énumération. (3.1) Le jeu est une activité incertaine, mais (3.2) c’est une activité réglée, soumise à des règles qui suspendent provisoirement les lois ordinaires.
Par incertitude, Caillois entend que l’issue n’est pas connue à l’avance pour ceux qui s’engagent : on ne sait pas qui va perdre et qui va gagner. Il veut dire aussi qu’un jeu doit solliciter, à l’intérieur de limites et de contraintes précises, une invention renouvelant la situation.
Mais cette incertitude et cette latitude, si elles introduisent une contingence dans le déroulement et l’issue du jeu, ne sont pas totales. De même qu’un jeu dont l’issue serait connue à l’avance ou dont toutes les situations pourraient être prévues dans le détail n’en serait plus un et engendrerait l’ennui, de même un jeu où tout est possible, où la situation peut devenir entièrement incohérente par rapport à l’ordre que le jeu instaure et dans lequel il se déroule, cela n’est pas davantage un jeu. En bref, le jeu ne peut évoluer ni dans le domaine de la nécessité absolue ni dans celui du chaos total : il se situe dans une plage moyenne où la contingence s’introduit dans la contrainte et grâce à elle, évitant aussi bien l’ennui que ce qui est totalement déroutant.
Le monde de W est tellement réglementé, quadrillé, formé par un entrecroisement de combinatoires, qu’il est effectivement guetté par l’ennui et la monotonie. Voilà l’impression que le lecteur éprouve pendant les premiers chapitres consacrés à la description de l’île (chap. XII, XIV, XVI). C’est une forme de perversion évidente, qui aplanit le plaisir du jeu et le transforme en régularité de tous les instants. La perversion consiste également à transformer la règle (celle du sport) en loi : W n’a pas d’autre législation que celle qui ordonne les rencontres sportives. On ne peut donc pas y distinguer vie sportive, vie sociale et vie politique. Personne à W ne peut s’offrir, grâce au sport, le luxe d’une double vie. Le minimum de frime nécessaire à l’existence quotidienne, qui introduit une respiration dans l’ordinaire, est impossible. On n’y joue jamais, on est toujours terriblement sérieux : le sport est un horizon indépassable.
Donc W est bien tout d’abord un univers infini d’ennui fondé sur l’indistinction des registres de la vie humaine. C’est le premier volet de la perversion de ce troisième critère : à la place de l’incertitude se glisse la nécessité, laquelle confond de plus règle du jeu et loi de la cité.
Mais, au milieu du chapitre XVIII, tout bascule sur l’autre versant de la perversion de ce même critère, qui va être tiré maintenant en sens inverse. A la place d’une incertitude agréablement réglée, qui caractérise le jeu, c’est un chaos totalement imprévisible, mais horriblement organisé de l’extérieur, qui va envahir petit à petit le roman. Le moment où se produit cet effet de miroir dans la perversion, est très précis. Après avoir exposé les principes du régime alimentaire des athlètes, perpétuellement tenus en léger état hypoglucidique, le chapitre XVIII décrit la manière dont sont célébrés les vainqueurs à W : on les convie à un somptueux repas très riche en sucres (p. 123), ce qui leur offre une chance supplémentaire de gagner encore. Le système se bouclerait alors en une uniformité trop parfaite parce que démobilisatrice. On pousse donc les athlètes vainqueurs à festoyer plus que de raison, à s’enivrer, à passer une nuit blanche le verre à la main en compagnie des officiels et des entraîneurs. Le lendemain matin, on les envoie à nouveau sur les stades avec la gueule de bois. Un grain de sable est savamment glissé dans la machine et y introduit un élément de changement. A partir de là, le lecteur découvre que le dérèglement est l’art suprême de l’organisation de W : il a un statut constitutif. Le dérèglement y atteint la dimension d’un art politique.
On est éclairé au chapitre XXII, qui énonce le principe même de l’organisation par le dérèglement, la mise au point d’un univers où personne ne sait à quelle sauce il sera mangé, quelle nouvelle torture il devra subir ou à quelle nouvelle faveur il sera brusquement élevé. W n’est pas gouverné par des lois, mais par l’arbitraire de la règle porté à un degré absolu.
Pour conclure sur ce troisième critère (incertitude et prévisibilité, liberté et contrainte), il faut une fois de plus souligner que le procédé de perversion est à double détente : W pervertit le jeu en le rendant à la fois uniforme et chaotique. Sur W, le sport est déformé par des caricatures symétriques : en un sens, on peut tout prévoir ; en un sens on peut s’attendre à tout. Les deux modalités infernales qui démentent et falsifient la vie elle-même, laquelle est fondée sur une contingence passionnante soutenue par un ordre général, se font face. A l’ennui se superposent «l’espoir insensé et la terreur indicible», qui ne sont que des figures du désespoir. Ne s’attendre à rien, s’attendre à tout, c’est se trouver face à un vide total.
4° Le jeu est une activité improductive : il ne crée pas de richesses, mais il se contente de les déplacer.
Ce critère est évidemment falsifié par la vie à W, où le sport est la seule activité, où il n’est autre qu’un travail. Il est falsifié aussi de façon ironique puisqu’à la fin du roman, on s’aperçoit que les performances accomplies par les athlètes sont dérisoires : le sport n’y produit même pas de réussites sur le plan des résultats mesurables.
Mais là encore, un second tour est donné à la vis de la perversion. Car bien qu’il soit le seul horizon d’activité sur W, le sport n’en reste pas moins gratuit, on ne voit pas d’où viennent les richesses, comment sont obtenus les biens qui y sont présents, avec quoi on achète la nourriture par exemple. Cette société tourne en rond, c’est un circuit économique totalement absurde, dans lequel rien n’est produit, où rien ne circule, rien ne vient de l’extérieur puisqu’il n’y a pas d’extérieur. Le caractère improductif du jeu s’y trouve donc à la fois démenti et exalté jusqu’à son point hyperbolique.
4 – L’effet moral et le double tour de vis
L’effet de ces différents procédés de perversion à l’œuvre dans le roman conduit à quelques réflexions philosophiques.
L’effet principal est certainement celui de la corruption, en ce sens qu’il y a contamination entre deux domaines qui sont, en principe, à la fois distincts et articulés l’un à l’autre. Si, comme le pense Caillois, nous nous livrons au jeu et au sport pour éprouver le plaisir de l’altérité par rapport au monde ordinaire, alors on peut dire que sur W le sport n’a pas d’autre en ce sens qu’il n’y a rien d’autre. Le sport devient le seul ordre auquel on puisse souscrire : il est l’ordinaire des athlètes et de tous les habitants de l’île. On ne peut donc pas y faire du sport pour s’abstraire du souci ordinaire. La contamination est telle que l’effet est l’inverse de celui que nous attendons du jeu ou de la pratique d’un sport : le jeu ne forme plus un monde dans lequel on entre librement et duquel on peut sortir. Il y devient un univers.
La seule façon de s’extraire de l’univers qui nous environne de toutes parts et dans lequel nous sommes englués est de produire une fiction, ou une méta-réalité. C’est ce que nous faisons lorsque nous pensons que nous sommes libres (nous produisons une méta-réalité, que nous appelons «sujet», qui échappe à la série des conditions déterminées, qui ne relève pas de l’ordre physique de la nature, c’est un objet métaphysique). C’est aussi ce que nous faisons lorsque nous allons au théâtre : nous sommes dans la salle, laquelle est incluse évidemment dans l’univers, mais nous nous figurons que, par rapport à ce que nous voyons sur la scène, nous occupons un lieu qui n’est nulle part et qui n’est pas dans le temps, puisque le lieu et le temps sont durant toute la fiction ceux de la scène. Voilà pourquoi, entre autres, les problèmes du temps et de l’espace au théâtre ne relèvent nullement de la convention : il y a un espace et un temps de théâtre, lesquels font que, durant la représentation, nous sommes placés comme si nous étions des dieux. La fiction esthétique, d’une manière générale, présente ces propriétés qui font qu’elle est toujours une pensée métaphysique ou qu’elle pose les problèmes de la métaphysique.
Or, une partie du plaisir que nous prenons à jouer et à faire du sport relève de cet agrément : être ailleurs, vivre comme si on était un autre, entrer dans un monde qui, le temps du jeu, nous soustrait à l’univers infini de notre vie quotidienne. C’est pourquoi j’avancerai l’idée que, en ce sens, le sport est une activité libérale et réflexive.
Libérale parce qu’elle ne peut pas se penser si on ne fait pas l’hypothèse d’un sujet libre et désintéressé, qui prend du plaisir à s’abstraire du réel, à occuper un position en retrait laquelle s’apparente, d’une part à la position esthétique, de l’autre à la position spéculative du chercheur. Seul un être méditatif et enclin à la contemplation peut penser à faire du sport : quelle drôle d’idée ! Réflexive parce que toute activité qui refuse de s’immerger dans le premier plan de la vie ordinaire, qui prend du recul, se pense elle-même par la même opération, se donne une représentation d’elle-même, s’arrache à une forme de conscience immédiate et, ce faisant, se pense toujours sous la catégorie de subjectivité métaphysique, de sujet libre.
Mais encore faut-il, pour que cette activité nous donne le sentiment de notre propre liberté, qu’elle soit éprouvée sur le mode de la force et de la difficulté surmontée : nous y puisons alors le sentiment d’une maîtrise que nous exerçons. Une trop grande facilité la fait rentrer dans un ordinaire insipide, une trop grande difficulté nous donne le sentiment d’un réel écrasant. Aussi le rapport au réel est-il paradoxal, comme on l’a vu déjà avec Caillois. Le réel, pour être mis à distance, doit cependant être ressenti comme présent et susceptible de reprendre ses droits, mais pas au point de nous engloutir totalement. Un jeu où nous gagnons trop facilement ne nous donne aucun plaisir, un sport dans lequel on nous réclame des performances inaccessibles devient une torture.
Ce nouage entre métaphysique, esthétique et morale, personne ne l’a mieux exprimé que Descartes, dans sa correspondance avec Élisabeth et dans son traité Les Passions de l’âme, où on trouve aussi une très brève mais très profonde théorie du sport :
« Et il est aisé de prouver que le plaisir de l’âme auquel consiste la béatitude, n’est pas inséparable de la gaieté et de l’aise du corps, tant par l’exemple des tragédies qui nous plaisent d’autant plus qu’elles excitent en nous plus de tristesse, que par celui des exercices du corps, comme la chasse, le jeu de la paume et autres semblables, qui ne laissent pas d’être agréables, encore qu’ils soient fort pénibles; et même on voit que souvent c’est la fatigue et la peine qui en augmente le plaisir. Et la cause du contentement que l’âme reçoit en ces exercices, consiste en ce qu’ils lui font remarquer la force, ou l’adresse, ou quelque autre perfection du corps auquel elle est jointe; mais le contentement qu’elle a de pleurer, en voyant représenter quelque action pitoyable et funeste sur un théâtre, vient principalement de ce qu’il lui semble qu’elle fait une action vertueuse, ayant compassion des affligés; et généralement elle se plaît à sentir émouvoir en soi des passions, de quelque nature qu’elles soient, pourvu qu’elle en demeure maîtresse. » (A Élisabeth, 6 octobre 1645)
« Mais la cause qui fait que pour l’ordinaire la joie suit du chatouillement, est que tout ce qu’on nomme chatouillement ou sentiment agréable consiste en ce que les objets des sens excitent quelque mouvement dans les nerfs, qui serait capable de leur nuire s’il n’avaient pas assez de force pour lui résister ou que le corps ne fût pas bien disposé. Ce qui fait une impression dans le cerveau, laquelle étant instituée de la nature pour témoigner cette bonne disposition et cette force, la représente à l’âme comme un bien qui lui appartient, en tant qu’elle est unie avec le corps, et ainsi excite en elle la joie. C’est presque la même raison qui fait qu’on prend naturellement plaisir à se sentir émouvoir à toutes sortes de passions, même à la tristesse et à la haine, lorsque ces passions ne sont causées que par les aventures étranges qu’on voit représenter sur un théâtre, ou par d’autres pareils sujets, qui ne pouvant nous nuire en aucune façon, semblent chatouiller notre âme en la touchant. » (Les Passions de l’âme, art. 94)
Dans W, toute cette dimension libérale, qui permet de se percevoir soi-même et d’être maître, est systématiquement rabattue sur un réel inexorable qui annule tout sentiment de maîtrise et de liberté. Ce qui devrait être un monde est réduit à être l’univers, le seul univers, l’infinité de l’ennui et du désespoir. Il devient impossible aux habitants de repousser à distance convenable ce qu’ils vivent pour pouvoir le contempler, ils n’ont aucun moment de respiration, aucune expérience leur témoignant qu’ils sont libres et forts. L’horreur particulière qui s’en dégage est que cette réduction de la distance est produite par une activité qui en principe devrait donner de la distance.
J’ai souligné à maintes reprises que Perec procède à une double perversion du sport dans son roman, qu’il donne deux tours d’écrou.
Le premier consiste à rabattre le sport sur la vie réelle, à lui donner grosso modo les caractéristiques d’une activité professionnelle, ce qui réintroduit le souci de la vie ordinaire : c’est une réduction du sport à la quotidienneté. La dimension fictive du sport est effacée et diluée dans le réel, le sérieux de la vraie vie. Mais, même dans la vraie vie, nous avons toujours la possibilité de trouver une activité qui nous permettra de vivre sur le mode fictif. Je suppose que les sportifs professionnels, envahis par les soucis que leur donne leur profession, ont dans leur vie quelque point de fuite qui les retire de leur quotidienneté. Or, l’une des propriétés de l’univers concentrationnaire, c’est justement qu’un tel retrait est impossible. Le génie du tortionnaire, c’est de trouver le moyen qu’aucun point de fuite ne soit ni possible ni même imaginable : alors il y a réduction totale de toute conscience proprement humaine.
Le second tour de vis, beaucoup plus étrange et plus efficace dans l’horreur, achève cette perfection de la torture. Il consiste à porter les propriétés fictives elles-mêmes à leur point hyperbolique, le point où elles font réalité. C’est ce qui apparente la vie sur W à un cauchemar. En un sens, rien n’y tient debout, rien n’y résiste à l’examen des conditions de possibilité de l’expérience. Et en même temps, c’est cette négation même de réalité qui devient le seul réel. Il y a production d’une sur-réalité pire que la réalité elle-même, parce que de cette sur réalité on ne peut pas s’échapper. Perec ne rabat pas simplement le monde du sport sur l’univers : de ce qui devrait être un monde, il fait un univers.
L’effet cosmologique est indissociable de l’effet moral. Le sujet est à proprement parler démoralisé parce qu’il n’a plus de point métaphysique lui permettant de s’extraire et de se penser lui-même. Imaginons une vie où toute activité fictive, toute activité contemplative, toute activité purement spéculative serait rendue impossible. Ce serait déjà un enfer, un étouffoir. Mais imaginer une vie où cette impossibilité serait produite par le fait que, chaque fois que nous croyons nous livrer à une activité de ce type, nous sommes déçus et démentis, elle nous échappe, elle fond entre nos mains ou se retourne en son contraire : nous ne pouvons plus rêver, parce que chacun de nos rêves est réel, et donc devient un cauchemar. Où se mettre pour être quelqu’un et dire «Je suis, j’existe» ? Face à un tel malin génie, il n’y a même plus de quelqu’un. Nous sommes des jouets.
Ici encore, je me tournerai vers des textes classiques, car ce mouvement de resserrement par lequel le fictif est rabattu sur le réel, a déjà été fortement pensé par les adversaires du théâtre au XVIIe siècle. Nicole dans ses Lettres sur l’hérésie imaginaire et Bossuet dans ses Maximes et réflexions sur la comédie ont l’un et l’autre parfaitement expliqué leur haine du théâtre. A cause de sa nature fictive, le théâtre nous propose un monde irréel mais à la faveur duquel nous nous croyons libres de vivre toutes nos passions. Le théâtre nous affranchit : sous prétexte qu’il s’agit d’une fiction, nous donnons libre cours à notre moi, lequel est haïssable. Nous venons au théâtre, non pas tant pour y admirer des héros dont nous savons bien qu’ils n’existent pas, mais pour nous adorer nous-mêmes, croyant y éprouver innocemment toutes les passions sous le prétexte qu’elles sont vécues par procuration.
Effectivement, ce que Nicole et Bossuet ont très bien vu, c’est que le rapport à la fiction est un rapport à notre propre liberté et que la vie, lorsqu’elle est déconnectée du sérieux, lorsqu’elle peut être vécue avec frivolité, devient agréable. Descartes l’avait dit, aussi : même les passions tristes, lorsqu’elles sont produites par la lecture, le théâtre, le jeu, sont agréables parce qu’on se sent remué sans se sentir esclave, parce qu’on récupère une maîtrise. Descartes le dit aussi pour le sport (la chasse, la paume et autres exercices «qui ne laissent pas d’être agréables, encore qu’ils soient fort pénibles»). C’est que cette peine, d’abord nous est accessible, qu’elle relève de notre propre maîtrise, qu’elle témoigne de notre force et ensuite qu’elle n’est pas produite par quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Ce que nous cherchons donc, à travers le sentiment de notre propre force ou de notre propre adresse, c’est le témoignage de notre liberté.
Voilà ce que Nicole et Bossuet dénoncent, ce qu’ils ont parfaitement compris, ce qu’ils récusent, ce qu’ils soupçonnent à juste titre : il existe des moments où nous nous arrangeons pour être des dieux. Les dieux du stade ? peut-être. Toujours est-il que le moment de recul et de virtuosité que nous offrent jeux et sports et que nous offre aussi le plaisir esthétique, que nous offre enfin le plaisir de comprendre, le plaisir d’être intelligent, ce sont des moments divins. Traduction en langage rigoriste : ce sont les moments glorieux et vaniteux. Le programme rigoriste consiste, par conséquent, à ramener les hommes au sérieux de la vraie vie, à réintroduire l’amertume dans les passions en les subordonnant aux circonstances réelles. Il faut fermer les portes des théâtres, revenir à la misère réelle, et s’occuper de cette misère : afin de ne jamais oublier que l’homme est misère et de ne jamais croire que nous pouvons être des dieux. Programme humanitaire et féroce qui dénonce, avec le luxe, toute activité frivole. Voilà pourquoi l’humanitaire (vous devez penser sans cesse à la misère réelle et vous sentir coupable chaque fois que vous faites quelque chose d’inutile) est contraire à l’humanité.
5 – L’antithétique de la fiction et la liberté
Je suggérerai pour finir quelques rapprochements et un élargissement vers la relation constituante entre fiction et liberté sous la forme d’une antithétique de la fiction.
Une théorie de la « frime » pourrait être fondée sur le principe du point de fuite essentiel à toute liberté. Pour échapper au désespoir, et lorsqu’une situation est désespérée, il n’y a guère que la frime qui puisse offrir quelque moment réflexif et qui puisse soutenir l’idée même de liberté. C’est une mauvaise action qui relève du rigorisme le plus élémentaire que de critiquer les pauvres gens qui jouent : mais c’est précisément parce qu’ils n’ont rien qu’ils jouent ! De même, c’est une mauvaise action d’empêcher les vieillards de jouer aux cartes et de se disputer violemment, etc. La frime est le degré le plus désespéré de la liberté, mais c’est un degré de liberté.
Au sujet du sport, quelque chose de très inquiétant se produit dans la société contemporaine, c’est le phénomène des loisirs, au sens d’une industrie, d’une activité économique ; cela s’oppose au loisir au sens libéral et aristotélicien du terme. Or ces loisirs, par la manière dont ils sont mis en place, exploités et vécus, ont des propriétés un peu comparables aux deux étages de perversion présents dans le roman de Perec. « Les loisirs » sont des activités contraintes, dominées par un conformisme, par un « il faut ». De même qu’on a joué au tennis il y a dix ans parce que le patron jouait au tennis, de même on se précipite sur les terrains de golf. Activités conformes, réglées sur la vie ordinaire, où le sport devient une obligation, une activité comme il faut à laquelle il devient difficile d’échapper. Lorsque je regarde le visage contracté de certains joggers affublés de leur petit flottant fluo, s’appliquant à souffler en cadence et les yeux rivés sur leur compte-pulsations, je ne peux pas m’empêcher de penser qu’un surmoi féroce les guide, et non le plaisir d’être un dieu. Ce n’est plus une contrainte ludique qui s’exerce ici, mais bien une contrainte sociale, fait social au sens classique que lui a donné la sociologie française.
Ensuite, les loisirs, ou plutôt ce qu’on appelle « les activités de loisir » sont présentées comme un sur-réel, avec les conséquences cauchemardesques que l’on connaît. Allumons la télévision : ce ne sont qu’images parfaites et sans accroc de « glisse » sur l’eau, sur la neige, en parapente, etc. Allez-y, c’est si facile, la nature est si accueillante, etc. Bilan : trois tués en montagne, quatre naufragés, deux personnes percutées par un scooter des mers par week-end, etc. A chaque fois, on apprend que les gens se sont lancés sans entraînement, sans connaissance, sans équipement sérieux, mais avec le look et rien d’autre, en état d’anesthésie dans ce qu’ils croyaient être un rêve, dans ce qu’ils croyaient n’avoir aucune consistance. Et c’est précisément la consistance de ce rêve qui le transforme en cauchemar.
D’une part, les loisirs réintroduisent la contrainte sociale en lieu et place d’une contrainte ludique. D’autre part, les loisirs fabriquent du sur-réel qui tourne mal. Ne serait-ce pas une forme atténuée, feutrée, insidieuse et fragmentaire de ce que Perec nous présente sous forme hyperbolique, aiguë et continue ?
De manière générale, ce roman engage une réflexion sur la position ludique et sur la position esthétique, dans ce qu’elles ont de commun et sur leurs enjeux moraux.
Il s’agit d’une position critique vis-à-vis du réel, en ce sens qu’elle a la capacité de s’extraire du réel ordinaire, mais sans en être séparée radicalement. Le réel est mis à distance, mais on ne peut pas parler d’une évasion, car la présence du réel est maintenue. Le point de fuite s’autorise du réel et ne lui tourne pas le dos. C’est précisément ce qui permet à la position ludique et à la position esthétique de révéler le réel et de constituer du même coup une positon morale.
En effet, si ce point de fuite est constituant aussi bien théoriquement (il me fait savoir qu’il y a du réel, et quel il est en le révélant par le jeu de l’hypothèse) que pratiquement (il rend possible l’appréhension du sujet par lui-même), c’est en vertu de ce rapport paradoxal au réel, qui l’éloigne tout en le constituant
Il suffit pour s’en convaincre de se donner les deux formes possibles d’abolition de ce rapport (ce que fait le roman de Perec) pour produire un effet destructeur à la fois de toute connaissance possible et de toute liberté possible. On les énoncera sous la forme d’une double antithétique ; dans chacun des couples, les deux propositions pourtant antinomiques sont équivalentes quant à leurs effets destructeurs de la liberté.
- Première thèse : « tout est réel, il n’y a pas de fiction possible, rien ne peut être ni supposé ni feint ni rêvé » – autrement dit aucune hypothèse n’est envisageable, le réel ne peut pas se constituer comme réel, il forme le seul horizon possible.
- Première antithèse : « tout est rêvé, il n’y a pas de réel » – autrement dit rien ne peut cliver le champ des impressions qui sont toutes équivalentes, rien ne peut être infirmé ni confirmé, il n’y a pas de proposition falsifiable.
Ces deux formes s’énoncent aussi moralement :
- Seconde thèse : « tout est obligatoire au sens d’une nécessité » : la transgression est impensable et par conséquent la liberté est impossible. La passion qui accompagne cette forme de l’impératif est le désespoir.
- Seconde antithèse : « tout est permis » : mais si rien n’est défendu, on ne peut jamais rien transgresser, la liberté est donc impossible aussi. La passion qui accompagne cette forme est l’ennui.
Ces deux extrémités de l’absolument nécessaire et de l’absolument contingent enserrent le spectre qui constitue le nécessaire en vertu du possible : c’est celui aussi des passions et du piment de la vie ; mais c’est ainsi que Corneille définit, très précisément la gamme du vraisemblable sans laquelle le théâtre est impossible. Il y a deux manières de décourager le spectateur et de rendre la fiction insipide : ne représenter que du nécessaire (on peut tout prévoir, le spectateur désespère), ne représenter que du radicalement contingent (on peut s’attendre à tout, le spectateur s’ennuie). Quant à la version morale de l’impératif totalisant qui abolit la position critique en matière esthétique, elle a été philosophiquement énoncée par Thierry de Duve dans la troisième partie de son ouvrage Au Nom de l’art. Nathalie Heinich en décline les nombreuses varriantes sur le plan du comportement appréhendées par l’examen sociologique, dans Le Triple jeu de l’art contemporain.
Ainsi, et d’une manière générale, la co-présence du réel et du fictif apparaît comme une condition nécessaire de la liberté. Il se pourrait même qu’elle soit suffisante, puisqu’elle permet d’en assurer le degré minimal, celui qui me reste lorsque je suis plongé dans une situation absolument contraignante. Comme le dit Descartes dans une des Lettres à Elisabeth, paraphrasant un célèbre exemple stoïcien : lorsque nous sommes pris dans une situation qui nous prive entièrement de toute marge de manœuvre, il nous reste encore la ressource de feindre que nous soyons au spectacle de nous-même. On le voit, Descartes ne supposait pas un tortionnaire plus rusé encore que son Malin génie, un tortionnaire qui parviendrait à verrouiller tout point de fuite – pire : à faire que le point de fuite lui-même soit un verrou – et par cette forclusion à abolir l’humanité. Mais c’est que Descartes n’a connu ni la guerre mondiale, ni l’univers concentrationnaire, ni plus banalement l’illimitation des moyens de communication, l’omniprésence des loisirs et la transparence de la société à elle-même : il n’avait pas lu Orwell ni Perec ; il vivait encore dans un monde.
© Catherine Kintzler pour la version de 2006 et Presses Universitaires du Septentrion pour la version de 2002
Références bibliographiques
Références utilisées :
Caillois Roger, Les jeux et les hommes, Paris : Gallimard, 1958.
De Duve Thierry, Au nom de l’art, Paris : Minuit, 1989.
Heinich Nathalie, Le Triple jeu de l’art contemporain, Paris : Minuit, 1998.
Koyré Alexandre, Du monde clos à l’univers infini, Paris : PUF, 1962 et Paris : Gallimard, 1973.
Orwell Georges, 1984
Perec Georges, W ou le souvenir d’enfance, Paris : Denoël, 1975 (Paris : Gallimard, 1993).
Regards sur le sport. Hommage à Bernard Jeu, textes réunis par Jean-Marc Silvain et Noureddine Seoudi, Villeneuve d’Ascq : Presses de l’Université de Lille-III, collection Travaux et recherches, 2002.
Rousset David, L’univers concentrationnaire, (1945) Paris : Minuit, 1965.
Textes classiques :
Descartes René, Corresponsance avec Elisabeth, Paris : Garnier-Flammarion, 1994 ; Les Passions de l’âme, Paris : Gallimard, collection Tel, 1988.
Bossuet Jacques Bénigne , Maximes et réflexions sur la comédie, Paris: Anisson, 1694.
Nicole Pierre , Les Imaginaires ou Lettres sur l’hérésie imaginaire, Liége: A. Beyers, 1667. éd. par Laurent Thirouin, Paris : Champion, 1998.
Rousseau Jean-Jacques, Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Paris : Garnier-Flammarion, 1967.
Sur Georges Perec et sur W ou le souvenir d’enfance :
Burgelin Claude, Georges Perec, Paris : Le Seuil, 1988.
Duvignaud Jean, Perec ou la cicatrice, Arles : Actes sud, 1993.
Parcours Perec, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1990 [abondante bibliographie].
Georges Perec, colloque de Cerisy, Paris : POL, 1985.
Philibert Muriel, Kafka et Perec : clôture et lignes de fuite, Fontenay aux Roses : Ecole Normale Supérieure, 1993.
Bellos David, Georges Perec : une vie dans les mots, Paris : Le Seuil, 1994.
Magazine littéraire n°316, déc. 1993, dossier Georges Perec.
Magazine littéraire n°193, mars 1983, dossier G. Perec.
Littératures 7, (Toulouse Le Mirail) printemps 1983, spécial G. Perec.
L’Arc n°76, 1979, spécial Georges Perec.
Misrahi Robert, «W, un roman réflexif», L’Arc n°76, 1979, spécial Georges Perec.
Bouchot Vincent, «L’intertextualité vernienne dans W ou le souvenir d’enfance», Etudes littéraires Québec. XXIII, 1-2, été-automne 1990, 111-120.
Pawlikowska Ewa, «Insertion, recomposition dans W ou le souvenir d’enfance», Penser, classer écrire. De Pascal à Perec; éd. B. Didier et J. Neefs, Saint-Denis : Presses Universitaires de Vincennes, 1990, 171-179.
Stalloni Yves, «Perec. W ou le souvenir d’enfance», L’Ecole des lettres II, LXXXII, 14, juillet 1991, 161-170.
Leak Andy, «W Dans un réseau de lignes entrecroisées», Parcours Perec, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1990.
Magné Bernard, «La textualisation du biographique dans W ou le souvenir d’enfance», Autobiographie et biographie, textes réunis par Mireille Gruber et Arnold Rothe, Paris : Nizet, 1989, 163-184.
W ou le souvenir d’enfance. Une fiction, Séminaire 1986-1987, présentation Marcel Bénabou et Jean-Yves Pouilloux, Textuel 34/44, 21 (1988), Cahiers Georges Perec.
Astro Alan, «Allegory in Perec’s W ou le souvenir d’enfance», Modern Language Notes Baltimore, CII (1987), 867-876.
Gateau Jean-Charles, «Welches, W ou le souvenir d’enfance», dans J. Ch. Gateau Abécédaire critique, Genève : Droz, 1987.
Jacques Bens, OuLiPo 1960-1963, Paris : Christian Bourgois, 1980.
Sur Roger Caillois
Autié Dominique, Approches de Roger Caillois, Toulouse : Privat, 1983.
Bataille Georges, Lettres à Roger Caillois 4 août 1935 – 4 février 1959, présentées et annotées par Jean-Pierre Le Bouler, Romillé : Folle avoine, 1987.
Felgine Odile, Roger Caillois : biographie, Paris : Stock, 1994.
Panoff Michel, Les Frères ennemis : Roger Caillois et Claude Lévi-Strauss, Paris : Payot, 1993.
Roger Caillois : la pensée aventurée, éd. Laurent Jenny, Paris : Belin, 1992.