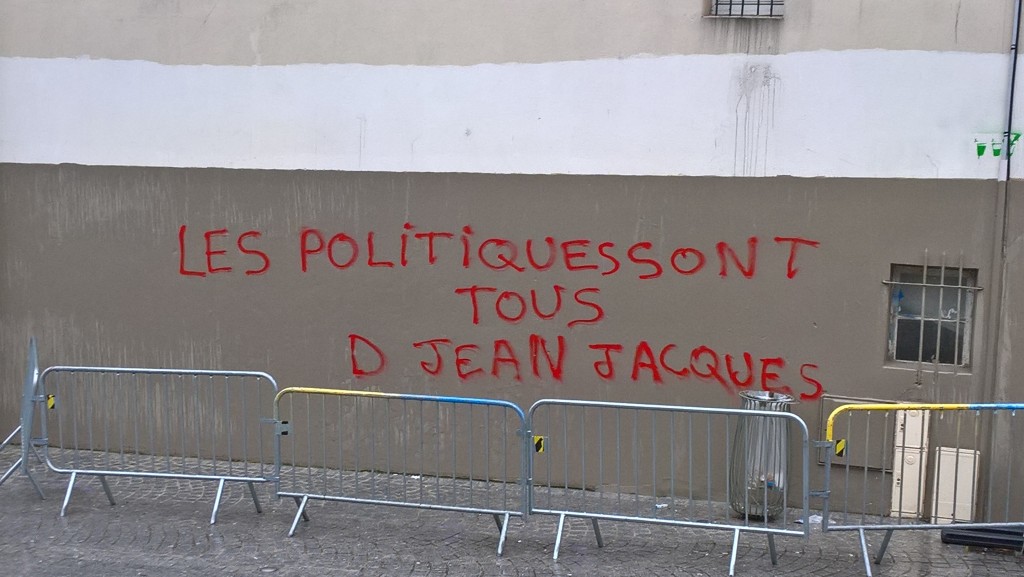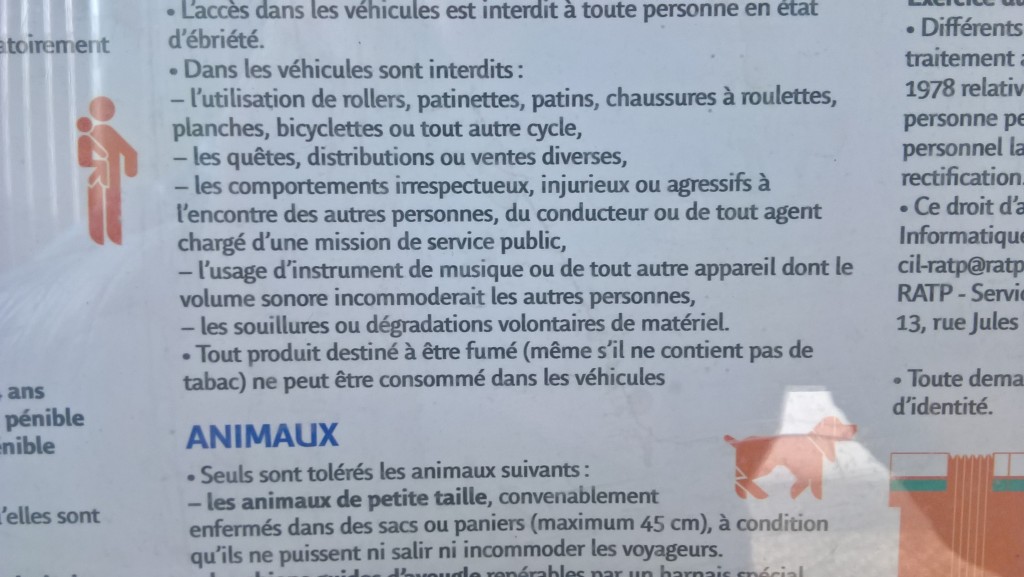Selon une lecture couramment admise, le texte de Baudelaire « De l’essence du rire » marquerait une découverte qui nous aurait délivrés de la vision classique du rire, marquée par la morale et la théologie. En inventant la figure du rire absolu, Baudelaire aurait libéré le rire du soupçon de malignité. On s’attache à montrer que cette lecture est discutable, et que la figure romantique du rire ne s’oppose pas absolument à la figure classique, mais qu’elle s’intéresse à l’aspect cosmologique du rire.
Nombre d’études contemporaines sur le rire et le comique prennent appui sur le texte de Baudelaire « De l’essence du rire »1 pour disjoindre fortement deux formes de comique : d’un côté le comique relatif auquel correspond la vision classique du rire, de l’autre le comique absolu qui correspond à sa vision romantique. Cette disjonction est bien présente dans le texte de Baudelaire, mais les commentateurs dont je fais état ici2 lui donnent un caractère radical et en font de plus un usage qui excède le propos baudelairien. En effet, selon eux, ce texte de Baudelaire marquerait une découverte qui nous aurait délivrés d’une interprétation morale du rire. Toujours selon ces commentateurs, la vision classique du rire perpétue la référence théologique qui fait du rire un phénomène malveillant à placer sous contrôle et, en découvrant le rire « innocent », les romantiques déverrouillent ce phénomène et nous libèrent de la vision classique moralisatrice. De plus, la vision classique est fortement intellectualisée et rationnelle ce qui, aux yeux des mêmes commentateurs, aggrave son cas.
Je noircis à peine le tableau, voici par exemple ce qu’écrit D. Grojnowski :
« Les théories du rire et les pratiques du comique ont incité à reconduire les postulats de la dégradation […], les dogmes du monothéisme et ceux de la poétique classique s’accordent pour illustrer les espèces de la déchéance […]. Il a fallu parvenir à concevoir le comique comme expression positive, instauration de joie, pour que le sujet s’accomplisse sans qu’il doive fournir d’alibi et sans que l’oppresse la mauvaise conscience. Rompant avec la malédiction originelle, le comique innocent de Hoffmann, auquel Baudelaire rend hommage, comme l’ironisme d’affirmation cher au Marchand de Sel de Duchamp, célèbrent la drôlerie à des fins de délectation. » [op. cit. , p. 12]
On peut encore citer la présentation du texte de Baudelaire par Véronique Sternberg-Greiner dans le recueil Le Comique 3.
« Le poète distingue en effet le comique « significatif » du comique « absolu », le premier apparaissant comme une forme quelque peu étriquée, qui se limite au rationnel et tend vers la mesquinerie. Forme doublement limitée donc : sur un plan esthétique, puisqu’elle n’ouvre pas sur l’infini et l’indicible ; sur un plan éthique, puisqu’elle fait du rieur un être condescendant. Le comique absolu entretient une relation moins immédiate, mais plus profonde, au sens. Celui-ci n’est pas le vecteur qui autorise sa perception : le comique absolu ne se comprend pas, il se perçoit, il est saisi grâce à l’intuition. Mais il ouvre sur l’infini par le vertige qu’il procure. A l’inverse des certitudes que délivre le comique significatif, le comique absolu ébranle le récepteur par la violence de son expression, lui donne à voir un monde fantastique qu’il ne peut maîtriser par une appréhension rationnelle – on retrouve ce principe de réception chez Ionesco. Le comique absolu, c’est le grotesque et le sublime de Hugo réunis : « une espèce une, et qui veut être saisie par intuition », dit Baudelaire dès le début de son analyse. » [p. 197]
Bien qu’elle prétende dénoncer une « vision morale du monde » – ou plutôt à cause de cela -, cette thèse relève elle-même d’une vision morale conventionnelle répandue à la fin du XXe siècle.
Je m’attacherai à montrer l’insuffisance de cette interprétation pour la lecture même du texte de Baudelaire. En effet, comme d’autres commentateurs plus attentifs l’ont vu4, Baudelaire n’accorde pas à la disjonction comique relatif / comique absolu un caractère radical ou primitif. Il se montre ainsi plus proche qu’il n’y paraît de la thèse classique, et cela rend son texte sinon contradictoire, du moins problématique et aporétique.
Je soutiendrai qu’on peut expliquer cette aporie. Car la découverte baudelairienne ne porte en aucune manière sur l’idée d’un « rire innocent » – forme que les classiques connaissaient. Elle est d’une autre nature et n’a pas les conséquences moralisatrices que certains commentateurs croient pouvoir en tirer. Mais pour en mesurer pleinement la portée, il faut, en allant au-delà du texte de Baudelaire, déployer plus avant la théorie classique du rire qui ne trouve sa pleine dimension que dans les textes de Freud Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient et L’inquiétante étrangeté5. C’est seulement une fois ce détour effectué que l’on peut comprendre pourquoi le texte baudelairien est si problématique.
1 – Rire innocent et rire classique : une opposition trop facile
Tout d’abord, comment peut-on expliquer l’interprétation couramment admise ? Les partisans d’une disjonction radicale entre comique relatif et comique absolu (rire classique et rire moderne) raisonnent en plaçant le texte de Baudelaire en face d’un autre texte que Baudelaire ne cite pas mais auquel il fait clairement allusion : c’est le célèbre texte de Hobbes, chapitre 13 de l’ouvrage De la nature humaine, qui caractérise le rire en termes de « supériorité », texte emblématique de la position classique sur le rire. Et comme Baudelaire semble dans la seconde partie de son texte introduire une autre conception du rire, une forme de rire non relatif issu d’un « comique absolu », il en résulte une sorte de polarité : Baudelaire apparaît comme un anti-Hobbes.
Dans les anthologies sur le rire, Hobbes et Baudelaire forment alors une sorte de vulgate, deux piliers opposés et il semble qu’il soit fait un usage non critique des deux textes.
Pour appuyer le concept de « comique relatif », Baudelaire fait état en effet de la thèse de la « supériorité », laquelle est connue pour avoir été exposée par Hobbes6. Il semble que Baudelaire ait en réalité emprunté cette référence et la caractérisation comme « thèse de la supériorité » à un ouvrage de Paul Scudo, Philosophie du rire (Paris : Porrée, 1840), où l’on trouve les lignes suivantes, définition du rire comme phénomène relatif p. 124 :
« [le rire] est provoqué par la vue d’une imperfection dont nous nous croyons exempts ; en riant nous manifestons notre supériorité relative, et nous blessons l’amour-propre des autres. On rit toujours aux dépens de quelqu’un. »
Mais si la référence à Hobbes est juste, elle est loin d’épuiser et de caractériser la position classique sur le rire. Il convient de l’inscrire dans un ensemble plus large et de ne pas s’en tenir à ce simple résumé. En effet, la théorie de la « supériorité » n’est qu’une façon particulière de définir la « relativité » du rire, caractéristique de la vision classique. Pour s’en tenir uniquement aux grands textes du XVIIe siècle, il faudrait remonter aussi au traité des Passions de l’âme de Descartes et aux livres III et IV de l’Ethique de Spinoza7. Un examen attentif de ces grandes sources montre que les théories classiques du rire, loin de se réduire à une seule idée, celle de « supériorité », convergent sur les cinq points suivants :
- La constitution du rieur comme « point d’exception » libre – ou qui se croit tel, à tort ou à raison – d’où la thèse de la « supériorité », mais celle-ci en est la forme maximale et vulgaire, qui permet d’introduire la référence théologique alors que la forme minimale et suffisante – qu’on trouve par ex. chez Descartes – celle de l’exemption, ne la requiert pas.
- La mise en relation des différentes formes de rire et des différentes « espèces » de rieur de façon continue, par des séquences qui permettent de passer sans rupture d’une forme à l’autre. Il n’y a pas de figures absolument disjonctives.
- L’observation de phénomènes de symétrie qui, à l’examen, apparaissent comme des phénomènes de conversion ou de réversibilité, ce qui s’accorde avec le point précédent : rire / larmes ; moquerie / pitié ; comique / tragique.
- Un mécanisme explicatif (aussi bien du rire que des phénomènes de conversion) qui met en jeu une économie des passions : le rire, analysé de façon complète, repose sur la récupération d’une énergie qu’on aurait pu croire à la charge du sujet. Tout se passe comme si l’énergie dépensée passait, dans une comptabilité passionnelle, de la colonne « débit » à la colonne « crédit » : c’est parce que « cela aurait pu être pénible » qu’on rit.
- On en déduit la nécessité d’une position suspensive, puisque le rire suppose l’émission fictive d’une hypothèse. Le rieur est toujours en état « esthétique » de fiction.
À la lumière de ce rapide descriptif, on voit que tous ces éléments : charge possible permettant le rire de décharge, position suspensive, réversibilité, continuité, constitution d’un « point d’exception », supposent une référence qui sert de point d’appui. Le rire est toujours fondé ici sur une forme de relation. Il est donc juste de caractériser la position classique par la relativité ou même la réactivité. En revanche, et ce point doit retenir toute notre attention, la relativité classique n’est pas toujours accompagnée d’une tonalité théologique faisant du rire une manifestation maligne entraînant une condamnation morale. C’est ici que l’emploi du terme « supériorité » forme obstacle en ce sens qu’il véhicule une idée superflue du point de vue théorique.
Enfin, à considérer ces caractéristiques et si l’on veut prendre au sérieux le caractère surabondant de la thèse théologique, il est légitime d’étendre le champ des théories classiques du rire au-delà de leur apparente solidarité chronologique et d’y inclure des théoriciens ultérieurs, notamment Bergson et surtout Freud qui donnera à la théorie économique sa forme « classique » achevée, à savoir l’idée d’une récupération d’énergie sous forme de « cadeau »8. La thèse principale du Mot d’esprit est celle du rire de décharge : une dépense d’énergie psychique est épargnée, l’énergie ainsi désinvestie est libérée, ce qui produit le rire, et Freud en tire une classification générale :
« Le plaisir du mot d’esprit nous a semblé provenir de l’économie d’une dépense d’inhibition, celui du comique de l’économie d’une dépense (d’investissement) de représentation, et celui de l’humour de l’économie d’une dépense de sentiment. » [p. 411 Le Mot d’esprit]
Donc l’usage non critiqué de la référence usuelle à Hobbes conduit à une vision des théories classiques à la fois trop étroite (elle manque le point explicatif fondamental et s’en tient à une version strictement chronologique du classicisme) et trop large (elle conduit à « moraliser » hâtivement la thèse en la rabattant sur la théologisation qui l’accompagne parfois mais qui la fausse). Il semble que le terme reçu de « supériorité » fonctionne comme un obstacle épistémologique.
2 – Le rire relatif comme concept premier
En outre, à la lecture du texte de Baudelaire, on peut s’interroger sur deux points, eux aussi couramment admis et peut-être un peu trop hâtivement.
D’abord, on peut se demander si l’idée d’un rire absolu, non réactif, est une découverte romantique et si c’est la véritable nouveauté du texte de Baudelaire. L’idée d’un rire sans référent, sans moteur comparatif, n’est pas étrangère aux classiques. Bien sûr on peut citer la célèbre distinction entre la joie, le rire et la raillerie telle qu’on la trouve chez Descartes et aussi chez Spinoza – et que Baudelaire reprend dans son texte. Mais même si on la laisse de côté du fait que la joie n’est pas nécessairement accompagnée du rire, l’idée d’un rieur « total » existe bien dans le traité des Passions de l’âme – un « brutal », si on utilise le vocabulaire cartésien, qui rirait de tout et à propos de tout (et qui ne serait pas très loin de sa figure symétrique, un désespéré absolu qui serait entièrement livré à une déploration infinie et à une dépression totale). Cette idée d’un rire apparemment sans référence, apparemment dégagé de toute relation, existe, elle n’est pas nouvelle, mais les classiques n’en font pas une idée première dans l’ordre de l’explication : on peut montrer qu’ils rattachent au contraire cette apparente absence de moteur comparatif à un dérèglement de ce moteur qui conduit à son effacement ; c’est en quelque sorte une forme pathologique du rire, une forme hyperbolique qui, pour être comprise, suppose le principe de la forme comparative du rire. Ce « brutal » qui rirait de tout et à propos de tout (ou ce dieu au rire inextinguible) serait plutôt un idiot qui ne sait pas régler sa propre subjectivité par une juste distance par rapport à autrui, de sorte que le rieur absolu n’est autre qu’un rieur qui se croit à tort absolu.
Ce qu’ont très bien vu les classiques et en particulier Descartes, c’est que le rire accompagne toujours un affect qui aurait pu nous être à charge, réelle ou supposée. Et à partir de là on peut expliquer toutes les formes de rire, du rire idiot des dieux et des brutaux (qui s’imaginent que rien ne peut leur être à charge) au rire de défense (qui proteste bruyamment d’une force qu’on n’a pas), du rire sardonique du malin (qui se prend pour un dieu) ou grinçant du disgracié (qui est « bien aise » de voir un autre aussi faible que lui), au rire de « raillerie honnête » dont le généreux n’a pas de raison d’être avare, car le rire est, comme la générosité, comme la conscience qu’on a d’être un sujet libre, frappé par le sentiment d’une défaillance possible. La force du généreux chez Descartes vient de ce qu’il situe correctement sa propre défaillance – un peu comme l’athlète réussit son geste précisément parce qu’il sait qu’il peut le manquer et qu’il sait utiliser ce savoir et le transformer en puissance9.
Donc la thèse d’une méconnaissance du « rire absolu » ou d’un rire non réactif par les classiques, si on l’examine de près, doit être corrigée et affinée : ce qui est juste, ce n’est pas que les classiques rejettent le rire absolu ou qu’ils lui sont aveugles, c’est qu’ils pensent que la notion de rire absolu n’est pas absolue, qu’il s’agit d’une forme dérivée du rire relatif. Pour eux il n’y a pas de disjonction, seul le rire relatif est radical, premier dans l’ordre de l’explication, et ce que nous prenons pour le rire absolu en est dérivé.
Ce premier examen permet de montrer que Baudelaire n’est pas aussi éloigné de la thèse classique qu’on a bien voulu le croire.
En effet, la disjonction entre le comique relatif et le comique absolu n’a pas elle-même un caractère absolu dans le texte « De l’essence du rire ». Il n’est même pas certain qu’il s’agisse stricto sensu d’une disjonction puisque Baudelaire, en reprenant la distinction classique entre joie et rire, et aussi en récrivant le mythe de Paul et Virginie, accorde au rire une existence seconde, dérivée. Dans une perspective qu’on pourrait qualifier de rousseauiste (y compris par sa mise en scène, dont le théâtre ambivalent est Paris), le rire a pour condition de possibilité le déverrouillage de l’humanité, le passage par le moment irréversible de civilité qui, en lui faisant faire des comparaisons, l’introduit pour jamais dans l’ordre de la moralité, du bien et du mal. « Pépin contenu dans la pomme symbolique », le rire signe l’entrée dans une humanité déchue c’est-à-dire humanisée, pour le meilleur et pour le pire. Donc si le rire est primordial en ce sens qu’il relève de l’inauguration d’un ordre humain qui s’installe dans la rupture, il n’est pas pour autant primitif. Il n’est pas une idée simple, mais il appartient au domaine des rapports, des modalités, et non à celui de la substance, de l’absolu. Et la suite du texte le confirme : la « loi primordiale du rire » est sa forme fondamentalement comparative, relative, duplice, comme en témoigne l’exemple du rire de Melmoth. Et même après ce qu’on pourrait appeler le tournant du texte, qui conduit Baudelaire à examiner le comique absolu (sur lequel on reviendra dans un instant), l’auteur prend soin de préciser :
« J’ai dit : comique absolu ; il faut toutefois prendre garde. Au point de vue de l’absolu définitif, il n’y a plus que la joie. Le comique ne peut être absolu que relativement à l’humanité déchue, et c’est ainsi que je l’entends »10.
3 – Le tournant du texte « De l’essence du rire »
Voilà qui rend le texte difficile, problématique.
Car il y a bien un tournant dans le texte « De l’essence du rire », qui amène Baudelaire à parler de « comique absolu ». Il en donne une définition qui se présente explicitement comme nominale : « J’appellerai désormais le grotesque comique absolu ». Notons aussi qu’il ne s’agit pas du rire, mais d’une forme de comique, laquelle est cause du rire. La thèse fondamentale est cependant maintenue : il n’y a de rire que relatif.
Mais, et c’est ici que se situe la découverte théorique de Baudelaire, « il y a un cas où la question est plus compliquée » (§ V), c’est celui du grotesque. Pourquoi ? Pour deux raisons qui se rejoignent, ces deux raisons se présentent comme des observations.
1° D’abord parce que le grotesque cause un rire ayant toutes les apparences d’un rire absolu. On ne peut pas le rapporter immédiatement à l’origine fondamentalement morale qui est celle du rire tel qu’il a été jusqu’alors considéré : le point de comparaison se dérobe. Dans le rire produit par le grotesque, on cherche en vain la présence réelle ou supposée d’autrui, d’un autre réel ou fictif qui servirait de référence et aux dépens de qui on rirait. On n’est plus, du moins en apparence, dans un monde humanisé fait de comparaisons. Cette phénoménologie du rire issu du grotesque fait qu’on est tenté d’y voir un rire absolu, qui aurait en soi
« […] quelque chose de profond, d’axiomatique et de primitif qui se rapproche beaucoup plus de la vie innocente et de la joie absolue que le rire causé par le comique de mœurs. »
Mais c’est bien une phénoménologie, que Baudelaire présente comme telle : elle invite à une disjonction entre rire relatif et rire absolu, mais cette disjonction elle-même reste descriptive et renvoie à un foyer explicatif qui reste inchangé, même si cette explication par la relativité, précise Baudelaire, « […] paraît tirée de loin et quelque peu difficile à admettre […] »
Et si cette explication paraît difficile, c’est justement à cause de l’évidence d’un caractère primitif du rire issu du grotesque : on ne peut mieux dire qu’il s’agit là d’une évidence d’immédiateté, et non d’une évidence de vérité.
2° D’où la seconde raison, elle aussi tirée de l’observation, qui rend le cas du grotesque difficile et intéressant : cette apparente absence de référence invitant à récuser toute relativité, rend le grotesque quantitativement remarquable. C’est un rire énorme au sens strict du terme : la quantité esthétique, inappréciable, y évince la quantité mathématique mesurable issue de la comparaison. C’est cette « essence très élevée » qui fait la prédilection des romantiques pour cette espèce de rire, lequel ne peut être saisi que globalement, intuitivement, alors que le rire issu du comique relatif est lui-même susceptible de degrés et se saisit discursivement, rationnellement au sens où ratio veut dire calcul et possibilité de rapports. L’irrationalité du rire issu du grotesque est donc avérée, mais elle n’a pas le caractère vulgaire que lui accordent les commentateurs d’aujourd’hui ; il s’agit d’une irrationalité d’appréhension par le rieur lui-même, et nullement d’une irrationalité qui le rendrait réfractaire à toute théorisation. Le rire issu du grotesque est irrationnel en ce sens strict qu’il ne trouve pas de mesure permettant de l’analyser en fractions, comme un nombre irrationnel ne peut pas être rapporté à un autre. En revanche, on ne peut pas en tirer argument pour dire qu’on ne peut pas en rendre raison : il ne faut pas confondre irrationalité d’un objet et impossibilité de sa théorie.
La thèse d’un rire fondamentalement relatif n’est cependant pas abandonnée par Baudelaire : il faut non pas la compliquer, mais la rendre plus profonde pour lui faire rendre tout son pouvoir explicatif. Autrement dit, la considération du seul comique relatif dans le monde humanisé voué par définition aux comparaisons a quelque chose de trop superficiel ou même de redondant et manque, par son évidence même, l’ampleur d’une théorie de la relativité du rire. Pour que la théorie de la relativité du rire soit portée à sa pleine puissance, il faut qu’elle puisse expliquer aussi le fait que nous observons un rire qui se présente comme absolu – de même que par exemple en astronomie l’héliocentrisme n’atteint son point de vérité que parce qu’il explique le géocentrisme. La force d’une hypothèse juste est non seulement d’expliquer les phénomènes, mais aussi d’expliquer ceux qui lui semblent contraires ainsi que les théories qui la précèdent.
4 – Du moral au naturel
Baudelaire maintient la thèse en effectuant un déplacement du point de comparaison qui soutient la relativité du rire : celui-ci, de moral dans le comique relatif (ou comique de signification), est devenu naturel dans le comique absolu. Le jugement fondateur du rire ne s’appuie plus sur une relation à l’humanité, mais s’élargit dans une relation à la nature.
Le déplacement esthétique observable dans le comique issu du grotesque et qui lui donne une apparence absolue a donc pour motif un déplacement du moral au cosmologique : pour en rendre compte, il faut passer d’une métaphysique des mœurs à une métaphysique de la nature. Telle est à mon sens la découverte de Baudelaire.
Mais cette découverte, loin de le séparer des théories classiques du rire, l’y inclut encore davantage, et cette fois, ce n’est plus au classicisme chronologique qu’il faut le comparer, mais au classicisme théorique qui trouve son plein épanouissement dans la théorie freudienne non seulement du mot d’esprit mais aussi de l’inquiétante étrangeté.
La découverte romantique (ici intervient la célèbre référence à Hoffmann et à Théophile Gautier) n’est donc pas tant celle d’une nouvelle structure du rire que celle d’un déplacement d’accent, lequel effectivement découvre un champ jusqu’alors négligé dont Baudelaire donne la clé en proposant une articulation très simple.
Le comique relatif (ou encore « significatif ») évolue dans le monde moral et fait porter l’opération fondamentale de relation (comparaison) d’homme à homme. Le comique « absolu » (que je proposerai d’appeler « cosmologique ») déplace l’opération ordinaire de relation d’homme à homme vers un rapport extraordinaire de l’homme à la nature. Mais la structure fondamentale reste la même : le moment constitutif du rieur se pense comme un moment de comparaison où le sujet se saisit hypothétiquement ou fictivement comme point d’exception : « moi, je suis à l’extérieur ; moi, je vois ; moi, je ne suis pas cela ». Notons que dans ce moment, essentiellement fictif, le rieur n’est pas la dupe de sa propre suspension : il ne peut précisément se constituer comme exception que sous la condition de son inclusion possible dans la situation – « moi, je ne suis pas cela : mais je ne peux le penser que parce que je pourrais l’être ». Baudelaire n’analyse pas le détail de ce mécanisme (qu’il aperçoit en soulignant la corrélation nécessaire entre supériorité et imperfection), mais ce mécanisme est parfaitement identifié par les classiques et mis en lumière par le Descartes des Passions de l’âme. Ce mécanisme suppose en effet que la distance prise par rapport à autrui dans le comique moral est sous la condition d’une identification hypothétique à l’objet moqué, et son caractère paradoxal explique parfaitement les phénomènes de symétrie et de conversion entre rire et larmes, rire et pitié, etc. – il a été analysé ultérieurement par Rousseau dans sa théorie de la pitié11, et ramené à son essence comique dans la théorie de la comparaison que Hegel développe dans son Esthétique12.
Une première réflexion peut déjà être faite, mais elle est incidente par rapport à notre sujet et c’est pourquoi je ne la développerai pas ici, me contentant de la signaler pour l’abandonner. En ramenant la notion de comique absolu à la référence naturelle qu’il place en quelque sorte en face de la référence humaine spécifique au comique moral, Baudelaire ne se contente pas de compléter, par une sorte de symétrie, la théorie du rire relatif. Car si nous traduisons cette opération de complément en philosophème, nous constatons qu’elle rencontre deux des grands axes de la métaphysique classique, et il nous suffit d’oser prononcer leurs noms usuels dans la tradition philosophique pour voir se déployer le champ tout entier : à une métaphysique des mœurs, il faut ajouter une métaphysique de la nature, ou en termes kantiens, à la psychologie rationnelle il faut ajouter la cosmologie rationnelle. Le recours à la théorie critique transcendantale est du reste grandement justifié : car ces deux métaphysiques du rieur sont elles-mêmes critiques, en ce sens qu’elles ne s’abusent pas sur le caractère réel de la position d’exception qu’elles ne constituent que fictivement. En maintenant le caractère essentiellement relatif du rire, elles restent dans l’ordre de l’expérience possible et font de l’inclusion dans le monde la condition de l’exception qui reste toujours hypothétique. En d’autres termes, la théorie du rire relatif soutient que l’arroseur peut toujours être arrosé et que le rieur ne peut rire que parce que précisément il se pense aussi comme objet possible de dérision.
Enfin pour que le champ ainsi rencontré soit complet, il faut aussi se demander s’il y a une ontologie, ou encore une théologie rationnelle. Et alors on voit bien que cette ontologie et cette théologie rationnelle sont le point visé par une théorie du rire absolu, laquelle prétend porter le jugement comique « je ne suis pas inclus là-dedans » à son moment dogmatique, comme si le point d’exception pouvait être atteint réellement, comme si on pouvait, en réitérant le jugement relatif, accéder à une position qui ne l’est plus, comme s’il pouvait y avoir réellement un « dernier rieur », qui pourrait rire de tout sans jamais risquer de devenir lui-même objet de dérision. On peut bien en avoir l’Idée, mais on ne peut pas se le donner dans une expérience ni réelle ni possible. Voilà pourquoi je soutiendrai que la thèse du rire absolu est à la théorie du rire ce que l’illusion transcendantale est à la métaphysique. Le rire absolu est une Idée de la raison, mais personne ne peut en construire l’expérience.
Il reste une question à éclaircir dans l’opération baudelairienne qui fait du grotesque un comique apparemment absolu parce que référencé à la nature. L’explication que donne Baudelaire reste tout de même bien vague et bien succincte :
« […] l’orgueil humain, qui prend toujours le dessus, est que la cause naturelle du rire dans le cas du comique, devient aussi cause naturelle du rire dans le cas du grotesque, qui est une création mêlée d’une certaine faculté imitatrice d’éléments préexistants dans la nature. Je veux dire que dans ce cas-là le rire est l’expression de l’idée de supériorité, non plus de l’homme sur l’homme, mais de l’homme sur la nature. » (§ V)
Supériorité de l’homme sur la nature : en quoi cette caractérisation serait-elle spécifique à une forme de comique ? Ne pouvons-nous pas aussi y voir une sorte de définition morale du sublime tel qu’il a été installé par la tradition post-classique initiée par Burke et continuée par le Kant de la Troisième critique ? N’oublions pas que le mécanisme du jugement qui conduit au sublime est lui-même paradoxal dans sa relativité : c’est précisément la pénibilité d’une situation qui, par un effet de retour dans une comparaison fondée sur une inadéquation et une impuissance, explose vers l’idée d’un « absolument grand ». Le comique cosmologique serait donc lié à cette joie du sublime, et on devrait peut-être y voir un de ces phénomènes de réversibilité ou de conversion dont nous avons parlé plus haut. Du reste les théoriciens classiques du sublime, antérieurs à Burke, ceux qui s’inspirent de Longin, font maintes fois remarquer la réversibilité entre le sublime et le comique, ce dernier étant souvent fondé sur une sorte de sublime raté…
Quoi qu’il en soit, cette série de remarques ne lève pas la question de savoir comment un moment cosmologique peut être source de comique – car, comme c’est le cas dans le sublime, même lorsqu’il est source de joie, il y a là une dimension grandiose d’effroi, de dépassement. Se sentir dépassé, puis se sentir grandi par ce dépassement même et les effets de réflexion qu’il produit : le mécanisme du sublime est l’exact inverse du mécanisme du ridicule. Comment la nature pourrait-elle être ridicule alors qu’elle me renvoie la plupart du temps, même dans le moindre de ses fragments, à ma propre insuffisance ? Ou plutôt : y a-t-il une manière de traiter la nature de telle sorte qu’au lieu de me renvoyer à mon insuffisance, elle indique ma puissance ? Ou encore, de manière plus générale : comment la référence à la nature peut-elle être constitutive du comique ? Cela permettrait de donner à une étrange expression française, prise à la lettre, toute sa dimension cosmologique: « se moquer du monde ». La réponse de Baudelaire reste énigmatique : cela s’effectue dans le grotesque. Il faut alors se tourner vers les exemples pour espérer y voir un peu plus clair, et dans ces exemples, deux séries coexistent : la référence à Hoffmann et celle à la comédie-ballet, mais seule la première a été semble-t-il prise au sérieux.
5 – La dimension cosmologique et l’Inquiétante étrangeté : comment on peut « se moquer du monde »
Je prendrai appui d’abord sur cette célèbre référence à Hoffmann, mais je la tiendrai à distance et au lieu de l’analyser et de l’affronter directement, je me laisserai aller à une « libre » association d’idées et je la prendrai pour ainsi dire à revers. Car un autre théoricien du rire utilise la référence à Hoffmann de façon insistante, il s’agit de Freud dans L’Inquiétante étrangeté13. Le texte de Freud répond de manière précise à notre attente, puisqu’il relie explicitement, en les rattachant à un foyer explicatif commun mais moyennant une variation, deux phénomènes à la fois opposés et symétriques, qui apparaissent alors sous la forme d’un retournement ou d’une conversion entre l’inquiétude et le comique.
Je ne parcourrai pas ici les détails de la théorie de la familière étrangeté, me contentant seulement d’en rappeler des thèses principales.
Freud commence par une étude de lexique assez laborieuse, d’où il résulte une ambivalence entre les termes allemands heimlich (familier) et unheimlich (étrange), une sorte de va-et-vient dans la langue qui établit une sorte de continuité paradoxale : le champ ainsi désigné est à la fois celui du familier, de l’intime, et celui du caché, du secret.
C’est alors qu’il passe à l’étude des exemples, dont la plupart sont tirés d’Hoffmann – celui de la Poupée Olympia, celui de « L’homme au sable » – mais aussi de Schiller et de Mark Twain. Les chaînes signifiantes sont longuement analysées (ainsi celle qui permet d’établir la coïncidence entre l’angoisse oculaire et le complexe de castration) et aboutissent à une hypothèse générale : un refoulé fait retour, ce qui produit l’impression ambivalente de secret, de familiarité et d’effroi.
Le sentiment de malaise tient en grande partie au fait que l’étrange n’est pas réductible à l’univers ordinaire, mais qu’il n’est pas non plus complètement étranger. C’est précisément cette ambivalence qui, en faisant basculer l’univers familier ou ordinaire du côté de l’étrange et de l’extraordinaire, produit le sentiment d’effroi : un élément vient en quelque sorte trouer l’ordinaire et l’infléchir, sans cependant le faire totalement basculer dans un autre monde14. Par exemple, je me perds dans ma propre chambre plongée dans l’obscurité : le sentiment de l’étrange vient d’une forme de perversion de l’univers ordinaire. Freud lui attribue deux sources : le retour du refoulé et le retour de croyances anciennes que nous croyions abandonnées mais qui restent à l’affût et réapparaissent dans ces occasions de vacillation. Ainsi en va-t-il de l’animisme – croyance que les choses peuvent s’animer et se conduire intentionnellement – ou de son inverse – croyance que les êtres animés sont changés en choses.
Mais Freud introduit ensuite un problème sous la forme d’une objection : il y a de grandes différences entre l’étrange vécu dans la réalité et celui qui est proposé dans la fiction littéraire. Il se peut que ce qui nous semblerait étrange dans la vie ne le soit plus dans la fiction et inversement. Freud donne l’exemple du thème de la main coupée. Voici son explication : l’étrange disparaît si l’auteur de la fiction en fait un élément d’un univers autonome. Une main coupée dans la vie est horrible et étrange. Mais si on élabore un monde fictif dans lequel ce genre de chose est normal, alors l’effet d’étrangeté disparaît pour faire place à un effet d’émerveillement ou à un effet « irrésistiblement comique » – ce sont les termes de Freud pour qualifier une scène dans A Tramp Abroad de Mark Twain.
Il convient donc de distinguer entre l’étrange vécu et l’étrange de la fiction : c’est ce dernier seul qui peut se retourner pour devenir comique et provoquer le rire. L’explication fournie par Freud est simple. L’effet d’inquiétante étrangeté est aboli chaque fois que l’auteur réussit à former la fiction d’un monde à part, dans lequel il y a une espèce de vraisemblance à ce que de tels phénomènes se produisent, à construire une cosmologie de supposition dans laquelle le normal inclut ce qui serait totalement anormal ou extraordinaire dans notre monde. En revanche, l’effet d’inquiétude est produit lorsque l’auteur reste au plus près de notre monde réel et réussit à nous faire douter que nous sommes en présence d’une fiction.
Nous voici donc ramenés au point d’intersection entre le rire et la question cosmologique évoquée à propos du grotesque vu par Baudelaire. Produire un monde qui a sa propre unité : voilà ce que fait l’auteur de fiction lorsqu’il nous entraîne, avec notre consentement, dans l’ordre littéraire. La nature est alors traitée comme un cas particulier au sein d’autres natures possibles : la fiction est capable, telle un démiurge, de nous faire envisager sans crainte une sorte de surnature et ce qui s’y produit, quelque effrayant, violent ou cruel que ce soit, nous apparaît sous cette dimension d’extériorité qui fait que nous le contemplons et y consentons à peu de frais puisque nous n’y sommes pas engagés, d’où un effet comique. Il suffirait que ce monde puisse infiltrer le nôtre, puisse avoir une valence réelle pour que ce sentiment comique se renverse et bascule dans l’effroi. Il y a comique du fait qu’un affect produit par ce qui pourrait être inquiétant est désinvesti et récupéré au profit du sujet. Il y a effroi dès que l’affect produit par ce qui est inquiétant est réinvesti réellement et il ne peut l’être qu’aux dépens du sujet. La comptabilité classique, telle qu’elle a été mise au point par Freud sans son Mot d’esprit s’applique très clairement ici. La modification est de modalité : il y a conversion dès que l’on passe de l’indicatif au conditionnel.
On ne peut mieux dire que c’est le coefficient de réalité qui fait obstacle au comique en réinvestissant l’affect, et que c’est au contraire le coefficient de fiction, la possibilité de l’attitude suspensive, qui permet la libération de l’énergie. On peut prendre l’exemple du pantin, et parallèlement celui du clown qui imite le pantin. Si le pantin est drôle, c’est que je ne peux pas croire qu’il puisse manifester un pouvoir occulte, et le clown n’est drôle lorsqu’il se transforme en pantin que parce que je sais que la situation est momentanément suspendue par la fiction : le clown est dans la « bulle » de la représentation à laquelle je sais que j’assiste. Si cette mécanisation se prolongeait suffisamment, elle aurait pour effet de prendre une coloration réelle, de s’insérer vraiment dans ma réalité ou du moins d’introduire le doute à ce sujet, et elle deviendrait alors inquiétante. C’est ce qu’on peut observer facilement sur de jeunes enfants qui rient d’abord lorsqu’on imite un mannequin, mais qui sont très vite effrayés si le jeu se prolonge. D’où le succès du thème de l’androïde dans les films d’anticipation : le sentiment de l’étrange s’introduit dès que le doute apparaît et qu’il est maintenu – un être humain pourrait être une chose / une chose pourrait avoir des propriétés humaines.
6 – L’exemption et l’étrange, clefs du merveilleux, du sublime et du comique
Ainsi nous pouvons rassembler les pièces de ce qui apparaît maintenant de manière systématique. Le texte de Baudelaire, par le biais du grotesque et la référence à Hoffmann, nous a conduits au texte de Freud qui permet d’unifier complètement l’esthétique du merveilleux, celle du sublime et celle du comique en les articulant très simplement à la catégorie de l’étrange (qui peut aussi se dire « surnature ») et ses diverses modalités selon qu’elle est réalisée ou fictive.
Dans le comique, une liaison se constitue en général contre toute attente sous les yeux du rieur qui lui-même se perçoit comme exempt de cette liaison et comme point d’effectuation de la saisie de cette liaison. Dans le comique « significatif » ou moral, la liaison se fait par le bas, par réduction au monde ordinaire, d’où le sentiment de « supériorité » ou d’exemption du rieur qui procède à cette réduction dont il se croit à tort ou à raison le maître : « ce n’était que cela », c’est le sentiment du ridicule. Dans le comique « cosmologique » ou grotesque, la liaison s’effectue par le haut, par constitution d’un monde fictif, surnaturel, mais séparé, ce qui place toujours le rieur en point d’exemption.
Si on prend le cas de l’étrange – surgissement d’un sentiment de lacune dans le monde ordinaire – qui est exemplaire en ce qu’il est discriminant, le comique peut donc traiter l’étrange de deux manières : soit en le réduisant, en le faisant entrer dans le monde commun (d’où le sentiment de soulagement – décharge – et de dérision lorsque nous sortons de notre effroi : ce n’était que cela !), soit en l’élargissant en un monde fictif duquel nous pouvons sortir à volonté (mais si nous pouvons en sortir, c’est que ce monde n’a aucun pouvoir de nous envelopper, et donc c’est que nous sommes d’ores et déjà à l’extérieur, comme lorsque nous sommes au théâtre dont l’intériorité repose uniquement sur un consentement).
L’étrange (le lacunaire) ne fait donc effet d’étrangeté que s’il résiste suffisamment à la réduction à l’ordre commun (il est étranger) et aussi s’il est insuffisant à fonder la constitution d’un ordre distinct, d’un monde séparé (il est proche, familier).
Quant au sublime, il se fonde lui aussi sur un moment lacunaire qui vient « trouer » la nature ordinaire et la faire exploser du côté de l’incommensurable ; mais son traitement esthétique consiste précisément à ne pas le réduire, et pas davantage à le tirer du côté de la constitution distincte d’une surnature. C’est dans le sentiment d’inadéquation qu’il fonde son effet d’élévation, l’infiniment grand ou puissant s’appréhende sur un mode de rupture, sur un mode lacunaire, mais cette lacune reste béante, et cette béance sur l’infiniment grand est telle qu’elle me laisse bouche bée, et que, comme le dit Longin, « l’âme croit qu’elle est l’auteur ». Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’une réversibilité soit possible entre le sublime et le comique. Du reste, aussi bien dans le sublime que dans le comique, une subjectivité se constitue, qui s’appréhende sur la modalité soit de l’exception soit de l’élévation, et elle ne se constitue dans un cas comme dans l’autre que sous la condition de sa vacillation et de son anéantissement.
Il n’en reste pas moins que le texte de Baudelaire est énigmatique et aporétique et que ses commentateurs ont raison de soulever cette difficulté. Comme le note très justement J. A. Hiddleston dans son article « Baudelaire et le rire »15.
« L’idée de la chute de l’homme, renforcée dans les poèmes en prose, se révèle, selon le témoignage de l’essai sur le rire, inconciliable avec la gaieté engendrée par le comique absolu » [p. 98]
Pour sortir de cette aporie, il faut consentir à se défaire de la théologisation, de l’identification entre rire relatif et rire malin, thèse à laquelle Baudelaire reste assujetti et qui forme obstacle en introduisant une thèse trop forte. Et il faut ensuite consentir à la reconstitution très large de la thèse classique sur le rire à laquelle je viens de me livrer. Cette reconstitution m’a conduite à rétablir les pièces manquantes du puzzle en allant très au-delà du texte de Baudelaire, ce qui est évidemment une trahison. Baudelaire ne construit pas cette théorie, pourtant les thèses qu’il avance cessent d’être aporétiques si on la considère dans toute son étendue et toute sa rigueur : une théorie laïcisée du rire de décharge.
Références bibliographiques
- Baudelaire Charles, « De l’essence du rire et du comique », Curiosités esthétiques, Paris : Garnier, 1986, p. 241-263.
- Bergson Henri, Le Rire. Essai sur la signification du comique, Paris : PUF (1900, série d’articles parus en 1899). Les références sont faites dans la réédition PUF « Quadrige », 1997.
- Bersani Leo, Baudelaire et Freud, trad. par Dominique Jean, Paris : Le Seuil, 1981 (éd. anglaise 1977).
- Bertrand Dominique, Dire le rire à l’âge classique : représenter pour mieux contrôler, Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence, 1995.
- Comique (Le), recueil de textes édité et commenté par Véronique Sternberg-Greiner, Paris : GF Flammarion, 2002, p. 197.
- Courtin Antoine de, Traité de la paresse ou l’art de bien employer le temps en forme d’entretiens, (1673), 4e éd. Paris : J.F. Josse, 1743.
- Deligne Alain, « La problématique baudelairienne du rire » dans Langage, image, orientation, rapport de synthèse pour l’habilitation à diriger des recherches, Villeneuve d’Ascq, 2004.
- Descartes René, Les Passions de l’âme (1649).
- Freud et le rire, éd. A. Szafran et A. Nysenholc, Paris : Métailié, 1993.
- Freud Sigmund, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, (1905) London : Imago, 1940 ; Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1973, 6. Band.
– Das Unheimliche (1927), London : Imago, 1947 ; Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag, 1972, 12. Band.
– Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient (1905). trad. D. Messier, Paris : Folio-Essais, 1988
– « L’inquiétante étrangeté » (1919) et « L’humour » (1927) dans L’Inquiétante étrangeté, tard. B. Féron, Paris : Folio Essais, 1985.
- Grojnowski Daniel, Aux commencements du rire moderne, Paris : José Corti, 1997.
- Hanoosh Michele, Baudelaire and Caricature. From the Comic to an Art of Modernity, The Pennsylvania University Press, 1992.
- Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Vorlesungen über die Ästhetik, Auf der Grundlage der « Werke » von 1832-1845 neu ed. Ausg., Red. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1995-1997.
– Cours d’Esthétique, éd. Hotho, trad. Jean-Pierre Lefebvre et Veronika von Schenk, Paris : Aubier, 1995.
- Hiddleston J. A., « Baudelaire et le rire », Etudes baudelairiennes XII, Neuchâtel : La Baconnière et Paris : Payot, 1987, p. 95-98.
- Hobbes Thomas, De la nature humaine, (1650) chap. 13, trad. d’Holbach, introd. E. Naert, Paris : Vrin, 1991.
- Kintzler Catherine, « Bergson et Freud, théoriciens classiques du rire », Le Moment 1900 en philosophie, sous la dir. de F. Worms, Villeneuve d’Ascq : Presses du Septentrion, 2003, p. 287-304.
– « Questions à Catherine Kintzler sur le rire. Entretien avec Jean-Claude Poizat », Le Philosophoire, n° 17, juin 2002, pp. 15-27.
– Poétique de l’opéra français de Corneille à Rousseau, Paris : Minerve, 1991.
– Théâtre et opéra à l’âge classique, une familière étrangeté, Paris : Fayard, 2004.
- Köhler Ingeborg, Baudelaire et Hoffmann, Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 1979.
- Leakey Felix, Baudelaire and Nature, Manchester University Press, 1969.
- Lloyd Rosemary, Baudelaire et Hoffmann, Cambridge University Press, 1979.
- Mauron Charles, « Le rire baudelairien », Europe revue mensuelle, avril-mai 1967, n° 456-457, p. 54-61.
- Minois Georges, Histoire du rire et de la dérision, Paris : Fayard, 2000.
- Pichois Claude,« La date de l’essai de Baudelaire sur le rire et les caricaturistes », Les Lettres romanes XIX (1965), p. 203-216.
– Baudelaire. Etudes et témoignages, Neuchâtel : La Baconnière, 1967.
- Rousseau Jean-Jacques, Essai sur l’origine des langues, prés. et notes de C. Kintzler, Paris : GF Flammarion, 1993.
- Spinoza Baruch, Ethique, III et IV (1677).
- Worms Frédéric, « Le rire et sa relation au mot d’esprit. Notes sur la lecture de Bergson et Freud », dans Freud et le rire (Cf. supra).
Notes