Sur le blog La Choule, ouvert en mars 2007 pendant le Tournoi des 6 nations et dans la perspective de la Coupe du monde de rugby 2007, j’ai publié des notes brèves. Ce texte en est une réécriture plus serrée, plus cohérente et purgée des figures de style anecdotiques ainsi que des inévitables plaisanteries de circonstance attachées à la publication en billets brefs sur une plate-forme réunissant des initiés se comprenant à demi-mot.
A la mémoire de Jean Marcenac, mon professeur
et à celle de Lucien Bescond, mon collègue.
Remerciements à Robert Damien
qui m’a encouragée à intervenir et qui m’a suggéré bien des pistes.
A la fin du quart de finale de Coupe du monde de foot en juillet 1998, Di Biagio s’écroule sur la pelouse après avoir frappé sur la barre transversale un tir au but qui devait être décisif : c’est lui en réalité qui était frappé par le foudre aberrant d’un dieu malin, absurde et implacable. Une lourde vague immémoriale de fatalisme soulevait les spectateurs, la Fortune avait parlé. J’ai alors compris pourquoi ma réticence à aller voir un match de foot « en vrai » allait bien au-delà des motifs ordinaires (mais qui n’en sont pas moins justifiés) qui retiennent en ces circonstances bien des femmes non pas à la cuisine mais plutôt au salon, lieu d’urbanité. C’est que la sacralité en général et en particulier celle d’un dieu absurde, décidément, ça ne me convient pas.
Il faut avouer que le foot opère au mieux pour ranimer et cultiver la bête superstitieuse, la rendre à la fois malléable et violente : à vider la vie de sa complication ordinaire (ballon rond, pelouse impeccable, visibilité totale des impacts et de la technicité des gestes par l’interdiction des mains et celle du corps à corps, simplicité du score – chaque point correspondant à un acte visible -, évidence de la règle principale puisqu’il suffit d’avancer pour avancer, beauté et clarté des mouvements collectifs), à la rendre ainsi parfaitement lisse et limpide, on pourrait croire qu’il s’agit d’un paradis pour les rationalistes dont je suis. Alors, pour expliquer que ça n’a pas marché, que « ça ne rentre pas dans la cage », il faut bien s’en remettre à un arrière-monde. Un dieu, tantôt chagrin et avare, tantôt prodigue vient infléchir les trajectoires de son doigt magique et réclame sa ration d’adoration et de vociférations, de « plût-au-ciel »? Inlassablement le mécanisme de l’asile de l’ignorance s’y édifie, transformant le stade en lieu de possession-dépossession : un lieu sacré c’est-à-dire un lieu où les hommes n’ont pas le droit de montrer qu’ils sont plus forts, plus beaux, plus généreux, plus intelligents que n’importe quel dieu.
Je m’attacherai donc à célébrer le rugby, sport d’immanence et de contrariétés où la terre n’est pas réduite à un terrain d’évolution, où la gravité n’est pas honteuse, où la faute est constitutive, où le corps tout entier est libéré et entravé, marqué de traumatismes guerriers, où le score est un alphabet raffiné et non un grossier syllabaire, où la contingence abolit le hasard et la fatalité, où la vie reste compliquée, opaque, cafouilleuse et salissante, où le plus beau « goal » se marque à la main c’est-à-dire en y allant soi-même, où les dieux enfin, présents en chair et en os sur le stade (et parfois, comme on sait, dans les vestiaires ou sur les calendriers), ne peuvent qu’avoir été inventés par les poètes et à la ressemblance des hommes.
L’inclusion paradoxale de la faute et la dimension critique
On parle du rugby comme d’un « sport de pénalité ». Ceux qui ne l’aiment pas prétendent que l’action est constamment interrompue, qu’il faut être un expert dans la connaissance du règlement pour suivre une rencontre, que c’est compliqué, que le jeu avance avec des fautes, etc. Comme si une rencontre sportive devait se dérouler sans accroc dans un monde ripoliné. Comme si la faute devait toujours être à l’extérieur, et comme si le jeu devait toujours être quelque chose de parfait et de limpide.
Or le rugby ne fonctionne pas ainsi, mais, en réalisant un compromis, il accomplit pleinement le concept du jeu qui idéalise l’ordinaire de la vie tout en le singeant au plus près . Il s’empare du réel, le rend supportable et le maîtrise sans en évacuer la complexité. C’est pourquoi la faute, sans y être niée, n’y est pas diabolisée ni placée irrémédiablement au-delà d’une ligne rouge à ne jamais franchir : elle y est traitée sous forme d’inclusion paradoxale.
Comprendre quelle faute a été commise est fondamental pour suivre le jeu. Non que les pénalités ne soient importantes dans d’autres jeux de balle, mais ici il y a une dimension constitutive, intérieure, de certaines fautes. Il n’est donc pas tout à fait juste de parler de « sport de pénalité ». La sanction n’est pas toujours une punition, on peut la jouer : une mêlée-sanction non seulement est une phase du jeu, mais elle peut être recherchée par l’équipe qui commet la faute. L’exemple le plus significatif est la touche : sortir des limites de l’aire de jeu peut être à la fois une faute et une façon de faire progresser la conquête du terrain ou de se sortir avantageusement d’une situation délicate. Il y a donc deux espèces de faute : celle qui construit le jeu, incluse dans sa progression et sa continuité, et celle qui lui est contraire.
La dimension constitutive de la faute révèle le statut critique du rugby, qui fonctionne à cet égard comme la pensée pour laquelle l’erreur n’est jamais quelque chose d’extérieur. Voilà pourquoi le rugby ne se joue pas dans un monde utopique où il y aurait la norme et le hors-norme séparés : bien au contraire la norme s’y nourrit de sa propre transgression, comme dans la vie. Le rugby n’est pas lourdement idéaliste, ça soulage !
La balle, le joueur, la main
Dans maint sport de balle, on dit que la balle circule. Quelle pauvreté ! Au rugby, la balle ne fait pas que circuler. On la serre contre soi comme un objet chéri, cette « balle en forme d’Enfant Jésus » comme le dit Jean Lacouture . On la pose délicatement comme si c’était un œuf avant de la taper en l’entourant de pâtisseries éphémères (petits talus en sable, en gazon – est-ce que la farine est autorisée ?) ou en recourant à un accessoire en plastique qui ressemble à un coquetier et que le Stade français apporte en grande pompe sur une petite voiture rose télécommandée (car c’est en marge du vrai jeu qu’on fait joujou, ce qui rappelle le jeu à son concept). Il arrive même, dans ces moments auxquels Eole participe malicieusement, qu’un partenaire s’allonge et pose un doigt stabilisateur sur son sommet, enfouissant la tête sous l’aisselle le plus loin possible du point d’impact. On la conserve à mi-corps dans les regroupements debout. On est obligé de s’en dessaisir le plus ostensiblement possible et vers l’arrière quand on est à terre. On l’écrase avec son corps pour marquer l’essai – on l’ « aplatit », ce qui équivaut à une signature On la suit des yeux quand elle s’envole entre les poteaux ou en chandelle. On l’attend au rebond difficile à prévoir. On la cueille, bras mains et poitrine en cuillère dans l’arrêt de volée. On l’introduit en mêlée dans un mystérieux « couloir » où il se passe et où il se dit, paraît-il, bien des choses !! On s’escrime en se poussant comme des bêtes pour la faire glisser du talon vers l’arrière, et dès qu’elle est sur le point de sortir, on détricote les jambes pour bien montrer qu’elle est là, à dix centimètres des doigts avides du demi de mêlée ; bientôt elle va passer des talons aux mains, de l’immobilité à l’envol, relayée dans une trajectoire dialectique comme celle des bateaux à voile : en arrière et sur le côté pour avancer.
La balle elle-même est un paradoxe, une chose inerte et une non-chose animée, à la fois ce qu’il y a de plus près et de plus loin, de plus fragile et de plus dur, de plus terrestre et de plus aérien, de plus rapide et de plus immobile, de plus caché et de plus visible. Son statut est multiple. Elle n’est pas un simple projectile qu’on envoie quelque part, ni un mobile que l’on manœuvre comme s’il était télécommandé. Un jeu de bistrot Baby rugby sur le modèle du Baby foot, avec des leviers, des tubes coulissants et des percussions fixes, est impensable. Pas moyen de mécaniser ce machin-là, et les choses non mécanisables il faut les faire soi-même à la main. C’est ainsi que je vois la main du rugbyman : la main n’est pas simplement un organe, mais surtout un schème, celui de l’opération humaine. Ce jeu est de ceux qu’il faut jouer « à la main » comme quand je fais un calcul à la main. Il ne suffit donc pas de dire qu’on joue au rugby avec les mains : c’est du fait main.
La terre et la gravité : corps glorieux et fragile des rugbymen et des danseurs
Dans un jeu de balle, on appelle en général terrain une surface qui se fait oublier, sauf par ses limites et sauf quand elle n’est pas bien entretenue. Une planéité sur laquelle les joueurs évoluent et où la balle roule, avec des effets et des rebonds de particule élémentaire calculable – ainsi du parquet luisant, de la surface synthétique où les baskets crissent et de la pelouse impeccable où s’agrippent les crampons du foot. Billard, effets, calculs, courses et arrêtés « au quart de tour ». Au mieux c’est un miroir mécanique, résultat d’un rebond au principe du jeu, en droit prévisible selon la nature du sol : gazon, terre battue, revêtement plastique du tennis. Quel ennui, ce sol qui porte si mal son nom de terrain !
Or le terrain du rugby, même s’il est plan, est avant tout de la terre pas battue, il en déploie les épices et les effluves au plus près des nez qui s’y écrasent, il en garde la sécheresse, l’humidité, la dureté, la mollesse, la viscosité, et cette réjouissante boue qui prolonge les aplatis, adoucit crémeusement les plaquages, fait déraper le crampon virant, déchausse le lourd pilier dans sa poussée, fait hoqueter l’en-avant, poisse la balle, macule le maillot d’une glorieuse salissure…
On ne se contente pas d’y évoluer comme des anges qu’on n’est pas. On y tombe lourdement et nécessairement, constitutivement, parce que le jeu le veut. Parce qu’on est soi-même un corps grave, parce qu’on est plaqué ou qu’on plaque, parce que la mêlée s’effondre, parce qu’on aplatit l’essai. La trilogie corps du joueur – balle – terre se conjugue, deux à deux, trois à trois, dans l’espace et dans le temps : contact nécessaire de la balle et du sol avant le coup de pied, rebond de la touche, lâcher prise du joueur à terre. Elle atteint son apothéose au moment de l’essai, validation maximale du triple contact.
Enfin le sol n’est pas un simple lieu, un site ou un moyen : c’est un véritable partenaire où il faut prendre ses appuis, eux aussi variés, lourds ou aériens, pour sauter ou pour s’affaler, pour virer, pour se retourner sur le côté comme un demi-scarabée, pour s’immobiliser, pour s’élancer, pour faire ployer les nuques adverses.
La gravité ne s’oppose donc pas au jeu, elle le constitue : le rugby fonctionne comme la danse qui s’autorise de la gravité sans la congédier. Footballeurs, basketteurs, joueurs de tennis peuvent se retrouver à terre, ridiculement. Seuls danseurs et joueurs de rugby s’y trouvent, ordinairement mais aussi glorieusement.
Constamment percuté et rudement frictionné, le corps du joueur est promu au niveau d’un corps glorieux par les marques de souffrance qu’il porte pendant et après le match. Gloire tirée des contusions, des bleus, des salissures, des brûlures provoquées par les glissades au sol, des oreilles fleuries, des pieds déchaussés et tournés, des crampes sautillantes. Et l’accoutrement qui va avec, bricolage opportuniste d’élastoplast de plombier en bandeaux auréolant le crâne des piliers, doigts enserrés, scotch magic sur les arcades sourcilières, lacets prenant des allures de bande velpeau. Plus la graisse immémoriale qui huile la peau des athlètes depuis deux mille ans… Un bain de boue par dessus le marché, finalement, on comprend que ça ne fait pas de mal.
Joueurs de rugby, vous avez bien des choses à partager avec les danseurs dont le corps, très exposé, connaît la peau chauffée et durcie par le contact avec le sol – en un sens plus rudes que vous, car souvent offerts au choc et aux frottements dans une nudité que vous réservez, chochottes, à vos vestiaires et à vos calendriers !!! Même s’ils sont épargnés par les traumatismes guerriers qui vous envoient à l’hosto, avec leur cortège de fractures, luxations et K.-O., ils connaissent aussi la périostite, les hernies, ruptures de ligaments et autres aponévroses.
Mais deux limites. L’une d’équipement : certes quelques rembourrages sous le maillot et le short, protège-tibia et protège-dents d’usage. N’oublions pas le « casque », alignement comique de dominos en plastique mou qui vous fait une tête de batracien, hideuse et sublime, soulignant le promontoire nasal, abaissant d’un cran le verrouillage frontal presque au niveau d’un néanderthalien : quel beau moment lorsque vous l’ôtez pour retrouver votre vrai visage de sapiens ! Magne, Betsen, Pelous : vous êtes vraiment les plus beaux à ce moment là ! Mais rien qui ressemble à une carapace, encore moins à une armure, offensantes pour l’adversaire et déformantes pour l’oeil du public. Rien que du défensif soft près du corps. Autre limite, hygénique et symbolique : pas de sang. Un rappel m’évitera de longs commentaires : à la moindre égratignure, le dieu grec de la guerre Arès tournait de l’oeil, avouant ainsi sa gémellité avec Aphrodite au cou si blanc !
Dialectique civilisée du contact et de l’évitement : il n’y a pas d’enfer
Comme chacun sait, le rugby met les corps en rude contact. Encore une comparaison, inévitable et qui se veut désobligeante, avec le foot. Mais alors que le foot se laisse aller parfois à un contact sournois et transgressif (car interdit) entre les joueurs (je passe sous silence les papouilles dès qu’un but est marqué), le rugby est une véritable culture du contact : il ne s’y laisse pas aller, mais il l’affiche, le permet, le civilise, le requiert. Nouveau paradoxe : de ce qui est ailleurs interdit, il propose un traitement différencié ; on découvre alors que l’interdit total du contact laisse celui-ci dans son état sauvage, et relève d’une conception simpliste de la culture prenant le risque d’un violent retour du refoulé. Au contraire, en réprimant et en canalisant cette violence sans l’exclure, le rugby montre qu’il a tout compris de la civilisation.
Parfois spectaculaire, le contact avec le corps de l’adversaire est admis, et même obligé dans les regroupements, les plaquages, les « percussions ». Aucun des autres sports collectifs ne le requiert, à plus forte raison ne peut-on y voir une pluralité des pratiques du contact. Ici, il s’effectue selon des lignes de force et de mouvement variées : pousser, tirer à soi, saisir le bassin de l’adversaire (et non ses épaules ou sa tête) pour le plaquer, anticiper l’élan adverse en même temps qu’on le percute.
Y réfléchir à deux fois aussi : cela affecte la notion d’évitement. Au rugby, l’évitement n’a pas pour objet l’interdiction de toucher l’adversaire, mais il est au contraire nourri de la possibilité de le faire. On n’évite pas l’autre parce que c’est interdit, on le fait parce que c’est un choix de jeu, parce que c’est l’occasion d’un leurre. L’évitement et le contact sont symétriques et non opposés.
Ne pas oublier non plus le contact avec le corps du partenaire : enlacement scapulaire des premières lignes et imbrications épaules-fesses, bras-cuisses pour former la mêlée, poussée verticale pour la prise de balle à la touche, empilement des corps pour « soutenir » le joueur à terre qui lâche la balle. Ce compagnonnage charnel ordinaire rend les étreintes, effusions et autres « papouilles » moins nécessaires, moins appuyées, moins gênantes et moins infantilisantes pour le spectateur quand elles se produisent dans la jubilation d’un point marqué.
Tous ces contacts apparemment désordonnés et débridés sont en réalité disciplinés, parce que permis. Contrairement aux apparences, le rugby fait dans la nuance. Il connaît autre chose que le « tout interdit » pendant le match et le « tout permis » hors match. Nuance du permis-mais-pas-tout, canalisation, exercice et reconnaissance de la force, fabrique de jeux de mains mais pas de vilains. Contacts pensés parce que avoués et non forclos, visibles et non relégués dans un infra-monde d’où ils ne peuvent que resurgir comme d’un enfer. Il n’y a pas d’enfer au rugby parce que les forces infernales sont présentes : humanisées ici et maintenant.
Ni dieu ni hasard : l’ovale et la contingence suffisent à la gloire de l’humanité
On a dit tant de choses sur la forme ovale de la balle que j’hésite presque ici. Ce machin est très évidemment biscornu, au sens strict et au sens figuré. On est aux antipodes d’un jeu de billard, à tenter de saisir le rebond de cette perle baroque là où on ne s’attend pas à ce qu’elle soit. Plus le vent. La prévision est toujours en haleine, toujours poignante, souvent désavouée… les choses ne sont pas malléables.
Le rugby n’a rien à voir avec le hasard et tout avec la contingence. Le hasard, la Fortuna des Anciens avec ses yeux bandés, c’est un dieu qui se joue de nous, qui décide pour nous, que nous défions ou supplions dans des prières païennes. La contingence, c’est ici et maintenant, avec les yeux ouverts : c’est l’imprévisibilité, la force et la présence des choses qui sont ce qu’elles sont, et qui auraient pu être tout autres qu’elles ne sont. Mais pas besoin de leur attribuer une volonté, elles sont assez déroutantes comme ça… Et ici ça crève les yeux : c’est signé rien que par la forme de la balle « pas-ronde », comme les choses de la vie.
Un jeu qui montre et qui accepte autant la contingence n’a pas besoin du dieu hasard. Pour la même raison, même s’il admet le fétichisme, il n’a pas besoin de fatalité. Tout est là sous nos yeux, aucun deus ex machina ne vient tirer les ficelles de l’heur et du malheur : les choses sont déjà assez compliquées comme ça, on fait déjà assez de bêtises comme ça pour n’avoir pas besoin de recourir à un arrière-monde et lui rendre un culte. Il faut saisir les circonstances, on le peut, on le doit, on le réussit, on le rate ; la vie est à la fois compliquée et rationnelle.
Voilà pourquoi je crois aussi qu’on n’assiste pas à un match de rugby comme à un sacrement. De l’enthousiasme, mais pas de fanatisation : seuls les éléments et les forces en présence, dans leur variété et leur complexité, sont suffisants pour expliquer la victoire ou la défaite ; il y avait du vent, ça a glissé, le rebond n’était pas de ce côté, on n’a pas été bons, « ils » ont été plus forts, ou plus intelligents, ou plus constants. Le tout est d’être là au bon moment et de faire le bon geste. Le tout, et il en reste toujours.
On n’a d’ailleurs que faire d’un dieu supplémentaire, caché et importun, puisque les dieux sont là, sur le stade, en direct : les dieux, les demi-dieux et les héros de l’épopée antique. Rien à voir avec une divinité féroce, jalouse, fatigante, irrationnelle, exclusive, possessive, et que par dessus le marché on est obligé d’aimer. Ici on dirait que les dieux de l’Olympe et les héros se déploient dans un éventail varié. Ils sont plusieurs, pleins de qualités, de vertus, de turpitudes et de défauts. Ils réussissent magnifiquement et ils se plantent lamentablement : ce sont des dieux et des héros à l’image des hommes, on remet les choses à l’endroit.
Ils nous ressemblent, on se reconnaît : il y a le trapu qui pousse fort, le hargneux qui ne lâche pas, le petit qui court vite, le calme qui regarde en lui-même avant de taper, le stratège qui voit la bonne combinaison et qui fait des grands signes, le surdoué qui sait tout faire et qui peut remplacer n’importe qui, le rusé qui extrait la balle en regardant autour de lui comme un chat qui chasse les taupes. Et cela vaut au mental comme au physique. Il y en a pour tous les talents, toutes les forces, toutes les erreurs, toutes les balourdises. Malgré l’uniformisation croissante des gabarits, c’est encore taillé à la mesure et à la gloire de l’humanité.
Des points et non des buts : finesse et rationalité
Contrairement à une apparence grossière, le rugby est fondé sur la nuance, sur des déclinaisons de gammes continues. Bref, tout en finesse.
Toute rencontre sportive se traduit rationnellement par un décompte : le score. Le score au rugby est fait de points et non de buts ; la distinction importe. L’unité élémentaire (le point) a valeur alphabétique ou atomique : elle ne correspond en effet à aucun acte isolable sur le terrain, c’est un abstrait. On ne marque que des ensembles de points, un peu comme on écrit les mots avec des lettres de l’alphabet, lesquelles n’ont aucun sens de manière isolée. J’ose à peine rappeler le b-a ba : 5 pour un essai, 2 pour une transfo, 3 pour une pénalité, 3 pour un drop… En revanche, la pertinence de l’unité se trouve dans le décompte, en tant que différence : on peut être devancé d’un point. Et ça fait une différence !
Autrement dit : le score du rugby s’exprime en une langue quantitative évoluée, articulée en micro-éléments abstraits qui ne prennent leur valeur que dans la série et les différences entre séries. Et non en une langue grossière, où chaque point correspond réellement à un acte de jeu isolable (le « but », vous voyez de quoi je parle ?) : dans ce dernier cas, on n’est même pas du niveau d’un syllabaire, on est dans un système de signaux, une pictographie où chaque signe correspond à une chose. Quelle grossièreté !
L’une des conséquences de cette finesse du score articulé rappelle une thèse déjà abordée : le score est rarement injuste par fatalité. Ce qui est mortel, humiliant, n’est pas d’encaisser un but où tout se joue, mais une série de points, ce qui suppose la continuité entre plusieurs phases de jeu. Et si l’arbitrage n’est pas complètement aberrant ou partisan, la différence au score reste rationnelle, proportionnelle aux forces et aux habiletés en présence.
Une autre conséquence est la notion de choix tactique : tenter une pénalité plutôt que la jouer à la main ou choisir la pénaltouche, c’est essayer de maîtriser dans un calcul l’état du score, le moment du match, le temps qui reste à jouer, les éléments naturels (distance, vent)… apprivoiser la contingence.
Mouvement contraire et totalité du corps
Lorsque j’étais enfant, j’admirais le geste de ma mère battant une omelette, je pensais que cette alliance de rapidité, de précision, d’adresse et de force me serait à jamais inaccessible. Mais j’y suis parvenue. Pour cela, comme pour apprendre à coudre, à tenir un crayon, à sauter à la corde, j’ai dû apprendre à ne pas m’abandonner au premier mouvement de mon corps pour pouvoir le rendre disponible au mouvement vrai, fort, habile et rapide qui en révèle toute la puissance.
Toute discipline, qu’elle soit corporelle ou intellectuelle, s’effectue grâce au mouvement contraire qui contraint pour libérer, qui fait le vide pour rendre possible l’appropriation. Et donc on peut dire cela, a fortiori, de tout sport de haut niveau. Mais aucun ne le fait de manière aussi éclatante que le rugby, car aucun n’affiche aussi insolemment que la contrariété est partout, à tout moment, à son principe.
Reculer pour avancer, mains en arrière sur le côté et pieds en avant tout droit sculptant cette magnifique torsion du corps qui s’empare des joueurs à la passe. Proximité et éloignement de la balle, qui circule dans le jeu et s’immobilise dans le regroupement. Rapidité de la percée vers l’essai et patience de la poussée collective qui grignote du terrain. Mains qui serrent la balle au plus près du corps et qui s’en dessaisissent aussitôt qu’on est au sol. Force totale de la percussion et adresse totale de l’évitement.
Même la feinte, si technique au foot, s’inscrit dans la totalité du corps et prescrit la totalité au corps: un corps totalement allant, totalement pesant, totalement aérien, totalement campé, totalement mobile, totalement vaillant, totalement recueilli et retenu. En cela bien sûr le rugby est exemplaire de l’éducation, qui libère sous la condition de la contrainte. Mais au-delà d’un simple exemple, il est ce que les philosophes appelleraient un schème. Un schème inscrit l’idée dans la matière à la manière d’une règle : c’est comme un principe matérialisé.
Au rugby, la contrariété et la liberté qui en résulte, le vide et l’appropriation qu’il rend possible ne sont pas simplement travaillés dans un geste, dans une technique particulière, mais concernent toujours le corps tout entier, individuel et collectif, pris dans sa totalité et dans toutes ses propriétés (gravité, rapidité, adresse, extension, immobilité, consistance, fluidité, ténacité, versatilité…). Encore une fois comme dans la danse, il y en a pour tous les corps, petits malins et gros balourds , pour toutes les vertus du corps et pour le corps tout entier.
Guerriers, poètes et paysans en trilogie légendaire : une civilisation, et non une « culture »
Une légende récurrente du rugby, liée au culte de la force, a attiré mon attention depuis longtemps. Je l’ai entendue pour la première fois sous forme orale dans l’Ariège, il y a une trentaine d’années. L’équipe de Lavelanet, connue pour son jeu dur, comptait « à l’époque » un pilier qui disait-on était capable de « soulever une paire de bœufs ».
Invraisemblable.
Ce qui est invraisemblable n’est pas qu’un pilier de légende ait pu soulever plus d’une tonne (ça c’est normal), non : c’est qu’on ne voit pas par quel moyen une paire de bœufs pourrait rester assez solidaire pour être soulevée d’une pièce par une main, même herculéenne. Certainement pas par le joug. Fixé sur les cornes au moyen de liens de chanvre ou de cuir, il resterait inévitablement dans toute main qui le prendrait de bas en haut… Quant au reste de l’attelage, c’est également impossible quand on sait que dans ces régions montagneuses on n’utilise ni chariot à roues ni timon rigide, mais des traîneaux rattachés aux animaux par une chaîne. J’étais donc en présence d’un récit fabuleux.
Et voilà que, au hasard de mes lectures, je retrouve un Hercule paysan bien plus précis sous la plume de Denis Tillinac:
Alfred Roques, le Pépé du Quercy, le Porthos de Cahors, pansu comme les piliers du Pont Valentré, témoin ou survivant d’un rugby français de la haute époque, d’essence gasconne et paysanne. On disait qu’il retournait des bœufs en les prenant par les cornes. On disait qu’il soulevait des voitures pour amuser les enfants. Des voitures, des tracteurs, des montagnes : on fabulait éperdument sur ce menhir taciturne …
La métaphore revenait sur les rails, ou plutôt dans les ornières, refluant des bœufs retournés à l’objet rigide et inerte, le véhicule. L’illumination vint d’une troisième lecture. Les Contes du rugby où Henri Garcia donne à l’histoire d’Alfred Roques une forme encore plus précise :
Alfred se contentait d’épater le canton de Cazes-Mondenard par de simples travaux de la ferme. C’est ainsi qu’un jour, alors qu’on installait la batteuse à la ferme des Roques, le cric se brisa. Tout le monde discutait en vain sur la meilleure méthode à employer pour mettre la lourde machine sur cales, lorsque l’Alfred qui écoutait sans mot dire s’avança :
– Tenez-vous prêts avec les cales.
Il se fit un silence général, lorsqu’il se glissa à quatre pattes sous l’énorme machine. Chacun retint son souffle et dans un gémissement rauque, la lourde masse décolla du sol. (p. 47-48)
Cette fois, j’y étais. Voilà la version occitane d’une fable populaire contée par un des plus grands écrivains de langue française. On aura reconnu un célèbre passage des Misérables où Jean Valjean, sous le nom de M. Madeleine, soulève la charrette du père Fauchelevent . Rien n’y manque, pas même le cric défaillant. Qu’en conclure ? Que ce grand poète a été lu et relu par des générations de paysans, qui l’ont adopté avec la dimension qui lui sied. Poète assez fort lui-même pour soulever le poids d’un mythe herculéen et le recréer de toutes pièces. On vérifie alors ce que disait Hegel, un autre géant de la pensée : ce ne sont pas les dieux qui ont créé les hommes, ce sont les poètes qui ont inventé les dieux.
Mais l’histoire d’Alfred Roques ne s’arrête pas là. Henri Garcia lui attribue d’autres exploits. Il maîtrise d’une seule main un étalon qu’on vient de châtrer – on retrouve sous une autre forme les bœufs non pas soulevés, mais retournés d’un revers de main du texte de Tillinac. Enfin, employé à l’entretien du stade de Cahors, il laboure le sol entièrement à la bêche (à la main) et, sollicité en 1961 pour une dernière tournée en Afrique du Sud, il préfère pourtant renoncer afin de poursuivre la construction de sa maison de ses mains.
Il faut remonter ici un peu plus haut que Victor Hugo pour flairer la trace de deux sources anciennes, mais la réminiscence n’en est pas moins scolaire. Le jeune Alexandre le Grand dompta le cheval Bucéphale en le plaçant face au Soleil – une seule main lui avait certainement suffi pour cela : bien sûr c’est Plutarque et ses Vies… Quant au paysan-fondateur appuyé sur sa bêche (ou sur sa charrue) et qui revient à son champ aussitôt sa tâche glorieuse accomplie, il faut se tourner vers la fabuleuse histoire romaine pour identifier le vertueux Cincinnatus, bien connu des générations de latinistes qui ont pâli sur le De Viris Illustribus d’ Aurélius Victor.
Guerriers politiques, paysans travailleurs et poètes conteurs ou scribes – tous adeptes d’un culte mythique de la force quelle qu’en soit la nature : la trilogie est parfaite, elle se décline dans chacun des personnages, dans chacune des légendes… Le rugby est nourri de ces mythes gréco-latins, qui puisent probablement leur source lointaine dans l’idéologie indo-européenne naguère étudiée par Georges Dumézil. Il n’est pas une simple « culture », mais il est partie prenante d’une grande civilisation dont il conserve la mémoire… et les mains !
Antiparisianisme et machisme : encore quelques (beaux ?) restes
Un peu de poil à gratter ne fera pas de mal dans ce chapelet de propos élogieux. Mais il serait trop facile d’aller le chercher du côté des détracteurs du rugby. Je l’ai trouvé dans l’article d’un fin connaisseur, Philip Dine : « Du collégien à l’homme (et retour) : rugby et masculinité en Grande-Bretagne et en France » dont j’extrais ce passage iconoclaste.
En tant que « sport de terroir », le rugby pouvait même servir d’antidote à l’exode rural des trente glorieuses. Dans les années 1950 et 1960, l’O.R.T.F. offrait à la nation un « rugby champagne » au pétillement international avec des attaquants vedettes comme les frères Boniface et Jean Gachassin, et permettait ainsi de présenter une image de continuité masculine définie régionalement qui masquait les changements rapides et radicaux qui se produisaient dans l’ensemble de la campagne française. C’était l’époque de l’exode rural déclenché par l’accélération de l’industrialisation, la réorganisation agricole programmée par la D.A.T.A.R. et la modernisation administrative de la France. Avec le soutien officiel du général de Gaulle et de l’ensemble de ses ministres, les rugbymen du Sud-Ouest devinrent un symbole de la continuité mâle qui pouvait être opposée à la nouvelle domination urbaine du « jeune cadre dynamique » et du « soixante-huitard ». Dans cette récupération nationale d’une passion jusque-là provinciale, Roger Couderc et Pierre Albaladéjo, les Obélix et Astérix des ondes, eurent un rôle clé, en proposant une construction ethnique de la masculinité française à opposer aux incertitudes sociales et politiques de ces temps de plus en plus troublés. Au moins sur le terrain de rugby et sur les écrans de télévision, les hommes étaient toujours des hommes ; et en plus Basques, Gascons et Catalans.
Ah ces « valeurs » rurales, régionales, viriles, tribales, le cassoulet qui tient au corps, l’air pur de l’Ovalie côté Sud qui vous nettoie les poumons des souillures citadines et des grisailles nordistes : ça vous préserve de l’émasculation, de la dégénérescence, ça vous vide l’esprit de l’urbanité efféminée et des manières de gonzesses-intellectuelles-parisiennes ! Là je sens comme un malaise, un léger froid dans le dos (et encore, j’ai pris des gants, j’ai sauté le passage sur le rugby pendant les années 40…). Mais on peut tout de même rappeler que ces chichiteux de Parisiens bourgeois intellos ont introduit le rugby anglais sous sa forme moderne en France, après qu’il eut fait un débarquement remarqué au Havre. Et un siècle plus tard, voilà qu’ils ont osé le rose, les paillettes et un semis de fleurs sur le maillot ! Ouf, nous voilà sauvés de la grande santé terrienne et de la régénération uniforme !
Et les femmes ? Je n’aborderai pas la question de la pratique féminine du rugby, en pleine expansion mais que je connais peu, pour m’en tenir à celle de la persistance d’une féminité inhumaine – placer les femmes au-dessus ou au-dessous de l’humanité est l’essence même du machisme.
Anne Saouter a beaucoup réfléchi et travaillé sur les rapports entre le rugby et les femmes – celles qu’elle appelle « les femmes du rugby » : comme ce terme l’indique, il ne s’agit pas des joueuses, mais des femmes qui environnent le monde masculin du rugby. Dans une contribution à l’ouvrage collectif Rugby : un monde à part ? intitulée « Etre rugby, ou à propos d’une sociabilité de chair », après avoir évoqué la position inconfortable, discrète et pleine de tensions des « épouses », elle entreprend la description des « mères » exubérantes, nourricières et laveuses de maillot :
[…] même quand l’individu masculin devient adulte, un lien très fort persiste avec la mère par l’entremise du maillot, et plus précisément de son entretien, chose dont ne veut justement pas se charger l’épouse. Quand il le peut, le joueur continue souvent, même après le mariage, d’apporter son linge sale à sa mère. […] Contrairement à l’épouse, la mère dans le rugby se « partage ». Laveuse ou nourricière, elle n’est pas censurée dans son maternage. Il en est également ainsi dans les tribunes : elle peut gesticuler, crier, et même donner des coups de parapluie (c’est du moins le genre d’anecdote qu’on se plaît à raconter dans le rugby : à en croire les récits, chaque club aurait sa mamie dotée de son parapluie menaçant !). Ces deux figures féminines, l’épouse qui devrait presque se contenter de répondre à l’adage « sois belle et tais-toi », et la mère librement volubile parce qu’absente de la sexualité des hommes n’ont rien de bien original dans notre société. Il est néanmoins étonnant de les constater à ce point figées dans le rugby.
Alors : épouse ou mamie ? Ni l’une ni l’autre! Je ne veux aucun ces rôles inhumains d’ange ou de sorcière, auxquels s’ajoute inévitablement une troisième figure ambivalente et déplorable, ange-démon qui hante les troisièmes mi-temps, celle qu’on désigne par une totalité sous condition de la série d’exclusions : « toutes des p…, sauf ma mère, ma sœur, ma femme et ma fille ». Mais ces figures hélas ne sont pas l’apanage de la « culture rugby » – qui cette fois abandonne son aire civilisatrice pour rejoindre un autre sport de balle parfois perdu par ses coups de tête.
Les noces du rugby et de la littérature : un gentilhomme campagnard bougon sur le bitume
Revenons à la civilisation pour terminer par les noces du rugby et de la littérature, lesquelles ne renoncent pas aux rugosités qui viennent d’être évoquées, mais qui, en les poétisant, les apprivoisent et les conjurent. Le choix est vaste et embarrassant, d’Antoine Blondin à Jean Lacouture, en passant par Pierre Mac Orlan. Mais mon penchant m’entraîne vers un récit rugueux, boueux, venteux, ensoleillé, fulgurant, plein de charme, réac et provocateur comme je les aime : Rugby Blues de Denis Tillinac .
Son écriture roborative réussit une prouesse : il y a presque plus de noms propres que de noms communs dans mainte page de cette prose qui pourrait faire penser à un annuaire de téléphone et que pourtant on lit… comme un roman. Prouesse ironique (et sans doute savamment calculée) quand on sait que l’auteur, gentilhomme campagnard bougon, héritier des « hussards » machos et hyperboliques, ne partage pas tant son litron de gros rouge avec Oulipo et autres Perec qu’avec Antoine Blondin.
Il a beau tenter de faire croire qu’il est un mufle :
Le rugby est masculin, le pansexualisme de ses chansons tourne en vase clos dans la libido des joueurs, ce sont des légionnaires en campagne, des hommes privés de femmes. Qu’ils se rattrapent en permission est une autre affaire, sur laquelle mieux vaut ne pas s’appesantir, encore que les épouses de rugbymen soient sans illusions. (p. 39)
Il a beau multiplier les provocations et les déclarations superbes de mépris :
En semant un club sur les sols ingrats d’en deçà de la Loire, on peut récolter une saison nationale, comme il advint à Besançon, puis à Arras. ça n’ira jamais bien loin. Certains ont le goût des cultures minoritaires, qui se font catholiques à Boston, footballeurs à Los Angeles, socialistes en Vendée. Je concède aux Flamands ou aux Lorrains le droit de jouer au rugby ; on s’y risque même en Allemagne. Je préfère voir valser les « gonfles » là où elles poussent toutes seules, autour des bastides ocre et rose. Question d’harmonie. (p. 43)
On n’y croit pas, ou plutôt si : on y croit comme on croit à L’Iliade et à L’Odyssée, et c’est exactement ce qu’il faut.
Et quelle magnificence dans l’aveu qu’il fait quand même, ce rustre à la plume si fine et si forte, d’un petit pincement au coeur aporétique avec Paris, cité de rustres errants sur le bitume, magnifiés par l’encre (celle des journaux et surtout des livres) et les tournées de bistrots, puis, oserai-je ajouter, reconvertis en noeud pap et maillot rose… Il faudrait ici recopier plusieurs pages dans le genre Paris-je-t’aime-moi-non-plus : on croirait presque lire le plus parisien des poètes hurleurs, Léon-Paul Fargue.
Célébrons donc avec Denis Tillinac, sur la note bleue qui nous chante que tout fout le camp, « les affinités secrètes du rugby et de la littérature » en relisant une page de ce poème des malins et des balourds – la conjonction, comme on le verra, étant ici de stricte coordination et non d’alternative, allégorisée par le derby Tulle-Brive et, plus au large, par la dualité Corrèze-Aquitaine :
Entre les deux, faut-il choisir ? J’aime les gladiateurs, les laboureurs, les déménageurs des packs. Leur code d’honneur sera peut-être le dernier vestige de l’antique chevalerie. J’aime les piliers de devoir, les seconde ligne de soutien, les bœufs qui poussent, plaquent, encaissent sans ciller et rendent la monnaie par déontologie. J’aime aussi les virtuoses aux semelles de feu, les harmoniques du jeu de ligne, les intrépides qui partent de leur en-but comme les Rois Mages vers Bethléem. Après tout il y a un siècle que le rugby communie sous les deux espèces, le pain des avants, le vin des trois-quarts. Deux façons d’être, deux hémisphères psychologiques. Dans mon panthéon, Boni côtoie d’humbles « mulets » aux tronches barrées de cicatrices. J’ai pris de vifs plaisirs en assistant à des joutes confinées dans le périmètre sulfureux des avants. C’est mon côté tulliste. Je ne me réjouis pas moins lorsqu’un ballon file de main en main à la vitesse de l’éclair. C’est l’école aquitaine. (p. 142-143)
Pour résumer le tout, arrêtons-nous sur le laconique portrait d’un célèbre joueur : « des allures de Barbe-bleue, des fleurs plein les yeux » (p. 100). Allons tout ne fout pas le camp. Tillinac, je te pardonne d’avoir prophétisé en 1993 que « Paris n’aura été rugby que le temps d’une aimable mode » , parce que le derby Tulle-Brive demeure profondément vivant dans son élargissement à chaque pays de rugby, à chaque hémisphère, et donc à chaque match et à chaque équipe, parce qu’un poète dit toujours vrai surtout quand il ment, parce qu’un poète fait les choses lui-même « à la main » sans le secours du ciel, et que c’est mille fois mieux que tout ce que peut dire un prophète.
Notes
– Voir Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, Paris : Gallimard, 1995 (1958).
– Jean Lacouture, Voyous et Gentlemen. Une histoire du rugby, Paris : Gallimard, 1973.
– Le club de foot PSG a refusé le Stade Jean Bouin à une rencontre de rugby Top 14 le 13 mai 2007, au motif que le rugby abîme la pelouse !! Le résultat est que cette rencontre s’est tenue royalement à Saint-Denis sur la pelouse nationale du Stade de France.
– Voir Christian Pociello Le Rugby ou la guerre des styles, Paris : Métailié, 1983.
– Denis Tillinac, Rugby Blues, Paris : La Table ronde, 1993, p. 16.
– Henri Garcia, Les Contes du rugby, Paris : La Table ronde, 1961.
– Victor Hugo, Les Misérables, Première partie, Livre V, chapitre 6.
– Professeur de langue et civilisation françaises à Loughborough University.
– Le Mouvement Social, 2002/1 (no 198), p.75-90. En ligne sur le site Cairn.
– Auteur de Etre rugby, jeux du masculin et du féminin, MSH / Mission du patrimoine ethnologique, 2000.
– Rugby : un monde à part ? sous la direction de Olivier Chovaux et de Williams Nuytens, Arras : Artois presses université, 2005.
– Voir la référence note 5.
– Il se trouve qu’au moment où je termine cet article, le Stade français remporte le 9 juin 2007 son treizième Bouclier de Brennus (Champion de France) depuis 1892. Certes, le rugby de la capitale a connu une longue éclipse. Absent des finales du championnat de France de 1909 à 1997, il a fait depuis cette date un retour, sous forme de « rugby paillettes », remarqué, régulier (et bien entendu exécré comme il se doit !) en conquérant cinq fois le titre.

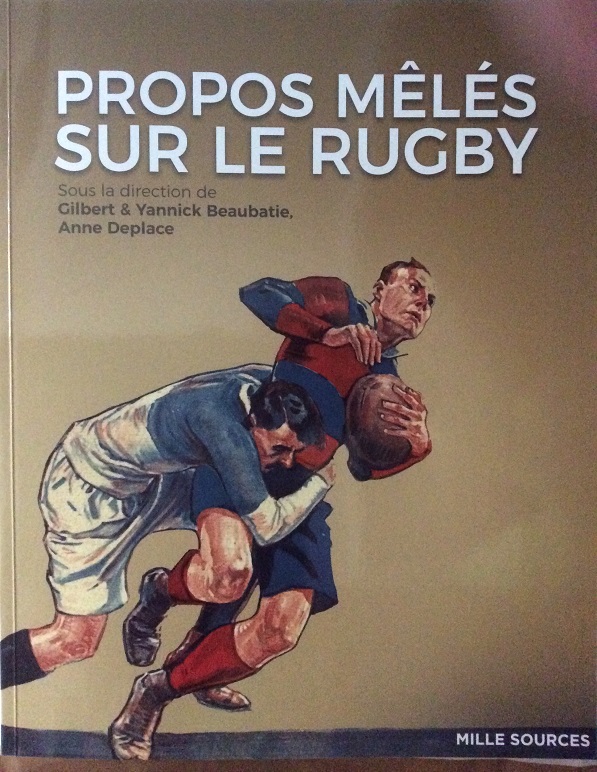
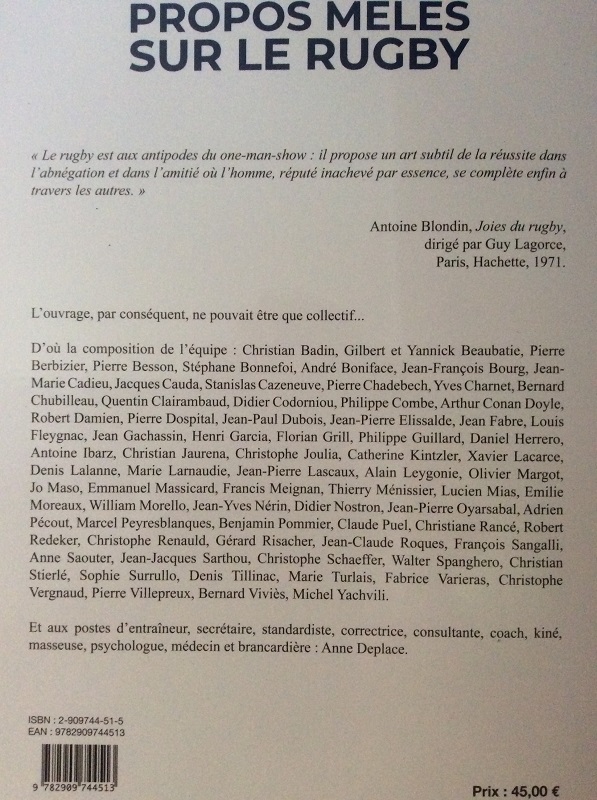
.gif)

