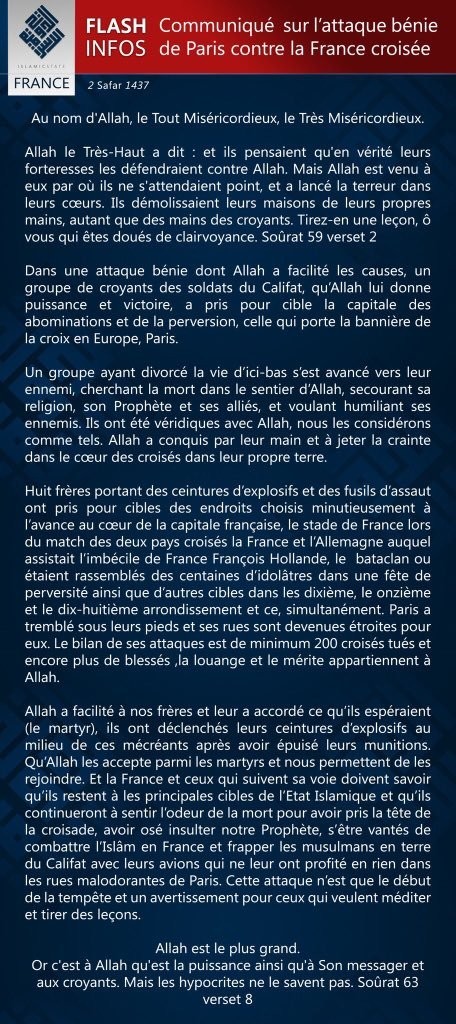Le point de vue laïque généralement retenu par Mezetulle s’en tient à une conception extérieure de la relation entre violence et religion. Indépendamment de savoir si un appel à la violence est présent dans un texte considéré comme sacré par une religion, et, dans l’affirmative, s’il est ou non à prendre pour argent comptant, la laïcité considère qu’aucun texte religieux en tant que tel ne peut avoir d’autorité en matière de loi civile et que la puissance publique, réciproquement, n’a pas compétence pour mettre son nez dans les affaires internes d’une religion – cela dans le cadre du droit commun qui poursuit toute incitation à la violence quelle qu’en soit la source. Mais le point de vue intérieur guidé par l’analyse critique n’en est pas pour autant disqualifié : il est toujours utile de savoir, toujours inutile d’ignorer, et une société ne serait pas laïque si elle n’assurait pas la liberté du savoir. André Perrin adopte ici ce point de vue et s’interroge sur l’existence de rapports intrinsèques entre religion et violence. En se penchant avec beaucoup de précision sur le cas du christianisme et sur celui de l’islam, il montre que cet examen conduit à la question de l’interprétation des textes, ou plutôt à celle de sa possibilité.
Le terrorisme qui sévit actuellement sur la planète, dans les pays occidentaux comme en Orient, se réclame de la religion. Qu’il soit réellement motivé par celle-ci ou qu’elle lui serve seulement de légitimation a posteriori, la question s’en trouve posée des rapports entre violence et religion et plus précisément de l’inscription de celle-là dans les textes sacrés. Le christianisme prône l’amour du prochain mais des croisés ont jadis guerroyé pour délivrer le tombeau du Christ et des inquisiteurs ont torturé au nom de leur foi. L’islam se présente comme « une religion de paix et de tolérance », mais des fanatiques musulmans décapitent, brûlent et crucifient aujourd’hui encore des « infidèles ». Des deux côtés les croyants protestent qu’il s’agit là d’une trahison : le grand inquisiteur cracherait à la face du Christ et les terroristes islamistes ne seraient pas de « vrais musulmans ». Cependant il n’y a de trahison qu’en regard d’une orthodoxie et de mésinterprétation que par rapport à une interprétation correcte. La question des rapports entre religion et violence renvoie donc à la question de l’interprétation : à quelles conditions l’interprétation est-elle possible et quels sont ceux qui disposent de la légitimité qui les autorise à interpréter et à définir ainsi une orthodoxie ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre en limitant notre propos aux cas du christianisme et de l’islam.
La violence dans l’Ancien Testament
L’Ancien Testament n’est pas un livre mais un ensemble de livres appartenant à des genres différents : historiques, poétiques, prophétiques. La violence y est cependant omniprésente sous la forme de meurtres, d’assassinats, de guerres et de massacres dont certains confinent à l’extermination. Il faut bien sûr y distinguer la violence qui est simplement racontée de celle qui est, ou qui semble, justifiée par Dieu, de celle qui est ordonnée par lui, de celle enfin que le texte biblique invite à lui attribuer directement. Nous laisserons de côté la première car on ne peut lire un livre historique comme s’il avait une signification optative ou protreptique, pour nous concentrer sur les suivantes. Dans le livre de la Genèse on voit Siméon et Lévi, les fils de Jacob, tuer tous les mâles de la ville de Sichem pour venger leur sœur Dina qui avait été enlevée et violée par celui-ci et Dieu semble cautionner ce massacre puisqu’il protège Jacob contre la colère des gens du pays1. Dans le Deutéronome, le deuxième discours de Moïse formule, après la loi du talion, les lois de la guerre et de la conquête des villes : « si elle refuse la paix et ouvre les hostilités, tu l’assiégeras. Yahvé ton Dieu la livrera en ton pouvoir, et tu en passeras tous les mâles au fil de l’épée2 ». Dans le livre des Juges, aux Israélites qui lui demandent s’ils doivent combattre les fils de Benjamin, Yahvé répond : « Marchez car demain je le livrerai entre vos mains3 ». Là-dessus les Israélites tuent vingt-cinq mille hommes au combat, puis vingt-cinq mille encore, avant d’exécuter toute la population mâle des villes. Dans le livre de Josué, qui raconte la conquête de la terre promise, c’est Yahvé qui dit à Josué : « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi4 » et une fois les murs écroulés, les Israélites passent au fil de l’épée tous les habitants de la ville « hommes et femmes, jeunes et vieux, jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux ânes5 », ne laissant la vie sauve qu’à la prostituée Rahab et aux siens parce qu’elle avait sauvé leurs émissaires en les cachant. Or à plusieurs reprises il est indiqué que ces massacres se font sur l’ordre de l’Éternel : « comme Yahvé, le Dieu d’Israël, l’avait prescrit6 », « suivant les prescriptions de Moïse, serviteur de Yahvé7 ». Il y a enfin les épisodes où la violence destructrice est le fait de Dieu lui-même, par exemple celui du déluge lorsque, déçu par la méchanceté de l’homme, il décide de détruire sa création : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j’ai créés8 » ou celui des plaies infligées à l’Égypte : « Au milieu de la nuit Yahvé frappa tous les premiers-nés dans le pays d’Égypte9 ».
Penser la violence : marcionisme ou herméneutique
La violence vétérotestamentaire n’a pas manqué de troubler très tôt les chrétiens : le Dieu guerrier de l’Ancien Testament est-il bien le même que celui des béatitudes dans l’Évangile ? À cette question l’hérésiarque Marcion apporta dans la première moitié du IIème siècle une réponse résolument négative. S’appuyant sur l’opposition paulinienne de la loi et de la foi10 et la portant à son paroxysme, bien au-delà de l’esprit et de la lettre du texte de Paul, il nie qu’il puisse y avoir continuité entre la loi mosaïque et la foi en Jésus-Christ et préconise la rupture avec l’héritage hébraïque. À cet effet il s’emploie à éliminer du Nouveau Testament tout ce qui renvoie au judaïsme, ne retenant des quatre évangiles que celui de Luc – lui-même expurgé – et dix des épitres de Paul. C’est ainsi une solution à la fois simple et radicale qui était apportée aux problèmes soulevés par la violence que contient la Bible hébraïque. L’Église n’en voulut pas, qui excommunia Marcion et combattit vigoureusement son hérésie. Comment admettre en effet que Jésus était venu abroger la loi alors que l’Évangile affirme explicitement le contraire : « N’allez pas croire que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir »11.
Interprétation et polysémie
À partir du moment où, rejetant la solution marcioniste, on maintient que l’Ancien Testament est, à l’égal du Nouveau, parole de Dieu, il faut admettre que toutes les formulations de cette parole ne peuvent être prises à la lettre, en d’autres termes qu’elles doivent faire l’objet d’une interprétation. Celle-ci aura pour tâche de déceler un sens caché derrière le sens obvie. Tel est le principe de l’exégèse allégorique dont l’origine est antérieure à l’ère chrétienne puisque Philon d’Alexandrie, à qui on en attribue parfois la paternité, l’a lui-même trouvée chez les philosophes grecs, déjà chez Théagène de Rhégium, mais surtout chez les pythagoriciens et les stoïciens, soucieux de purifier les récits homériques de ce que comportaient de choquant pour la raison leurs dieux capricieux, jaloux et batailleurs, ce qu’ils firent en leur attribuant une signification tantôt cosmologique, tantôt morale : derrière la mythologie se profilerait une cosmologie, la guerre des dieux symbolisant celle des éléments primordiaux, eau, air, terre, feu tandis que les pérégrinations d’Ulysse représenteraient les tribulations de l’âme12. Cherchant à concilier la religion judaïque et la philosophie grecque, Philon s’employa lui-même à lire la Torah comme les stoïciens Homère et son influence fut décisive sur la première patristique, en particulier sur Clément d’Alexandrie et Origène. Ce dernier distingue entre trois sens de l’Écriture : le sens littéral, le sens spirituel, le sens moral. Sens littéral et sens spirituel ou moral ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, mais lorsque celui-là est particulièrement choquant, il peut être considéré comme purement allégorique. Ainsi dans ce commentaire du livre de Josué :
« Quand tu lis dans les Saintes Écritures les combats des justes, leurs tueries, leurs massacres, leurs carnages, lorsque tu apprends que les saints n’ont pitié d’aucun ennemi, et que le fait de les épargner était imputé comme péché, interprète ces guerres de justes de la manière (…) (suivante) : ce sont les combats menés contre le péché13 ».
C’est dans le même sens que trois siècles plus tard Dorothée de Gaza interprétera l’une des plus terribles imprécations du psalmiste. A la fin du psaume 137 (136) on peut lire :
« Fille de Babel, ô dévastatrice,
Heureux qui te revaudra
Les maux que tu nous valus,
Heureux qui saisira et brisera
Tes petits contre le roc !14 »
Dorothée de Gaza propose l’interprétation suivante :
« Bienheureux celui qui, dès le principe, ne laisse pas les pensées mauvaises grandir en lui et accomplir le mal, mais qui, tout aussitôt, pendant que ce sont encore de petits enfants et avant qu’ils aient grandi et se soient fortifiés en lui, les saisit, les brise contre la pierre, qui est le Christ15 ».
Les Pères latins, de Jérôme de Stridon et Ambroise de Milan à Augustin d’Hippone, héritèrent tous de l’allégorèse d’Origène et ainsi se constitua la doctrine destinée à devenir classique des quatre sens de l’Écriture, littéral (ou historique), allégorique, moral (ou tropologique) et anagogique, exprimée dans la fameuse formule : Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia (La lettre enseigne les faits, l’allégorie ce que tu dois croire, la morale ce que tu dois faire, l’anagogie ce vers quoi tu dois tendre).
Interprétation et historicité
Outre l’exégèse allégorique, il y a une exégèse historico-critique, née dans les temps modernes, qui va interpréter les textes bibliques en les replaçant dans le contexte historique de leur apparition. Pendant des siècles les juifs se sont représenté leur Dieu comme un Dieu guerrier qui, en échange du culte que le peuple qu’il s’est choisi lui voue, lui assure sa protection et l’assiste dans ses combats contre ses ennemis. La figure divine qui se dégage de l’Exode, du Deutéronome, des livres de Josué et de Samuel, des Psaumes, tous composés entre le VIIIe et le VIe siècle, est ainsi celle d’un Dieu des armées (Yahvé Sabaoth). Cependant le livre de Josué, un de ceux où la violence est la plus manifeste, n’est pas un document historique relatant l’installation des juifs en Canaan au XIIe siècle. Composé sous la domination assyrienne, il en porte la trace et reprend de multiples éléments de la propagande assyrienne de façon polémique, le Dieu d’Israël se substituant au Dieu d’Assour pour donner la victoire à son peuple. Bien plus qu’un livre d’histoire, c’est un écrit de résistance qui fut du reste plusieurs fois remanié après la période assyrienne et infléchi dans un sens plus pacifique16. Les livres les plus récents, ceux des Chroniques, composés au IVe siècle, celui de Judith, composé au IIe siècle vont dans ce sens et opèrent le passage de la figure d’un Dieu guerrier à celle d’un Dieu artisan de paix. Certes Judith va trancher la tête d’Holopherne, comme une riche iconographie ne permet à personne de l’ignorer, et à cet effet elle demande à Dieu de lui en donner la force : « Donne à ma main de veuve la vaillance escomptée17 ». C’est qu’il n’y a pas d’autre moyen d’empêcher les Assyriens d’exterminer son peuple, mais en même temps elle dit : « Ils ont compté sur la lance et le bouclier, sur l’arc et sur la fronde ; et ils n’ont pas reconnu en toi le Seigneur briseur de guerres18 ».
Dans la conception judéo-chrétienne, Dieu se révèle à travers l’humanité, plus précisément à travers l’humanité en marche, à travers le devenir de cette humanité, c’est-à-dire à travers l’histoire. Il se révèle donc progressivement. Il y a ainsi ce que les Pères grecs ont appelé συγκατάβασις, la condescendance divine, sorte de pédagogie en vertu de laquelle, selon une comparaison d’Origène, Dieu s’adresse aux hommes comme les adultes aux enfants, en adoptant leur langage. Saint Jean Chrysostome la définit ainsi : « C’est, pour Dieu, le fait d’apparaître et de se montrer non pas tel qu’il est, mais tel qu’il peut être vu par celui qui est capable d’une telle vision, en proportionnant l’aspect qu’il présente de lui-même à la faiblesse de ceux qui le regardent19 ».
Les conditions de possibilité de l’interprétation
S’il est nécessaire d’interpréter la parole de Dieu telle qu’elle s’exprime dans les textes sacrés, c’est, on l’a vu plus haut, parce qu’il faut la concilier avec elle-même. Cela n’est possible que si l’on peut ne pas toujours la prendre à la lettre et cela suppose donc une distance entre l’esprit et la lettre. Ce qui creuse cette distance c’est la médiation de l’historicité du texte et de l’humanité de ses auteurs. Selon la tradition juive c’est Moïse qui aurait rédigé la Torah (le Pentateuque), David les Psaumes, Salomon les Proverbes et le Cantiques des Cantiques, de même que la tradition chrétienne attribue à saint Luc les Actes des Apôtres et à saint Jean L’Apocalypse. Quelque incertaines que soient ces attributions – on ne voit pas bien comment Moïse aurait pu raconter sa propre mort à la fin du Deutéronome – il n’en reste pas moins que les auteurs de ces textes sont des hommes, rien que des hommes, inspirés par Dieu sans doute, mais engagés dans une histoire, inscrits dans des temps et des lieux déterminés, confinés par conséquent dans leurs limites, assignés à penser à travers les catégories et l’imaginaire d’une époque, ainsi qu’à s’exprimer dans son langage. On est donc fondé à rechercher derrière ce qu’ils ont dit à la fois ce qu’ils ont voulu dire et ce qu’ils avaient la possibilité de dire dans le contexte historique où ils le disaient. Ainsi Augustin s’adresse-t-il à Dieu dans les Confessions : « Approchons-nous ensemble des paroles de votre Livre, et cherchons-y- vos intentions dans les intentions de votre serviteur, par la plume de qui vous les avez exprimées20 ».
Cependant tous les livres saints n’ont pas le même statut et celui du Coran dans la tradition islamique rend problématique la possibilité d’une telle interprétation. Le mot Coran (al-Qur’ān) peut se traduire par « récitation ». C’est en effet le texte qui a été dicté (une « dictée surnaturelle21 », selon l’expression de Louis Massignon) par Allah à son prophète Mohammad et que celui-ci a purement et simplement enregistré. Ce n’est donc pas un texte écrit par des hommes ni par un homme : c’est littéralement la parole de Dieu – littéralement, c’est-à-dire à la lettre. C’est la parole de Dieu exprimée non pas dans la formulation équivoque d’un dialecte humain, mais dans la formulation que Dieu lui a lui-même donnée, en « langue arabe claire22 », c’est-à-dire dans la langue de Dieu. Cette parole n’a donc pas à être interprétée. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’exégèse coranique – celle-ci est nécessaire pour diverses raisons23 – mais que cette exégèse n’a pas du tout la même signification que l’exégèse biblique. Pour saisir la différence on peut comparer, comme le fait Rémi Brague, le passage de la première épitre aux Corinthiens où saint Paul exhorte les femmes à se couvrir la tête24 lorsqu’elles prient ou prophétisent et les deux passages du Coran relatifs au port du voile par les femmes25. Dans le premier cas, s’agissant d’un texte inspiré par Dieu, « on peut remonter du texte, œuvre d’un écrivain humain, à l’intention qui le faisait écrire26 ». On pourra donc comprendre que saint Paul préconisait un habillement décent qui, dans la culture de son temps prenait la forme, contingente et historique, du voile. Dans le second cas en revanche, s’agissant d’un texte dicté par Dieu dans sa propre langue, la plus claire qui soit, un voile ne peut être qu’un voile et rien d’autre qu’un voile. L’exégèse ne pourra consister qu’à « s’interroger sur la longueur et la transparence du tissu27 », mais on ne pourra pas, comme saint Augustin y exhortait, chercher les intentions de Dieu dans celle de son prophète car celui-ci, enregistreur passif, ne pouvait avoir aucune intention. Cette exégèse s’attachera au sens des mots, mais ne recherchera pas un sens caché derrière les mots. Et de fait l’exégèse coranique traditionnelle, celle de Muqātil Ibn Sulaymān al-Balhī, de Abū Ubayda ou de Tabari est essentiellement philologique. C’est seulement au Xe siècle qu’apparaît dans le mysticisme soufi une exégèse symbolisante et allégorique qui sera constamment rejetée par l’orthodoxie sunnite.
Tandis que la Bible, rédigée au long de huit siècles, se donne comme l’histoire de la révélation, la révélation de Dieu dans l’histoire des hommes, la longue et patiente éducation d’Israël par son Dieu, avec le Coran la révélation se donne « en bloc », non dans la durée mais dans l’instant, dans « la nuit du décret28 », cette nuit qui « est meilleure que mille mois29 », même si cette « descente » est ensuite « fragmentée » dans les vingt-deux années qui la suivent. Cette « descente » ne peut donc être pensée sous la catégorie patristique de la « condescendance divine » qui ouvre la porte à l’exégèse historico-critique. Comment la parole de Dieu pourrait-elle être relativisée par les contextes historiques si, procédant d’un être omniscient qui connaît de toute éternité tous les contextes, elle est « descendue » en sa totalité, formulée dans la langue même de Dieu, en un moment unique de l’histoire ? Or cette difficulté n’est pas sans conséquences sur le problème posé par la violence dans le texte coranique. Celui-ci comporte aussi bien des versets pacifiques qui proscrivent le meurtre ou préconisent le dialogue que des versets belliqueux qui appellent à l’extermination des infidèles. Comme il est impossible que Dieu se contredise, les théologiens musulmans ont élaboré une doctrine, la « science de l’abrogeant et de l’abrogé » (an-nāsih wa l-mansūh) en vertu de laquelle lorsque deux versets entrent en contradiction, le verset le plus récent abroge le plus ancien. Or ce sont les versets les plus anciens, ceux qui datent de l’époque de la prédication mekkoise qui sont les plus pacifiques tandis que ce sont ceux de la période médinoise, postérieurs à l’Hégire, contemporains de l’époque où Mohammad s’est transformé en chef de guerre, qui sont les plus belliqueux. Ainsi les versets pacifiques se trouvent-ils abrogés par celui de la sourate Revenir de l’erreur ou l’Immunité qui appelle à tuer les infidèles à moins qu’ils ne se repentent et se convertissent : « Quand les mois sacrés seront expirés, tuez les infidèles quelque part que vous les trouviez ! Prenez-les ! Assiégez-les ! Dressez pour eux des embuscades ! S’ils reviennent (de leur erreur), s’ils font la prière et donnent l’aumône, laissez-leur le champ libre30».
Les obstacles à l’interprétation
Au Xe siècle on avait ainsi recensé quelque 250 versets abrogés par des juristes dont la préoccupation était de justifier des actions ou des conquêtes militaires. Il y a donc une double historicité des versets belliqueux du Coran, celle, originelle, des luttes de la période médinoise et celle, ultérieure, de l’expansion islamique. Soit le « verset de la guerre » : « Combattez ceux qui ne croient point en Allah[(…] jusqu’à ce qu’ils paient la jizya, directement et alors qu’ils sont humiliés31 ». Comme le rappelle Abdelwahab Meddeb, selon la tradition ce verset « a été révélé dans le contexte d’une des dernières expéditions militaires ordonnées par le Prophète, celle de Tabûk, vers le nord de la péninsule arabique, annonciatrice des conquêtes futures32 ». Voilà qui devrait ouvrir la porte à une contextualisation historique des versets belliqueux qui permettrait d’en relativiser la portée. C’est ainsi que Meddeb préconisait une véritable inversion du principe abrogeant-abrogé de l’exégèse coranique : « Pour que le musulman puisse intégrer l’argumentaire de l’apologiste chrétien, il lui faut au préalable inverser la procédure exégétique fondée sur les notions d’abrogeant et d’abrogé : ce sont les premiers versets purement religieux, notamment révélés à La Mecque, qui doivent l’emporter sur ceux qui ont été inspirés à Médine dans un contexte politique, juridique, militaire, appartenant à une conjoncture datable33 ».
Or cette inversion avait été proposée par le théologien soudanais Muhammad Mahmûd Tahâ dans un ouvrage intitulé Le second message de l’islam. Selon lui il faut distinguer dans le Coran deux messages. Le premier, celui de la période médinoise, comporte des « versets subsidiaires » qui étaient adaptés aux réalités du VIIe siècle, mais ne le sont plus à celles de la société moderne. C’est donc le second message de l’islam, celui de la période mecquoise, respectueux de la liberté religieuse, qui doit servir de base à la législation. En conséquence de quoi il avait réclamé l’abolition de la sharî’a au Soudan ce qui lui valut d’être condamné à mort pour apostasie et pendu à Khartoum le 18 janvier 1985. Comme le dit Rémi Brague « il vaut mieux éviter de soutenir cette théorie hors de France34 ». Ce qui prévaut dans l’ensemble du monde musulman, c’est une exégèse littéraliste du type de celle de Ibn al-Kathir qui développa au sujet du verset de l’épée (Coran IX, 5) une théorie des quatre glaives et qui nomma le verset IX, 29 « verset de la guerre » en précisant qu’il abrogeait le « nulle contrainte en la religion » de la deuxième sourate35 : « L’interprétation de ce verset par Ibn al-Kathîr, écrit Abdelwahab Meddeb, a été corroborée par tant de docteurs qu’elle a fini par constituer la norme qui caractérise l’islam et qui est rappelée par Ibn Khaldûn (1332-1406) : « Dans la communauté musulmane, le jihâd (la guerre légale) est un devoir religieux, parce que l’islam a une mission universelle, et que tous les hommes doivent s’y convertir de gré ou de force36 ». Meddeb raconte que se trouvant à Damas le vendredi 14 septembre 2001, trois jours après les attentats de New-York et de Washington, et s’étant rendu à la mosquée des Omeyyades, il avait entendu un prêche entièrement consacré au verset de l’épée et insistant sur la nécessité de tuer les « associateurs » : « Il y avait là d’évidence une sorte de légitimation implicite du crime qui fit s’effondrer les Twins Towers et éventrer le Pentagone. Voilà jusqu’à quelles connivences peut aller l’islam officiel dans sa banalisation de l’islamisme terroriste et criminel37 ». Ce n’est donc pas seulement l’islamisme, mais c’est « l’islam officiel » qui fait obstacle à des interprétations du verset de l’épée comme celle de Râzî qui insistent, elles, sur le repentir qui nous purifie et nous soustrait à la violence.
Il y a assurément dans l’islam des traditions qui permettraient de libérer le texte coranique de la violence qu’il contient. D’une part celle du Mutazilisme qui apparut au VIIIe siècle, se développa au IXe et déclina à partir du XIe. Il s’agissait d’une théologie rationaliste soucieuse de concilier l’islam avec le logos grec, affirmant le libre-arbitre de l’homme et surtout rompant avec le dogme du Coran inimitable et incréé. Que le Coran soit créé, qu’il ne soit pas coextensif au verbe divin, c’est, on l’a vu plus haut, ce qui rend possible son historicisation et ce qui ouvre donc la porte à une exégèse historico-critique. D’autre part celle du soufisme, courant mystique, spirituel et ésotérique, en rupture avec l’islam des juristes, qui distingue pour chaque verset du Coran un sens apparent (zâhir) et un sens caché (bâtin), ce qui ouvre la voie à une exégèse allégorique. C’est chez un mystique du IXe siècle qu’on trouve pour la première fois la distinction du petit jihâd (la guerre légale) et du grand jihâd (l’effort sur soi). Et au XIIIe siècle Ibn’ Arabî fera du grand jihâd un combat spirituel contre l’arrogance du moi et la violence de ses désirs. Là où les versets coraniques commandent de tuer il faut comprendre qu’ils commandent de tuer le moi égoïste et d’éradiquer le mal qui est en soi. On se trouve là devant une exégèse qui s’apparente à celle qu’Origène ou Dorothée de Gaza appliquaient à l’Ancien Testament.
Cependant le Mutazilisme a disparu au XIIIe siècle et le soufisme a toujours été suspect aux yeux de l’islam orthodoxe aussi bien en raison de son exégèse allégorique que parce que l’expérience spirituelle et mystique à laquelle il invite pourrait mettre en péril l’absolue transcendance de Dieu. Nombre de maîtres soufis ont été exilés ou exécutés dans l’histoire de la civilisation islamique. Très prisé aujourd’hui par les intellectuels occidentaux, il connaît un regain et une faveur dans les pays non-musulmans, mais demeure minoritaire et marginalisé dans les pays musulmans.
Une tâche nécessaire et difficile
Le texte coranique n’a pas le monopole de la violence, on l’a vu plus haut. Cependant comme l’écrivait Abdelwahab Meddeb, « les gens dont la croyance repose sur la Bible ont enclenché un processus d’investigation critique qui les a aidés à neutraliser la violence, à la dépasser comme attribut divin38 ». Purifier le texte fondateur de l’islam de la violence qu’il contient est ainsi une tâche indispensable mais de la difficulté de laquelle il faut être conscient. Aux obstacles théoriques évoqués plus haut s’ajoute celui de l’absence d’un magistère ecclésiastique qui représenterait légitimement la communauté et dont la compétence pour trancher entre les interprétations serait reconnue par tous ses membres. Le dernier calife fut destitué en 1269 et le sultanat ottoman, qui n’avait pas de véritable autorité religieuse, fut aboli en 1924 par Mustapha Kemal. En outre l’islam sunnite qui représente 85% des musulmans sur la planète est dominé par la dynastie saoudienne elle-même liée au courant wahhabite, fondamentaliste et orthodoxe, qui rejette violemment le soufisme. Il nous faut donc soutenir de toutes nos forces les efforts que déploient un certain nombre de musulmans pour trouver dans des traditions marginales de leur religion et de leur civilisation les moyens de réformer et de rénover l’islam, ce qui suppose évidemment qu’on ne confonde pas islam et islamisme, comme on ne manque pas de nous y inviter régulièrement, mais ce qui suppose aussi qu’on ne méconnaisse pas la puissance des forces qui s’opposent à cet aggiornamento et qu’on ne sous-estime donc pas l’ampleur de la tâche.
[Note de l’éditeur, 12 février 2016. Mezetulle attire l’attention des lecteurs sur les commentaires qui suivent cet article, et en particulier sur la réponse d’André Perrin à Jean-Pierre Castel]
Notes
7 Ibid. 11, 12 Il est vrai qu’un peu plus loin dans son dernier discours Josué dit : « Mais s’il vous arrive de commettre une apostasie et de vous lier au restant de ces nations qui subsistent encore à côté de vous, d’entrer dans leur parenté et d’avoir avec elles des rapports mutuels, alors sachez bien que Yahvé votre Dieu cessera de chasser devant vous ces populations : elles seront en ce cas pour vous un filet, un piège, un fouet sur vos flancs et des épines dans vos yeux … » (23, 12-13), ce qui semble indiquer que les Cananéens n’étaient pas destinés à être exterminés. De même dans l’Exode et dans le Deutéronome voisinent des injonctions d’exterminer et des interdictions de nouer des alliances, de conclure des mariages avec les populations qui sont censées avoir été exterminées et d’adopter leurs cultes ou leurs mœurs. Sur ce point lire l’article de Ronald Bergey « La conquête de Canaan : un génocide ? » in La revue réformée Revue de théologie de la faculté Jean Calvin d’Aix-en-Provence N° 225 2003/5 Novembre 2003
10 Cf. Romains 3, 27-30 Galates 2, 16.
11 Matthieu 5, 17 voir aussi Luc 16, 17 et Romains 3.
12 Cf. Félix Bussière Les mythes d’Homère et la pensée grecque, Les Belles Lettres, Paris, 1956.
13 Origène Homélie 8 sur Josué.
15 Dorothée de Gaza Instructions XI.
16 Cf. Thomas Römer Dieu est-il violent ? (2002) Voir aussi Dieu obscur. Le sexe, la cruauté et la violence dans l’Ancien Testament Genève, Labor et fides 1996.
18 Ibid. 9, 7 L’expression est reprise à la fin du livre : « Car le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ». (16, 2).
19 Saint Jean Chrysostome Sur l’incompréhensibilité de Dieu Discours III, Cerf, 1951, p. 176.
20 Saint Augustin Les confessions Livre XII ch. 23.
21 Louis Massignon Situation de l’Islam, 1939, in Opera minora, t. I, p. 16.
22 Coran XVI, 103 et XXVI, 195.
23 Mahomet qui ne savait vraisemblablement pas écrire récitait les sourates reçues à ses compagnons et ceux-ci les ont transcrites de façon fragmentaire, mais le texte définitif du Coran ne fut établi que 25 ans après la mort du prophète. Or l’écriture coranique était défective, qui ne notait que les consonnes et trois voyelles longues : c’était au point de départ un simple support mnémotechnique au service de la récitation d’un texte déjà connu. Il en résulte de nombreuses ambiguïtés qui font du Coran un texte particulièrement obscur. En outre il y a dans le Coran comme dans la Bible de multiples versets qui entrent en contradiction les uns avec les autres.
24 I Corinthiens, 11, 3-15.
25 Coran XXIV, 31 et XXXIII, 59.
26 Rémi Brague « Quelques difficultés pour comprendre l’islam », Conférence à l’IRCOM 7 décembre 2012.
28 Ou nuit du destin (Laylat Al Qadr).
32 Abdelwahab Meddeb « Le Dieu purifié » in La conférence de Ratisbonne Bayard 2007 p. 91
33 Abdelwahab Meddeb Sortir de la malédiction Seuil Points-Essais 2008 p. 123-124
34 Rémi Brague et Abdennour Bidar « Les versets de la discorde » Philosophie magazine n° 87 mars 2015 p.46
35 Dont il est d’ailleurs douteux qu’il signifie ce qu’on lui fait dire habituellement. Il faut lire la totalité : « Nulle contrainte en la religion ! La Rectitude s’est distinguée de l’Aberration. Celui qui est infidèle aux Tâghout et croit en Allah s’est saisi de l’anse la plus solide et sans fêlure ». Selon Rémi Brague il faut comprendre qu’on n’éprouve aucune contrainte quand on a embrassé la vraie religion – autrement dit que la vérité nous rend libres.
36 Abdelwahab Meddeb « Le Dieu purifié » art. cit. p. 92 et Ibn Khalddûn Le livre des exemples Paris, Gallimard, Pléiade, 2002, I, p.532.
38 Abdelwahab Meddeb Sortir de la malédiction, op. cit. p. 137.
© André Perrin et Mezetulle, 2015.