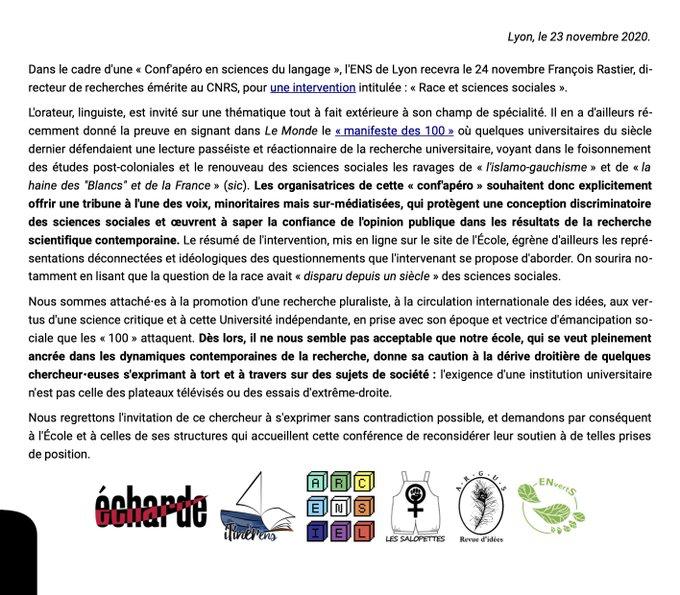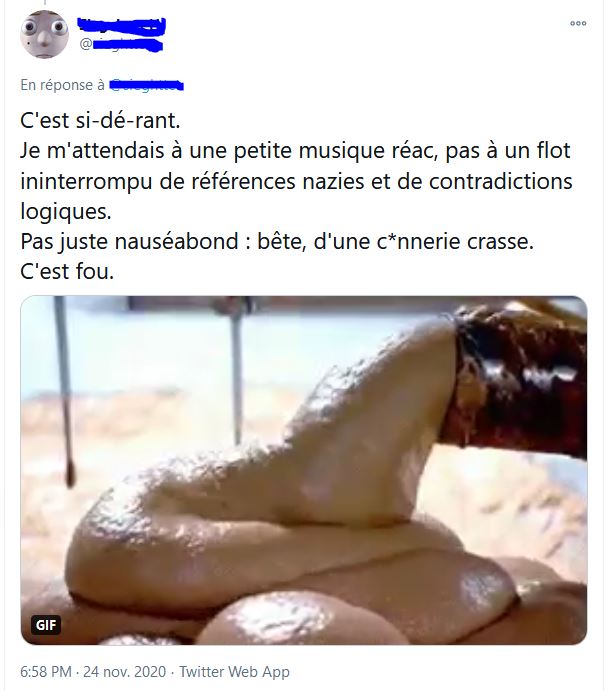Jean Szlamowicz1 a assisté à la conférence « Race et sciences sociales » que François Rastier a donnée à l’ENS de Lyon le 24 novembre 2020. Après de multiples attaques à la suite de la publication d’une série d’articles dans Non Fiction2, la conférence de François Rastier a de nouveau été l’occasion de protestations et d’assauts « qui avaient peu à voir avec un débat normal ». L’auteur en livre ici l’analyse, qu’il fonde sur l’examen de leurs « techniques argumentatives », lesquelles n’ont d’autre objet que de faire taire toute contradiction et de mettre en place une idéologie d’éradication de la culture.
François Rastier, sémanticien, auteur entre autres de monographies sur Heidegger et Primo Levi, a récemment été victime d’attaques pour ses articles parus dans Non Fiction portant sur les dérives des sciences sociales vers le militantisme décolonial3. Ces attaques ont été le préambule de protestations contre sa conférence à l’ENS-Lyon (24 novembre 2020, « Race et sciences sociales »), dénoncée par un communiqué inter-associatif de l’ENS. La conférence s’est tenue, mais il a dû subir des assauts lors du débat qui a suivi qui avaient peu à voir avec un débat normal étant donné leur caractère outrancier. La violence des attaques s’est poursuivie sur Twitter et — ce qui prend une ampleur se rapprochant de la censure — par l’ENS même qui a refusé de mettre en ligne sa conférence et s’était initialement refusée à la lui fournir. Il l’a finalement obtenue, mais elle n’est pas diffusée sur le site de l’ENS comme c’est l’usage4. Comment en arrive-t-on à la damnatio memoriae dans une institution censément garante d’une réflexion intellectuelle de haut niveau ?
Nous avions déjà réagi à la pauvre argumentation qui avait suivi la publication des articles de François Rastier dans un article intitulé « Nouvelles techniques de surveillance et de dénonciation idéologique »5. Le présent article en est le prolongement et se concentre à nouveau sur les techniques argumentatives (je n’ai pas dit les arguments, qui sont aux abonnés absents)6.
Stratégie rhétorique de base
Quand la rhétorique a uniquement pour objectif de délégitimer l’adversaire et ne se soucie ni d’en dévoiler l’argumentation ni de faire valoir les idées qu’on lui oppose éventuellement, on tombe dans un dispositif discursif qui n’a plus rien à voir avec le cadre de la discussion raisonnée telle qu’elle se pratique dans la recherche.
Nous l’avions déjà noté7, la caricature des arguments de François Rastier et l’hyperbolisation des critiques contreviennent fondamentalement au débat qui n’a, dès lors, plus lieu d’être. Si les attaques ne reposent que sur l’agressivité et non la démonstration, alors la mauvaise foi bloque la possibilité d’un échange et la production de la pensée — ne reste qu’un pugilat rhétorique sans intérêt. C’est d’autant plus troublant que le communiqué préalable à la conférence8, les réactions des personnes présentes et les attaques sur Twitter affichent une incompréhension complète des propos de François Rastier.
La paraphrase excessive et axiologisée, en résumant la pensée de François Rastier par des raccourcis réduits à des mots clés (« homophobe », « nazi », « dérive droitière »), en déforme le contenu. En effet, au lieu de rendre compte des propos incriminés, il s’agit uniquement de les qualifier de manière négative : cette condensation mal intentionnée repose sur le déni des propos réellement tenus et de leur intention argumentative.
Nous avons remarqué, en temps réel, une incroyable surdité de personnes qui, même face au démenti et aux explications patientes de François Rastier, répétaient les mêmes reproches sans entendre ni comprendre les réponses.
Association incantatoire et allusion déformante
Quand un tweet9 se déclare écœuré par « un flot ininterrompu de références nazies », l’allusion suffit à associer la conférence au nazisme, alors qu’elle en constituait précisément une critique. Un tel rapprochement allusif, en commettant un contresens volontaire, porte la malhonnêteté et la mauvaise foi au pinacle.
En effet, François Rastier retrace la généalogie philosophique des idées contemporaines, qu’il fait remonter, via Derrida, à Heidegger qui masquait dans le jargon philosophique un principe völkisch, c’est-à-dire un ancrage ontologique dans l’expression du peuple, spécifiquement allemand. En résulte un projet de destruction de la rationalité propre aux sciences de la culture qui, selon le point de vue heideggerien, sont à remplacer par l’exaltation mystique du génie du peuple. François Rastier montre comment le projet heideggerien s’incarne aujourd’hui dans la célébration identitaire et le retour du racialisme dans le champ politique, citant effectivement des auteurs pour qui « la race, cela existe ».
Évidemment, cette conception de la race est sociale et non plus génétique : ce tour de passe-passe assez faible continue néanmoins à se fonder sur la couleur de peau, articulant ainsi par un binarisme que rien ne justifie factuellement une opposition entre « Blancs » et « Racisés », polarisation simpliste, ethnocentrique, trompeuse et sans la moindre prise en compte des variations socio-historiques (comme si toutes les sociétés occidentales étaient les mêmes, comme si le reste du monde était exempt de racisme, etc.). La philosophie de la déconstruction pratique ainsi des dénonciations sélectives de l’oppression, lesquelles ne visent que l’Occident. À cet égard, la seule mention du « post-colonialisme » est en soi frauduleuse en ce qu’elle conceptualise l’idée de colonisation par l’article défini : la colonisation implique qu’il n’y en a qu’une et promeut ainsi l’idée manichéenne d’un Occident malfaisant tout en taisant l’incidence qu’une telle théorie devrait accorder à l’impérialisme ottoman, chinois ou islamique. Il en va de même de « l’esclavage », dont l’article défini renvoie là aussi au seul commerce triangulaire et non à la généralité de la pratique esclavagiste dans l’histoire de l’humanité — et à sa continuité contemporaine, notamment dans des contextes islamiques (Mauritanie, Soudan, Libye…).
Il s’agit donc d’associer une connotation de négativité au nom de François Rastier auquel on reproche simultanément un « point Godwin » et de procéder à des « rapprochements « à la louche » entre le nazisme de Heidegger, les propos de Houria Bouteldja, le terroriste Carlos ou encore les Principes de la communauté chez Pétain ». Ses propos, loin d’être « à la louche », procèdent justement de l’analyse des textes et sont étayés par des citations et des propos de penseurs décoloniaux revendiquant une lecture raciale s’appuyant sur un vocabulaire explicitement essentialisant (« blanchité », « racisé »). L’emploi de la locution « à la louche » a deux effets : par son registre, la formule discrédite le conférencier, comme s’il ne méritait pas une analyse plus fouillée ; par l’expression imagée et hyperbolique, on lui impute une approximation qu’on s’abstient ainsi de démontrer précisément parce que la formulation en souligne l’évidence. Ce niveau de langue a donc une véritable efficace argumentative et permet de brûler les étapes de la démonstration pour directement accuser un discours et une personne.
Dans le communiqué inter-associatif des étudiants de l’ENS (voir documents en Annexe 2 ci-dessous), on note l’accusation d’une « conception discriminatoire des sciences sociales ». Que peut bien signifier discriminatoire dans ce contexte ? Le propos critique de François Rastier est justement — comme en témoigne sa conférence elle-même — de replacer l’humanisme, les données, la méthode au cœur des sciences sociales afin qu’ils ne se transforment pas en chantier d’essentialisation du genre et de la race. Comment peut-on lui imputer un discours inverse ? En quoi est-ce « une lecture passéiste et réactionnaire » ? Ces derniers adjectifs ont-ils la moindre portée apodictique ?
Le conférencier est par ailleurs qualifié comme étant « une des voix minoritaires mais sur-médiatisées ». Considérer François Rastier comme surmédiatisé par rapport aux militants décoloniaux que sont Houria Bouteldja ou Rokhaya Diallo relève, là encore, de la mauvaise foi. Ou alors, je ne m’étais pas aperçu de l’omniprésence télévisuelle de mon collègue. C’est évidemment un argument d’autorité inversé qui valide les opposants en les posant comme victimes d’un courant dominant omniprésent.
Remarquons aussi l’allusive accusation de « contradictions logiques » qui sont d’autant moins démontrées qu’elles ne sont même pas citées. Le tweet a ceci d’efficace qu’il permet l’indignation sans avoir à s’en expliquer…
L’accumulation d’épithètes négatives (« nazi », « réactionnaire », « surmédiatisé », « passéiste ») crée un effet d’abondance qui vaut argument en lui-même. On parle en rhétorique de conglobation pour caractériser cette façon de décliner la même idée de multiples manières. Ici, le procédé permet de produire de la négativité par association. Mêmes faibles, les arguments finissent par paraître irrésistibles du fait de leur seul déploiement quantitatif.
La délation cool
Le tweet déjà cité et reproduit sur Academia s’accompagnait d’une image de pompe à merde. L’écœurement n’est pas un argument et l’hyperbole dont il témoigne entend délégitimer le discours, comme si l’image scatologique était le seul équivalent pensable au discours tenu durant la conférence. Mais pourquoi pas, après tout ? Le procédé imagé et potache pourrait refléter une forme d’humour si son systématisme ne trahissait une volonté d’éviter l’argumentation pour privilégier la pure indignation morale. C’est du reste l’un des thèmes de la conférence que d’avoir souligné l’utilisation du pathos comme argument, de l’émotion comme principe et de la leçon de morale comme axe fondateur.
Le langage familier, voire ordurier, n’est pas innocent. C’est précisément parce qu’il abolit le registre scientifique ou philosophique qu’il acquiert une fonction argumentative : en ne se plaçant pas sur le terrain langagier du conférencier, on dénie à ce dernier la spécificité de son expression et on lui substitue un niveau de langue avilissant. L’image se substitue à l’argument. La figuration de l’abject tient lieu de démonstration.
Corollaire scandaleux, ces divers commentaires se livrent sans vergogne à des clichés âgistes qui contredisent toutes les prises de position soi-disant ouvertes, pluralistes et généreuses des militants. On frémit de constater qu’ils peuvent délégitimer quelqu’un non pour ses arguments mais pour son âge : on peut deviner ce que seraient les réactions si on disqualifiait quelqu’un pour son poids, son sexe, sa couleur de peau. Mais, pour l’âge, tout est permis : le sémanticien est donc qualifié de « papy » (avec orthographe modernisée ?), ce qui laisse penser toute l’affection que les normaliens peuvent avoir pour leurs propres grands-parents.
Ils rappellent que François Rastier est une « personne retraitée de 75 ans continuant de se prévaloir du titre réglementaire de ‘directeur de recherches émérite au CNRS’, comme si ce titre était décerné à vie ». Proposent-ils donc qu’on lui dénie toute existence sociale ? Qu’on appose une date de péremption sur ses futures conférences ? Il n’est pas le seul visé puisqu’il fait partie de ces « universitaires du siècle dernier » qu’il s’agit de conspuer. L’argument de la nouveauté, nul et non avenu sur le plan intellectuel, est pourtant revendiqué de façon redoublée (« renouveau des sciences sociales », « la recherche contemporaine », « en prise avec son époque »). Croire que la nouveauté serait la preuve de quoi que ce soit, c’est croire en une religion du progrès qui se confond avec l’âge que l’on a. Visiblement, ce sont les hormones du narcissisme social qui parlent ici. N’ont-ils donc pas conscience que leur jeunesse est appelée à se périmer ?
Un niveau de langue et de péjoration où l’on décrit une pensée à l’aide de qualificatifs comme connerie, bête, nauséabond fait l’ellipse de la démonstration. L’intensité descriptive mime l’indignation comme si elle était au-delà de toute démonstration. Mais l’ironie et l’hyperbole ne sont pas des arguments. Certes, ce ne sont pas non plus des traits d’expression indignes car les figures de style ne sont pas en soi à condamner — est-il seulement possible de s’exprimer sans hyperbole ou sans ironie ? Le problème est qu’elles constituent ici un masquage argumentatif, transférant les idées dans l’inargumentable et l’indicible. Si l’on est en droit de juger qu’une idée est « une connerie », il faut normalement le prouver si l’on se situe dans le débat d’idées. Or, le propre de ces discours est qu’ils jugent mais ne débattent pas. Ils ne s’adressent qu’à leurs « potes ». C’est un discours de la connivence et non de la démonstration. Le problème est qu’il est public et qu’il revendique une censure sans avoir d’autre étayage que la seule indignation de son entre-soi idéologique.
L’aveuglement sémiotique
Cette indignation signalétique est en outre assortie d’une bonne dose d’ignorance. Les militants confondent les mots et les choses. Quand François Rastier parle du concept de race pour en évoquer le caractère éventuellement fragile, on lui rétorque « alors vous niez le racisme ». François Rastier a beau expliquer que les identités ne sont pas des essences, les militants croient que les mots désignent des choses. Les concepts sont des constructions sémantiques et culturelles, grammaticales et idéologiques. C’est peine perdue que de tenter une clarification tant il n’est pire sourd que celui qui refuse d’entendre ce qui contrecarre ses préjugés. On notera donc que ces gens-là ne font pas de différence entre onomasiologie (partir d’une idée) et sémasiologie (partir de l’examen du signe linguistique). On peut étudier « le racisme », mais il faut, tout de même, comprendre que le mot racisme a des usages variés… Cela fait quelques décennies que l’on a parlé de linguistic turn pour cette conscience de la matérialité langagière des concepts philosophiques.
Mais, réagissant avec la virulence pavlovienne d’idéologues qui prennent les mots pour des signaux, ils aboient en retour « nazi », « homophobe », « connerie » et prétendent que pour François Rastier, « le racisme n’existe pas » alors qu’il expliquait la nuance entre le concept et la chose. On entend les militants répéter : « C’est une construction sociale », sans que cela participe d’un propos autre que mécanique. Car, dans la société, qu’est-ce qui pourrait relever d’autre chose que de l’élaboration culturelle et échapper à ce diagnostic ? Depuis la culture des petits pois jusqu’à l’antisionisme, qu’est-ce qui n’est pas une construction sociale ?
On aussi entendu des reproches proférés dans une langue pseudo-technique, mal maîtrisée et prétentieuse. Un auditeur jouait les donneurs de leçons en confondant « épistémique » et « épistémologique », ignorant des usages du mot différents en philosophie et en linguistique. Sa question acerbe mais peu claire lui permit de se déclarer peu satisfait de la réponse. Il n’utilisait de toute manière sa formulation contournée que pour faire chic, pour donner une impression de hauteur dédaigneuse. C’est assez mal venu quand on parle à un sémanticien tel que François Rastier avec l’œuvre qu’on lui connaît !…
L’argument d’autorité
La récurrence d’accusations d’incompétence a priori est un topos de la critique militante dans le champ de la recherche universitaire. Il faut toujours accuser l’autre d’incompétence. Le communiqué considère donc que François Rastier est « invité sur une thématique extérieure à son champ de spécialité »10.
Un champ de spécialité indique une connaissance qui peut effectivement être mal maîtrisée par d’autres et il est normal qu’un expert en statistiques, par exemple, puisse corriger l’usage profane fautif qui serait fait de données par des non-spécialistes11. Cela ne constitue pas pour autant un talisman sanctifiant une parole, sauf à considérer que seuls les étudiants de Sciences Po auraient le droit de parler de politique.
Qu’un linguiste s’exprime sur la méthodologie des sciences de la culture ne semble pas sortir de son champ. Et on ne voit pas pourquoi un physicien, un biologiste ou un économiste n’auraient pas le droit, eux, d’en parler. Si on considère que les domaines sont étanches entre eux, il va falloir interdire à beaucoup de gens de parler de beaucoup de choses — et au passage considérer que les gens sans diplômes n’ont le droit de s’exprimer sur rien. Il est surprenant de voir des étudiants décider de qui a le droit de parler de quoi. Cette conception hautaine et technocratique du savoir n’est qu’une confiscation de l’argument d’autorité par une caste de donneurs de leçons. A exhiber un tel mépris , les normaliens ne se grandissent pas.
Les spécialités intellectuelles impliquent une expertise, pas des pouvoirs magiques ni une infaillibilité doctrinale : tous les économistes, historiens, linguistes n’ont pas la même vue sur tous les sujets. L’argument ad hominem est donc non seulement infondé, mais mesquin et prétentieux. Venant d’étudiants, l’argument d’autorité est même passablement risible et largement auto-invalidant.
Pire encore, les attaques qui ont visé François Rastier ont pris la forme de mises en cause s’attaquant à la respectabilité de sa personne. Avant même que la conférence n’ait eu lieu, on a pu lire une virulente diatribe anonyme de la « revue d’idées » (sic) nommée Argus qui a publié sur sa page Facebook les propos suivants, à la fois agressifs, dénués d’arguments concrets et à la syntaxe surprenante :
« François Rastier est un linguiste émérite : qu’a-t-il de pertinent à dire sur ce thème ? […] Ce genre de propos invite à la radio, dans des feuilles de chou médiocres et sur des plateaux grimant un bar PMU fantasmé, il ne devrait pas ouvrir les portes de l’ENS, qui fait partie des institutions visées par ces propos d’une brutalité rare. La question du Conf’Apéro est importante, elle est traitée par de nombreuses recherches, non parce qu’il s’agit de répondre à un agenda politique que traiter avec nuance, minutie et précision une question centrale pour la compréhension du monde sociale. Les propos de F.Rastier et consorts sur la question n’en prennent pas compte. Ils sont d’une médiocrité insupportable et l’ENS de Lyon ne devrait pas les valider. » (sic) (voir publication Facebook dans les documents en Annexe 2 ci-dessous).
Argument d’autorité, argument ad personam, apodioxe : c’est là toute la panoplie rhétorique de la bassesse. L’exhibition de l’exaspération s’autorise de son indignation pour ne ressasser qu’une évidence agonistique incapable de se fonder en raison : ces opposants ne sont pas d’accord avec François Rastier, mais l’enflure hyperbolique et insultante de leur propos est la seule justification qu’ils parviennent à donner à leur désaccord.
L’hémiplégie idéologique ou la censure revendiquée
« Nous sommes attaché.es à la promotion d’une recherche pluraliste, […] dès lors il n’est pas acceptable que notre école […] donne sa caution à la dérive droitière de quelques chercheurs-euses s’exprimant à tort et à travers sur des sujets de société : l’exigence d’une institution universitaire n’est pas celle des plateaux télévisés ou des essais d’extrême droite »
Une simple remarque : dans la même phrase, on revendique au nom du pluralisme de ne pas inviter des conférenciers au motif d’une étiquette qu’on leur attribue. Une telle logique est, en soi, dirimante.
De plus, considérer que des concepts-épouvantail aussi simplistes que l’étiquetage « droite » et « extrême droite » constituent un fondement de consensualité, c’est avoir le narcissisme de croire que tout le monde possède le même système de valeurs et de référence. On pourra se reporter à l’ouvrage de Simon Epstein Un paradoxe français : Antiracistes dans la Collaboration, antisémites dans la Résistance (2008, Albin Michel) pour explorer l’inanité de telles catégories. Outre le caractère peu opérant de ces notions, qui ne sont d’ailleurs utilisées ici que pour leur valeur d’insulte, François Rastier est justement occupé à dénoncer les dérives totalitaires, antisémites et racialistes de sciences sociales qui se fondent sur l’identitarisme et un sentiment de supériorité morale et non plus sur un protocole méthodologique vérifiable et falsifiable.
On note aussi le chantage désormais bien établi consistant à réclamer une réponse et un débat a priori : « Nous regrettons l’invitation de ce chercheur à s’exprimer sans contradiction possible ». Cette lamentation attristée fait mine d’être victime d’une parole omnipotente écrasant la liberté d’expression… dans un communiqué réclamant sa censure ! Leur partialité est telle qu’elle ne se rend même pas compte de sa contradiction.
Il s’agit là d’un artifice d’intimidation. Cela revient à considérer que toute prise de parole (adverse, bien sûr…) devrait être accompagnée d’une tutelle permettant de l’annuler et ne saurait se formuler que dans un cadre imposé et nécessairement conflictuel. C’est une conception du débat dénuée d’horizon heuristique, qui relève du spectacle et de la confrontation et ne cherche pas véritablement à construire une pensée dans le dialogue. Si chacun devait s’exprimer sous la surveillance d’un adversaire malveillant en maraude, on imagine assez le peu de conférenciers qui accepteraient une telle pression. C’est bien un rôle de surveillance et de milice intellectuelle que s’octroient ces partisans de la liberté académique, de l’émancipation et de l’esprit critique (ce sont les termes qu’ils choisissent pour se représenter : les mots du marketing idéologique, créateurs d’un consensus manipulateur — qui serait contre ces notions ?).
La démarche consistant à vouloir faire taire quelqu’un pour les opinions qu’on lui attribue témoigne d’une conception totalitaire puisqu’on ne tolère en fait que les opinions qu’on partage. Une conception aussi limitée du pluralisme ne peut aboutir qu’à la radicalisation et à l’exclusion : l’adversaire est nécessairement une ordure à éliminer (le mot ordures est revenu dans les tweets). Cette absence de demi-mesure est le signe même de la radicalité et du fondamentalisme. Le décolonialisme en est donc déjà là. De la Sainte Ligue jusqu’à l’islamisme, en passant par le nazisme et le stalinisme, les idéologies radicales n’envisagent pas la différence d’opinion comme tolérable. C’est précisément en cela que de telles idéologies doivent être combattues par les démocraties dont le principe place le débat au centre de la dynamique politique.
Dans ces formations discursives intolérantes (comme chez Heidegger), il n’y a pas de débat, il n’y a que des vérités. C’est précisément ce dispositif que François Rastier avait rappelé en montrant que les cultural studies devenues militantes posaient un rapport de domination a priori et le déclinaient, proposant de vérifier des préjugés et non de construire des données et des interprétations selon une méthode. Le militantisme décolonial et inclusiviste de ceux que j’appellerai désormais les « déconstructeurs » n’est que la sempiternelle reconduction d’un discours qui s’auto-valide, discours prophétique qui, ivre de sa vertu, propose ni plus ni moins d’éliminer jusqu’à la mémoire de ses adversaires. Cancel culture, c’est-à-dire l’idéologie de l’éradication.
En une forme de manifestation involontairement exemplaire, les propos et les comportements des militants, ainsi que leurs pressions sur les institutions — dont on attend qu’elles parviennent enfin à s’extraire de leur lâcheté — constituent la démonstration même de leur nocivité agressive qui précarise la liberté d’expression. C’est donc bien une preuve patente que les militants se réclamant de la déconstruction décrite par François Rastier n’ambitionnent pas de faire œuvre scientifique, mais de faire taire toute contradiction.
Annexes
1 – Quelques écrits de François Rastier
- « Sexe, race et sciences sociales », Non Fiction, 26 octobre-2 novembre 2020.
- « Écriture inclusive et exclusion de la culture », Cités, vol. 82, no. 2, 2020, pp. 137-148. Sur le site Cairn https://www.cairn.info/revue-cites-2020-2-page-137.htm
- Heidegger, messie antisémite. Ce que révèlent les cahiers noirs, Le bord de l’eau, 2018.
- Extermination et littérature. Les témoignages inconcevables, PUF, 2019
- Naufrage d’un prophète. Heidegger aujourd’hui, Paris, Presses universitaires de France, 2015, 288 pages
- « De Primo Levi au chic nazi, entretien entre François Rastier et George-Elia Sarfati », Revue Controverses n°10, mars 2009. http://www.controverses.fr/pdf/n10/rastier-sarfati10.pdf
- Ulysse à Auschwitz, Éditions du Cerf, 2005 (Prix de la Fondation Auschwitz).
2 – Documents
- Vidéo de la conférence de François Rastier sur la chaîne Youtube du Réseau de Recherche contre le racisme et l’antisémitisme https://www.youtube.com/watch?v=5XtK0n1lYbE
- Communiqué interassociatif contre la venue de F. Rastier à l’ENS (copie d’écran) :
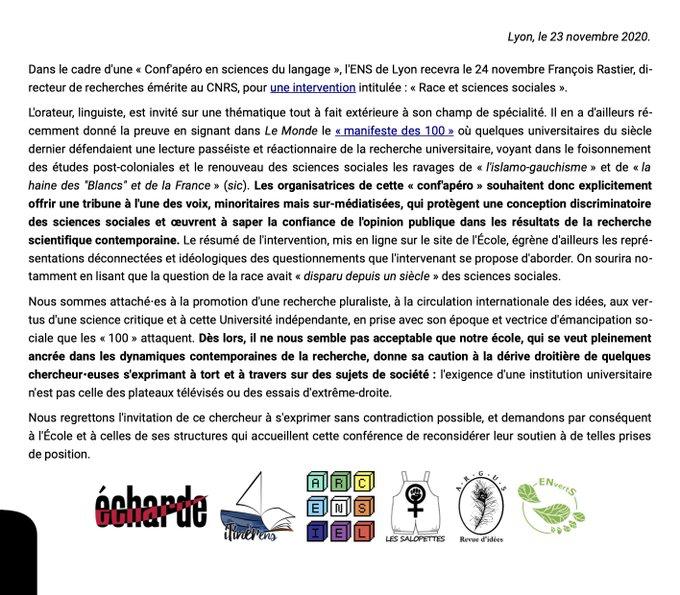
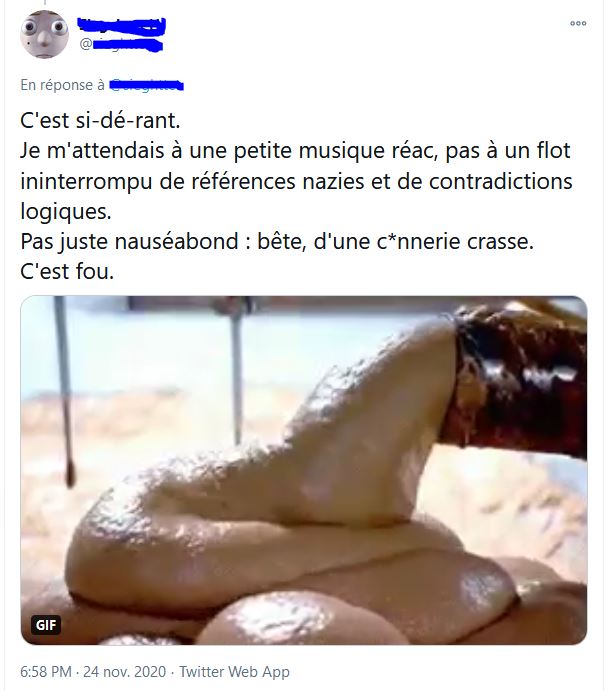
- « Argus, revue d’idées »
Publié le 24 novembre à 9h34 sur la page Facebook de la revue
« Argus participe au communiqué inter-associatif contre la venue de François Rastier à l’ENS de Lyon pour une « Conf’apéro » sur le thème : « Race et sciences sociales ».
Nous sommes les premiers à à se battre pour un débat d’idées, pour la transmission du savoir et la lecture des oeuvres d’autrui. Or, nous sommes alors les premiers à dire que ces éléments s’inscrivent toujours dans un contexte, entre certains groupes sociaux et bel et bien selon un rapport de force. Ces choses là sont acquises y compris dans les éthiques de la discussion les plus consensuelles comme celle d’Habermas.
François Rastier est un linguiste émérite : qu’a-t-il de pertinent à dire sur ce thème ? Il y est intéressé en raison de sa participation au Manifeste des 100, tribune signée par d’anciens et anciennes universitaires et beaucoup d’essayistes contre « l’islamo-gauchisme » rampant au sein de l’ESR français autour de ces questions.
Ce genre de propos invite à la radio, dans des feuilles de chou médiocres et sur des plateaux grimant un bar PMU fantasmé, il ne devrait pas ouvrir les portes de l’ENS, qui fait partie des institutions visées par ces propos d’une brutalité rare. La question du Conf’Apéro est importante, elle est traitée par de nombreuses recherches, non parce qu’il s’agit de répondre à un agenda politique que traiter avec nuance, minutie et précision une question centrale pour la compréhension du monde sociale.
Les propos de F.Rastier et consorts sur la question n’en prennent pas compte. Ils sont d’une médiocrité insupportable et l’ENS de Lyon ne devrait pas les valider.
Ici, ce n’est pas François Rastier en tant que chercheur qui est invité, c’est le polémiste. L’ENS de Lyon n’a pas à inviter un polémiste qui attaque et méprise un monde qui l’a pourtant soutenu et nourri. »
Notes