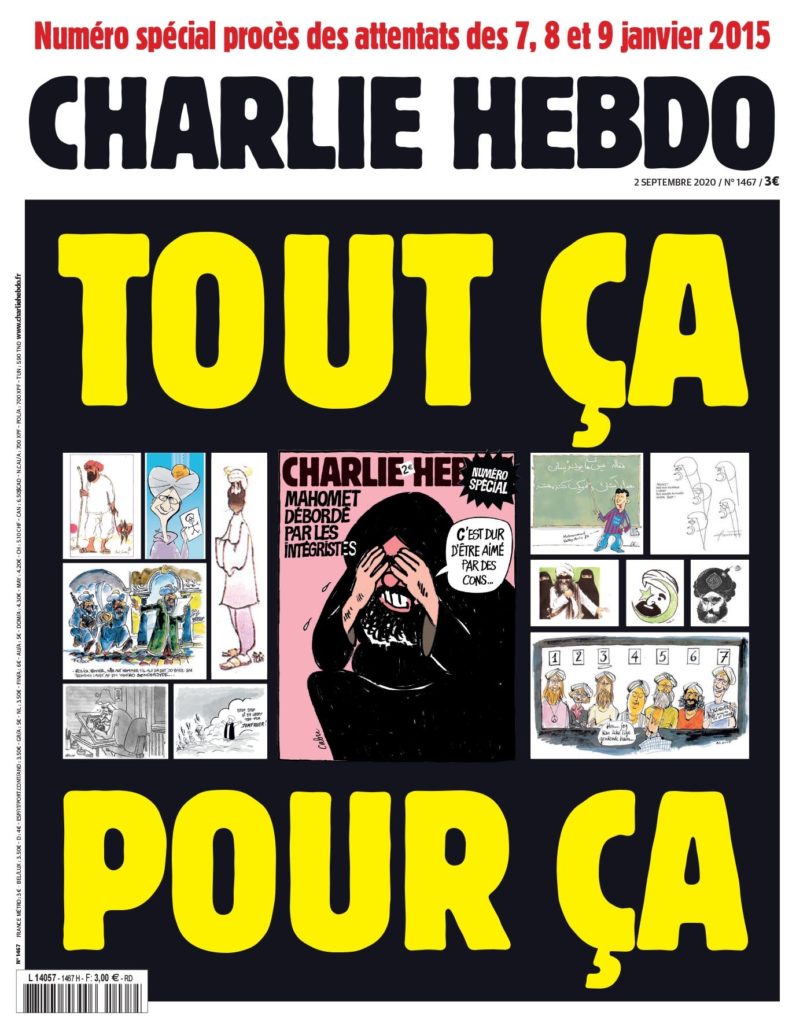À l’occasion du vingtième anniversaire de la loi du 15 mars 2004 sur l’interdiction des manifestations ostensibles d’appartenance religieuse à l’école publique, on trouvera quelques textes de réflexion en ligne – sur Mezetulle et ailleurs -, ainsi que le rappel de quelques documents. Le dossier est susceptible de s’enrichir.
- Gérard Delfau, 26 mars 2024, Vingtième anniversaire de la loi dite « sur le voile »
- Catherine Kintzler, 27 mars 2024, La loi du 15 mars 2004 a vingt ans : quelques réflexions
- [à paraître] recension du livre de Iannis Roder, Alain Seksig et Milan Sen Préserver la laïcité. Les 20 ans de la loi de 2004, éd. de l’Observatoire, 2024.
Antérieurement
- Catherine Kintzler, 10 décembre 2023, Laïcité scolaire : une règle claire à valeur éducative, dans Le Droit de Vivre.
- CK, 14 septembre 2023, Abaya : le fonctionnement de la laïcité scolaire
Documents
- Rapport de la « Commission Stasi », décembre 2003 https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/034000725.pdf
- « Profs, ne capitulons pas ! » (Élisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Élisabeth de Fontenay, Catherine Kintzler). Appel publié dans Le Nouvel Observateur du 2 novembre 1989 https://www.mezetulle.fr/wp-content/uploads/2024/03/Appel-ProfsNeCapitulonsPas.pdf