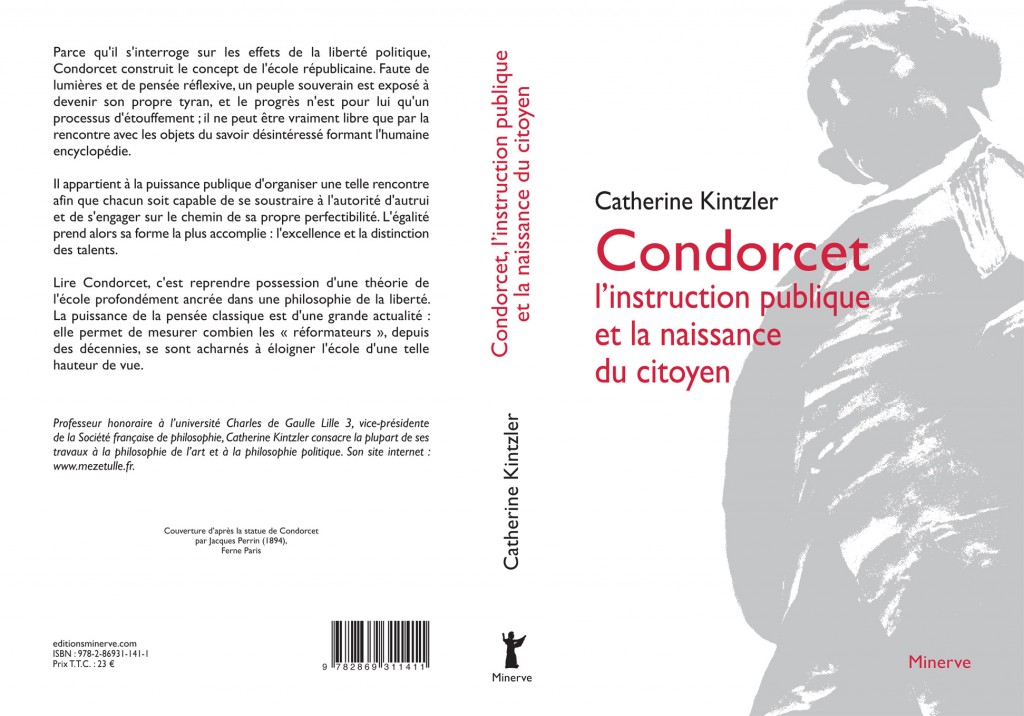Infatigable lecteur critique des indigestes et indigents textes officiels consacrés à l’enseignement de la musique, Dania Tchalik offre à Mezetulle pour cette rentrée scolaire une analyse alerte, grinçante et perspicace de la seconde version du « Rapport Lockwood » intitulée « Transmettre aujourd’hui la musique ».
Le 21 juin 2016, jour de Fête de la Musique par la grâce de Jack Lang, le gouvernement a dévoilé sur son site officiel une mouture rénovée (refondée ?) du Rapport1 confié à Didier Lockwood, célèbre violoniste de jazz mais aussi (et surtout) ancien vice-président du Haut Conseil à l’Éducation artistique et culturelle2. Le milieu de la musique se souvient avec horreur d’une première version particulièrement prolixe en démagogie parue voici quatre ans3 ; nous étions alors sous les heures sombres du sarkozysme mais les esprits naïfs ignoraient que les artistes subventionnés et les ronds-de-cuir avaient pour point commun d’échapper aux joies de l’alternance politique. C’est donc fort logiquement que la majorité suivante a reconduit sa confiance à cet éminent expert, tout en prenant soin de différer la parution du nouveau chef d’œuvre de plus d’un an, sans doute en attendant une fenêtre d’opportunité. Celle-ci s’est présentée tout récemment, à la faveur des sorties quelque peu osées de l’inspection des affaires culturelles de la Ville de Paris à propos de la pédophilie supposée des professeurs des conservatoires4. Le ministère de la Culture n’a certes plus d’argent mais il lui reste les idées (parfois insolites) et les conseillers en communication : quand la piétaille se rappelle au bon souvenir de ses dirigeants, le mieux est de la divertir ou de lui donner un os à ronger…
Le texte préconise une introduction massive de la pratique orchestrale à l’école : cette fois, ce n’est plus l’indépassable modèle finlandais qui est à l’honneur mais le Venezuela d’El Sistema5. Quelques déclinologues clament à l’envi que la France se tiers-mondise et on serait presque tenté de leur donner raison : pendant que l’État se désengage du financement des conservatoires existants6 et retire son agrément à certains d’entre eux, certaines mairies n’hésitent plus à faire passer leurs écoles de musique sous statut associatif (ce qui a pour effet de faire monter les tarifs), les refus d’inscription se multiplient par manque de place et de postes de professeurs, les concours de recrutement sont sans cesse ajournés7… Mais ce ne sont que broutilles pour des autorités qui préfèrent brocarder le cours individuel, cet archaïsme élitiste qui assure le caractère spécialisé de l’enseignement, pour mieux imposer l’Éducation artistique et culturelle, grande cause nationale s’il en est, et son « déploiement des pratiques collectives ». Dès lors, la mécanique culpabilisatrice est enclenchée et toute ressemblance avec l’actuelle réforme du collège8 ne saurait être qu’un pur hasard : comme l’a fort élégamment formulé un directeur de conservatoire dans le coup, « les doués et les riches n’ont pas besoin d’écoles » !
Entre sensiblerie new age et relativisme culturel
Mais le nouveau rapport Lockwood n’est pas un texte ministériel comme les autres : il porte une griffe artistique qui n’appartient qu’à son signataire. Le lecteur est ainsi invité à imaginer un « sublime symbole » : « à l’heure où les fanatismes et les conflits identitaires refont funestement irruption sur le devant de la scène publique », « toutes les écoles de France se rassemblent autour de la pratique musicale collective, mais aussi des autres formes d’expression artistique, pour construire ensemble un modèle de citoyenneté irrigué par les diverses constellations du sensible ». Les pistes pédagogiques proposées sont à l’avenant : à l’entame d’une séquence, « il est fondamental d’instaurer un silence inchoatif et de le faire ressentir [aux élèves], non comme un abyssal vide anxiogène associé à l’image de la mort, mais a contrario comme le berceau des possibles dans leur infinité ». À noter que ce « rituel inaugural », que l’on imagine quelque part entre Woodstock et le club de spiritualités alternatives (sans oublier les meilleurs happenings made in ESPE, ex-IUFM), sera « directement confié aux élèves puisque le dépassement des problèmes de discipline passe par la responsabilisation des enfants ». On imagine aisément la scène dans une école de zone sensible… Toujours est-il qu’après avoir « discerné l’harmonie du silence », des « jeux ludiques » [sic !] favoriseront « une prise de conscience du corps, de ses centres énergétiques et de ses mécanismes respiratoires inhérents à l’incarnation du rythme et du son, afin de générer les conditions physiques et mentales favorables à une utilisation constructive de l’instrument ». Mais l’étape suivante – accorder les instruments – touche au mystique : elle « représente le symbole le plus évocateur des valeurs humaines et sociales contenues en germe dans la pratique musicale d’ensemble » puisque « l’ajustement des différentes fréquences instrumentales ne saurait être dissocié d’une mise en résonance des corps et des cœurs, qui composent dans toute sa vitalité l’accord orchestral, miroir d’une concorde sociale ainsi établie ».
À force d’insister sur les prolégomènes (dont la sempiternelle « motivation » de l’apprenant) et d’enfoncer des portes ouvertes (favoriser une approche sensible de la musique, stimuler l’intuition, développer le sens du rythme : comment n’y a-t-on pas pensé plus tôt ?), la pédagogie finit par en oublier l’enseignement proprement dit. L’injonction de privilégier « l’oralité » justifie-t-elle l’élimination de tout élément de théorie et le report de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de la musique à l’âge de onze ans, sous couvert de ne pas « étouffer l’intuition » ? La créativité bien comprise, fruit de l’acquisition patiente d’un patrimoine technique et culturel tiré des meilleurs exemples du passé, cède alors sa place à deux dérives symétriques : le spontanéisme simpliste et ravi et le technicisme qui empile des procédés dépourvus de finalité. L’obsession du « ludique », le zapping de la « sensibilisation » permanente, la démesure de la « perspective synesthésique » (!) et l’expérimentation comme fin en soi – tout innovants qu’ils sont, les « ateliers dédiés à la construction d’instruments originaux, à partir d’objets industriels ou recyclés » fleurent bon leur nostalgie (serait-elle suspecte ?) des seventies – font perdre un temps précieux, favorisent l’éclatement des apprentissages et expliquent en grande partie l’incapacité récurrente des élèves à se concentrer, que ces mêmes « pédagogues » prétendent combattre avec la caution de la Science.
Mais ces directives se distinguent surtout par un relativisme outrancier. « Il ne peut être de véritable démocratisation de l’éducation musicale sans une ouverture à l’ensemble des esthétiques, alliée à une déconstruction des représentations qui leur sont associées dans l’imaginaire collectif, afin d’abolir les clivages symboliques susceptibles d’opposer les différentes formes d’expression musicale et leurs publics ». On en déduira que ceux qui préfèrent Mozart au rock, mais aussi ceux qui aiment Mozart et le rock, mais différemment, sont définitivement « fermés » et « anti-démocrates » : le pédagogue se fait militant et son ressentiment néo-bourdieusien envers la « culture bourgeoise » l’incite à assimiler toute tentative d’établir des priorités dans les programmes scolaires à une forme de discrimination, dans la plus pure tradition du gauchisme culturel.
Les dames patronnesses sont de retour
Cette doxa sociologiste vire à la dictature du présent lorsqu’elle invite chacun à être « en adéquation avec les conditions socioculturelles de notre temps ». Elle trouve néanmoins ses limites dès lors que l’injonction de la rétro-chronologie9 (le fait d’« amener progressivement les élèves vers de nouveaux horizons musicaux à partir de leurs goûts musicaux ») vient contredire l’égalité absolue des esthétiques martelée supra. « La considération accordée par d’éminents pédagogues et musiciens à ces enfants » (merci pour eux !) atteste la volonté de « faire évoluer leur perception, mais également celle de leurs familles, à l’égard de la sphère musicale “classique” » : le relativisme culturel n’est donc que la façade bienpensante du mépris de classe. Le but de la « pédagogie » n’est alors plus de porter chaque élève au plus haut de ses capacités mais, « indépendamment du niveau musical acquis par les élèves concernés » (!), de « réunir les enfants autour de l’expérience commune de la pratique musicale […] et des valeurs relatives au vivre-ensemble qu’elle véhicule » et, surtout, « d’offrir à la jeunesse une alternative aux diverses manifestations de la violence qu’engendrerait un éventuel sentiment d’exclusion sociale ». Derrière le vivre-ensemble10, le « plaisir de se retrouver », la « solidarité intergénérationnelle », le « regard réflexif sur l’identité [de l’élève] et sa pratique de musicien » (sic !), le développement des « qualités sensibles sublimant les facultés rationnelles » et les « nouveaux horizons propices à la construction d’une politique de la paix » (liste non exhaustive) pointent la psychologisation comportementaliste et des valeurs autrement plus prosaïques, celles d’un cynisme où la compassion victimaire tient lieu de politique sociale. Quand le prêche moralisant se substitue à l’instruction, la responsabilité individuelle est plus étouffée que stimulée et l’intuition n’est plus fécondée par l’exercice de la raison ; loin d’éveiller la sensibilité, les bons sentiments en deviennent aussitôt le tombeau.
Devenu collectiviste et « socio-culturel » (et non plus populaire puisque son nouveau profil correspond davantage aux fantasmes d’une élite branchée), le conservatoire cesse dès lors d’être une école d’art pour se transformer pas à pas, à l’image de l’école investie par ces mêmes « pédagogues », en un outil de traitement social au rabais des maux de la société. Cependant, le renoncement à l’élévation de l’individu et le repli sur une illusoire « pacification des rapports sociaux » (sic !) par une pratique orchestrale assimilée à un camp de boy-scouts n’illustre-t-il pas l’impuissance des politiques à contenir le désengagement financier de l’État, le creusement des inégalités ou la ghettoïsation rampante du territoire ?
Le management au service de l’utilitarisme
Dans un contexte budgétaire contraint, il n’échappera à personne que la promotion des pédagogies collectives s’apparente à un plan social déguisé, et il est bien précisé que le coût de cette « appropriation vivante et accessible à chacun de l’outil musical » « doit demeurer abordable pour les collectivités territoriales » qui (jusqu’à la prochaine crise ?) détiennent les cordons de la bourse. Le rapporteur précise du reste que le choix des instruments à vent plutôt que des cordes pour former les effectifs instrumentaux relève de cette même volonté de maîtriser les coûts. Mais dans la plus pure tradition du développement culturel, il s’agit aussi de créer de la valeur ajoutée et « d’établir des passerelles entre les mondes de l’école, des arts [et] de l’entreprise, car dans une optique d’insertion professionnelle, l’épanouissement spirituel est favorable à la productivité ». On rappelle donc à propos que les « activités de l’association “Orchestre à l’école” furent originellement impulsées par la Chambre syndicale de la facture instrumentale (CSFI) » et l’on prône l’association du secteur du numérique à des marchés publics… qui n’ont jamais aussi bien porté leur nom.
Il n’est donc plus question que l’État fasse autre chose qu’accompagner les « forces vives » locales (et donc le creusement des inégalités) puisque selon Emmanuel Ethis, sociologue, recteur d’Académie et vice-président du Haut Conseil à l’Éducation artistique et culturelle, cette dernière doit et devra « se développer toujours davantage, sans jamais méconnaître la diversité des acteurs, des pratiques et des territoires, mais en faisant un atout, et non plus un obstacle »11. Dans le même temps, les missions des professeurs sont appelées à se multiplier (pardon, à évoluer) entre l’enseignement, les concerts, mais aussi l’animation socioculturelle et les tâches bureaucratiques ; mais plutôt que « d’imposer des directives pédagogiques en rupture avec l’existant » (ce qui s’avère parfois risqué), les managers ont tout intérêt à les faire admettre comme inéluctables et, mieux, à y faire adhérer leur ressource humaine dans une démarche dite participative. Le Rapport Lockwood appelle ainsi à revoir le contenu des examens proposés pour les DE (Diplôme d’État) et les CA (Certificat d’Aptitude) afin de baser le profil des futurs intervenants sur la personnalité de l’intervenant et ses aptitudes communicationnelles : le formatage ne commence jamais assez tôt et l’enthousiasme vaut bien les connaissances musicales – dont certaines, nous dit-on, pourront être « rudimentaires ».
La pédagogie se réduit alors à un simple prétexte. Pour mieux répandre les « bonnes pratiques », rien ne vaut la « formation de formateurs » (sic) les « modules de formation continue »12, les « synergies » et autres « partenariats », sans oublier l’incontournable « travail en équipe », le tout évidemment « en concordance avec les actuels enjeux socioculturels et les attentes des publics », secundum Scripturas. Des « modules en sociologie des arts, de la culture et de l’éducation » permettront également aux intervenants de travailler leur réflexivité et, toujours, de « déconstruire leurs propres représentations pour composer avec celles de leurs élèves »13. La rédaction d’une « charte pédagogique ouverte, dans le but de définir les socles de compétences » sera éminemment précieuse à cet effet.
Un fonctionnement clanique
Le décalage de ces « humbles propositions » (sic !) avec la pratique de la musique et son enseignement, sans parler des préoccupations quotidiennes des musiciens, semble complet et irrémédiable. Reste à expliquer la permanence de cette logorrhée depuis plus de trente ans, l’obsession maladive de la socialisation, la mode des démarches de type universitaire trop précoces ou, a contrario, le report récurrent des apprentissages élémentaires. La réponse se trouve dans la liste des personnes consultées, qui recoupe étrangement celle des rédacteurs des annexes14. Comme à la rue de Grenelle, les politiques viennent chercher l’inspiration auprès d’une même minorité agissante d’experts à la botte : les Cefedem (Centres de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique) et les CFMI (Centres de Formation des Musiciens Intervenants en milieu scolaire), équivalents des tristement célèbres ESPE (ex-IUFM), y occupent une place de choix, sans oublier l’association de directeurs Conservatoires de France que le rédacteur du rapport transforme subtilement en une « Association des conservatoires de France ». Au lieu de consulter des professionnels relégués au rang d’exécutants, les décideurs s’adressent à des « comités de pédagogues »15 dont le centralisme démocratique à toute épreuve permet en retour de solliciter le « soutien des services du ministère » afin de « cadrer » toute réflexion « à l’aune des textes en vigueur », et ainsi de suite. Tant qu’on ne rompra pas avec cet entre-soi clientéliste (« de droite » comme « de gauche »), la crise de l’enseignement musical16 français perdurera et les élèves, amateurs et futurs professionnels confondus, continueront d’en être les principales victimes.
Notes
1 – Texte en ligne : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/7423/master/index.htm
2 – Voir http://www.education.gouv.fr/cid104769/presentation-de-la-charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html. Créature bureaucratique des années 2000 affublée d’un comité Théodule ad hoc, le concept d’Éducation artistique et culturelle pourrait sembler quelque peu obscur au profane et même au musicien confirmé. En effet, n’enseigne-t-on pas déjà les disciplines artistiques sur tout le territoire, était-il nécessaire de créer un nouveau dispositif alors que l’enseignement général (avec les « dumistes » pour les écoles et les certifiés et agrégés pour le secondaire) et spécialisé (avec les professeurs des conservatoires) disposaient déjà de professionnels qualifiés et (en principe) titulaires d’un concours national ? Tout d’abord, le temps politique et les nécessités de la communication font qu’il est plus profitable à court terme de créer de nouvelles structures plutôt que d’entretenir convenablement l’existant : on le constate notamment tous les jours dans un domaine tel que les transports en commun ferroviaires. Ensuite, si une école, un collège ou un conservatoire disposent d’un budget pérenne et d’un personnel permanent, ce n’est pas le cas de l’Éducation artistique et culturelle qui fonctionne à l’échelon des territoires, en partenariat et sur projet ; au lieu de dispenser un financement annuel aux diverses institutions, l’État gestionnaire est désormais libre de réserver sa manne aux projets les plus innovants, c’est-à-dire conformes à l’idéologie du moment (on observera au passage que cette même gouvernance opaque et d’inspiration néo-libérale a largement investi le monde de la recherche). Enfin, l’assèchement financier et la soumission au politique se soutiennent mutuellement : le développement de la transversalité (la dilution progressive des spécificités de chaque corps dans un collectif aliénant à souhait) permet à terme la mutualisation, l’indifférenciation des missions (puis des statuts) et le nivellement, si possible par le bas, de l’enseignement dispensé – qui n’en est d’ailleurs plus un à partir du moment où on le remplace par une vague éducation, comme le précise sans détour l’intitulé du dispositif. À cette fin, on ne manquera pas de recourir au leurre idéologique de la démocratisation de façon à délégitimer les enseignements spécialisés qui, au moins pour les niveaux les plus élevés, s’adressent nécessairement à une minorité – de là à les accuser d’élitisme, le pas est vite franchi…
3 – Le texte de cette première version est accessible en ligne : http://www.fuse.asso.fr/docsfuse/Rapport-Lockwood_658684939.pdf . J’en avais alors publié une critique sur le blog Je suis en retard : http://celeblog.over-blog.com/article-le-rapport-lockwood-bas-les-masques-101377295.html
4 – Voir http://lelab.europe1.fr/quand-linspection-generale-de-la-ville-de-paris-voulait-supprimer-les-cours-individuels-dans-les-conservatoires-a-cause-des-risques-dinfraction-sexuelle-2748710
5 – Voir l’article de Vincent Agrech dans Diapason : http://www.diapasonmag.fr/actualites/a-la-une/el-sistema-voyage-en-utopie
6 – La charte de l’Éducation artistique et culturelle susmentionnée proclame que le financement de ce dispositif a été augmenté de 80% entre 2012 et 2016, passant à plus de deux milliards d’euros. Curieusement, ce document ne précise pas que dans le même temps les crédits d’État accordés aux conservatoires ont été purement et simplement supprimés. Chacun sait cependant que, comme leur nom l’indique, les conservatoires sont conservateurs ; cet arbitrage budgétaire est aussi un choix idéologique en même temps qu’un message clair envoyé à la profession.
7 – Les derniers concours de la fonction publique territoriale (FPT) ont eu lieu en 2011 pour les assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA) et en 2013 pour les professeurs d’enseignement artistique (PEA). Il ne faudrait tout de même pas que les collectivités territoriales (qui, depuis quelques années, ont toujours le dernier mot s’agissant des décisions gouvernementales, à la Culture comme ailleurs) fussent contraintes de recruter leur personnel dans le cadre des statuts en vigueur ! Mais l’espoir reste permis puisqu’on envisage une nouvelle session pour, respectivement, 2018 et 2019, c’est-à-dire après les présidentielles – si le statut n’est pas purement et simplement supprimé d’ici-là, comme nous le promettent déjà certains candidats dits républicains à la magistrature suprême. Inutile de préciser qu’une telle suppression de fait des concours aurait été impensable côté Éducation nationale, qui plus est à l’heure des introuvables « 60 000 postes »…
8 – Lire l’article de Jean-Pierre Le Goff publié dans Marianne http://www.marianne.net/jean-pierre-goff-cette-reforme-du-college-signe-mise-mort-ecole-republicaine-100233254.html
9 – Déjà omniprésent dans la première version du Rapport, le gadget innovant de la rétro-chronologie est pourtant loin d’avoir été inventé par Didier Lockwood puisqu’il ne fait que ressasser les habituels poncifs de pédagogies qui, depuis les événements de 68 et leurs suites, n’en finissent plus d’être « nouvelles ». Il relève notamment de l’injonction de partir du vécu de l’élève : voilà assurément le meilleur moyen de maintenir celui-ci dans son ignorance originelle (pardon, dans son handicap socio-culturel). Voir J.-P. Despin et M.-C. Bartholy, Le Poisson rouge dans le Perrier, Limoges, Critérion, 1983 (p. 73 et suivantes).
10 – Si l’expression vivre-ensemble s’est récemment banalisée à la suite des attentats et d’un matraquage ad nauseam de la part des médias et des politiques réunis, son arrière-plan idéologique n’en devient que plus opérant à mesure qu’elle accède au rang de truisme. Habilement dissimulé sous le moralisme et l’effusion sentimentale, ce qui a pour effet de désarmer la critique, le travail de sape mené au nom des bonnes intentions constitue une menace sérieuse pour la vitalité de la démocratie républicaine. Ainsi, pour le philosophe Robert Redeker (L’École fantôme, Paris, Desclée de Brouwer, 2016), la transformation en cours des objectifs de l’école véhicule un projet politique et anthropologique visant à « substituer la société à la nation et au peuple » et à créer une humanité nouvelle composée de consommateurs ignares, dociles et indifférenciés. On ne sous-estimera jamais assez la férocité et la nature foncièrement anti-républicaine de cette doxa, véritable « machine de guerre contre la fraternité » dont les progrès favorisent une balkanisation larvée du corps social. Autre variante : la bienveillance. Voir le livre d’Yves Michaud, Contre la bienveillance, Paris, Stock, 2016, et l’article de Richard Michel « Raison ou bienveillance ? » sur le site du Comité Laïcité République http://www.laicite-republique.org/raison-ou-bienveillance-r-michel.html.
11 – E. Ethis, Charte de l’Éducation artistique et culturelle, éditorial de présentation, Avignon, juillet 2016, http://www.education.gouv.fr/cid104769/presentation-de-la-charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html.
12 – Voir mon article « Enseigner c’est manager » sur ce site : http://www.mezetulle.fr/enseigner-cest-manager/
13 – Cette dernière affirmation comporte une contradiction dans les termes : pour être « dans les clous » des préconisations du ministère, faut-il qu’un professeur renonce à enseigner ?
14 – À cet égard, la liste des membres du Haut Conseil de l’Éducation artistique et culturelle n’est pas moins éloquente puisqu’on n’y dénombre qu’un seul musicien en exercice : M. Lockwood himself !
15– Voir mon article « Quand les conservatoires se bougent le bacon » http://www.mezetulle.fr/quand-les-conservatoires-se-bougent-le-bacon/
16– Voir mon article « Conservatoires: les raisons d’une crise » http://www.mezetulle.fr/conservatoires-les-raisons-dune-crise/
© Dania Tchalik et Mezetulle, 2016.