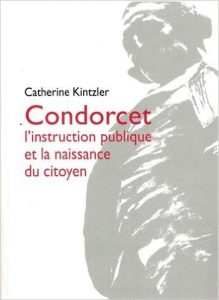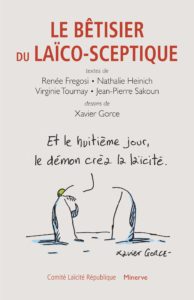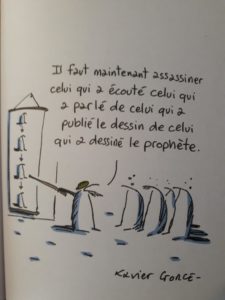Placé ironiquement du point de vue des « assiégés » par les « extrêmes », le texte de Samuël Tomei analyse impitoyablement l’état d’esprit de bien des militants, et surtout des responsables, prétendument républicains. En se faisant pendant des décennies les complices des pires ennemis de la République, après avoir laissé détruire – entre autres – le patriotisme universaliste, la laïcité, l’école républicaine, l’ordre public, l’intégration, les services publics, « nous » voilà, chevaliers du camp du bien, réduits à brandir une tenaille identitaire faussement équilibrée et, à coups d’idées floues et de dénis, à peindre l’ennemi sous les traits que nous voulons qu’il ait.
Le réflexe obsidional s’impose : la République est en danger, défendons-la. Nous sommes tous (toutes et tous, puisque progressistes), bien sûr, contre l’extrémisme (surtout celui de droite), contre le populisme, contre les identitaires de toute sorte, et nous sommes toutes et tous les chevalières et les chevaliers d’une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ! Mais il nous faut remplir trois conditions : ne jamais définir les termes, combattre la « tenaille identitaire » et avancer que l’ennemi, qui doit ressembler à son portrait-robot, pratique la taqiya.
Ne jamais définir les termes
L’extrémisme, si l’on en croit Pierre-André Taguieff, cumule trois éléments : la légitimation de la violence comme méthode de résolution des problèmes politiques ; l’intolérance et le sectarisme ; le fanatisme impliquant l’intransigeantisme, le manichéisme et le jusqu’au-boutisme, qui supposent qu’on place la défense de la Cause au-dessus de tout1. Christophe Bourseiller considère que « l’extrémiste se veut au-dessus des lois. Il rejette la société présente et ne reconnaît aucune des institutions. Il dénonce en vrac la police, l’armée, la justice, le système fiscal2… ». Examiner quel parti ou quel groupe à l’Assemblée cumule le plus, aujourd’hui, ces critères conduirait-il à faire pencher la balance d’un côté plus que de l’autre, à détourner notre regard de celui qu’on a désigné comme l’ennemi principal ? On verra plus loin qu’il existe une parade. Pour l’heure, « pas une voix » pour telle extrême !
De même, prenons garde de définir le populisme. Entrer dans les détails conduirait à se demander si le phénomène de 2017, qui a conduit à l’Élysée le plus jeune des présidents de la République, ne relèverait pas d’une sorte de populisme : rejet des élites en place (dont pourtant on provient…), appel direct au peuple, promesse d’un peu tout révolutionner, dépassement du clivage droite-gauche, homme providentiel, etc. De plus, à lire les spécialistes de la question, on pense à Alexandre Dorna3, on verrait qu’il existe un populisme républicain dont l’archétype est Gambetta… On dénoncera donc sans précision la montée des populismes, surtout celui de droite, le national-populisme (pour évoquer dans l’inconscient de ses interlocuteurs le national-socialisme).
Commencer de donner un tant soit peu de contenu aux termes positifs est tout aussi périlleux. Prenons chacun des quatre principes qui définissent – constitutionnellement – la République : à les articuler, on se rend compte à quel point, depuis une soixantaine d’années, nous, républicains, nous qui votons pour la gauche ou la droite de gouvernement, les avons, avec ces dernières, trahis, et à quel point nous persistons. Nous avons laissé, au nom du « droit à la différence », le virus du différentialisme miner l’indivisibilité, l’hystérie identitaire et l’hétéronomie affouiller la laïcité – qui est conjugaison, on ne le rappellera jamais assez, de la souveraineté de l’individu et de la souveraineté nationale –, la technocratie dégrader la démocratie, et la logique néo-libérale dévorer la politique sociale (variante : nous avons troqué le social pour le sociétal)4. Nous avons par ailleurs laissé pulvériser le cœur battant de la République : un système d’enseignement censé former non des agents économiques employables mais des citoyens critiques d’une République indéfiniment perfectible5. Bref, nous devons nous aveugler et aveugler les autres sur le fait que nous fûmes, bon gré mal gré, pendant ces soixante dernières années, complices des pires ennemis de la République indivisible, laïque, démocratique et sociale – qui doit toutefois demeurer notre mantra puisque c’est sur elle que nous avons fondé notre légitimité. Il n’est pas jusqu’à l’universalisme que nous devons prôner avec autant de force que de flou.
Rester vague, donc, tout en donnant l’impression qu’on a théorisé le danger.
Combattre la « tenaille identitaire »
Belle trouvaille à cet égard que la « tenaille identitaire » ! Car même si, historiquement (« Bloc des gauches », « Union de la gauche », « gauche plurielle », « Nouveau Front populaire » – on notera au passage la dégradation), c’est l’extrême droite qui nous effraie le plus, la théorie de la tenaille permet de répondre à ceux qui voudraient nous montrer que le danger est aujourd’hui du côté gauche, de renvoyer dos à dos les « extrêmes », de trancher du sage et de prendre la posture du résistant, cela sans le moindre effort – et tant pis si c’est tacher la mémoire des vrais Résistants, ceux qui ont risqué leur vie, car on ne risque pas la sienne à transpercer des ennemis fantomatiques. Cette théorie fut conçue et le plus ardemment défendue par le Printemps républicain, moins pour donner sens à la réalité que pour s’insérer dans le jeu macronien : je lutte en même temps contre les identitaires de gauche et contre les identitaires de droite, au nom de l’universalisme républicain. Les élections législatives de 2022 ont sanctionné l’échec de la stratégie partisane du Printemps républicain, resté hors-jeu par décision olympienne, malgré le silence de ce mouvement sur deux points essentiels pour tout républicain, mais ici susceptibles de faire obstacle au grand mouvement devant nous mener à la fusion euro-atlantiste néo-libérale promise : la souveraineté nationale et l’école républicaine.
Reste que cette idée de tenaille a survécu et il convient aux chevaliers et aux chevalières du Bien de s’y tenir – encore une fois, pour échapper à l’accusation de déni du danger provenant de la gauche de la gauche. Le secret de son efficacité est de faire croire que les deux mâchoires sont sinon symétriques, du moins d’égale intensité – sinon ce n’est plus une tenaille – et donc que, non en soi (ce que nous admettrons tous) mais dans les faits, l’identitarisme de gauche se montre aussi dangereux pour les Lumières que l’identitarisme de droite. Pour l’identitarisme côté gauche on dénoncera l’islamismo-gauchisme et, pour ne pas être soupçonné de complaisance avec la droite de la droite, on ajoutera systématiquement qu’on la combat avec la même force ; cela, même si c’est l’islamisme qui, par les attentats terroristes qu’il a perpétrés, a causé la mort de centaines de personnes en France ; même si c’est lui qui est la source de l’antisémitisme à cause duquel les Français juifs et plus généralement les juifs vivant en France ne se sentent plus en sécurité.
Le fantasme est la réalité et donc l’ennemi pratique la taqiya
Quand on objectera que, selon d’avisés politologues6, l’extrême droite, celle, par exemple, définie dans le décret de dissolution de l’association Civitas7, ne représente en France que quelques milliers de personnes, lesquelles ne se reconnaissent en rien dans un leader qui a poussé la provocation jusqu’à dîner avec des francs-maçons8, quand on aura voulu nous démontrer par A plus B que tous les partis évoluent, que ceux contre lesquels on nous enjoint de « faire digue », la gauche castor ne devant pas mourir, n’ont plus grand-chose à voir avec ce qu’ils étaient au moment de leur fondation, reste l’argument ultime. Ce parti dont certains croient qu’il a changé, qu’il a rompu avec les anciens dignitaires antisémites, identitaires, cathos-tradis, nostalgiques des régimes autoritaires du XXe siècle, avec les pourfendeurs de la Révolution française et de ses principes, avec son antigaullisme viscéral, parti qui aurait rompu, malgré quelques scories amenées à disparaître, avec son passé, nous ment : il pratique la taqiya – il simule et dissimule, il a un agenda secret. Il faut donc, quitte à transgresser nos principes, passer de la police de la pensée à la police des intentions cachées. Nous répondrons en effet d’un air pénétré : « Oui, certes, mais chassez le naturel… ».
Si votre interlocuteur insiste sur son combat contre l’antisémitisme, vous pourriez certes toujours avancer que l’extrême droite a remplacé les juifs par les musulmans, mais cet artifice est celui de l’extrême gauche contre laquelle vous êtes aussi censé lutter (vous êtes en effet coincés par la tenaille identitaire)… Pour en revenir à nos bruns moutons, vous soutiendrez qu’une « armée de réserve » (elle compterait « plusieurs milliers de militants néo-fascistes » en Europe) « attend l’accession au pouvoir du Rassemblement national pour passer à l’action9 ». Mais les mauvais esprits sont tenaces qui chercheront à vous pousser dans vos retranchements : avant l’accession au pouvoir à Rome de la (forcément) « néo-fasciste » Giorgia Meloni, ne promettiez-vous pas huile de ricin à profusion, retour du manganello10, raids sanglants perpétrés par l’armée de réserve de milices néo-fascistes et répression de la franc-maçonnerie11 ? Sans oublier le torpillage de l’Union européenne. Or la dictatrice, in fine, se distingue-t-elle vraiment, dans sa pratique du pouvoir, d’un dirigeant démocrate-chrétien des années 1980 ? Elle a certes pratiqué la simulation et la dissimulation avant d’exercer le pouvoir mais c’était pour devenir désespérément légaliste, atlantiste et européiste… Ses alliances européennes, précisément ? On pourra toujours essayer d’inquiéter avec l’internationale noire (en passant donc sous silence le fait que les extrêmes droites ne sont finalement pas en position de force au sein du Parlement européen).
Il faut à tout prix que l’ennemi ait les traits que nous voulons qu’il ait car, nous étant dépouillés de tout ce qui faisait notre force – les principes républicains – nous nous retrouverions bien nus en face d’un mouvement qui ne serait plus anti-républicain et qui serait même devenu pas moins républicain que nous… Mais espérons : viendra bien enfin le jour où il enfilera sa chemise noire !
Conclusion : l’impossibilité de faire autrement
L’avenir est ouvert et rien ne dit que la tenaille identitaire ne sera pas un jour réalité : peut-être les identitaires de droite deviendront-ils aussi puissants que ceux de gauche – mais il y a de la marge pour que le cauchemar devienne réalité tant l’idéologie wokiste – diversitaire, anti-humaniste et anti-universaliste –, s’est répandue, vite et fort, dans les milieux culturels et intellectuels (l’enseignement supérieur en est désormais le foyer12). On peut interpréter de plusieurs manières l’obsession d’une extrême droite fossilisée, ce refus de voir que le danger pour les principes républicains vient d’ailleurs, cette pathétique manie de rejouer les années 1930 – comme si la bête immonde reproduisait des monstres identiques à eux-mêmes ! Il y a d’abord la paresse : trouver de nouveaux outils d’analyse pour appréhender des phénomènes nouveaux coûte. Il y a ensuite cette terrible hypothèse : que le parti ennemi passe d’un républicanisme de pure opportunité, il occupe le créneau que nous avons abandonné, à un républicanisme de conviction…, qu’il finisse par admettre que le pays a vraiment besoin d’une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, d’un patriotisme universaliste, d’un système d’enseignement fondé sur l’excellence, le mérite, besoin qu’on redonne sens aux mots peuple, nation, souveraineté nationale, intégration, assimilation, service public, ordre public… Qui dit en effet qu’un jour, pour l’ennemi, la reconnaissance de ce besoin ne se réduira plus, comme pour nous désormais, à un plan com’ ? Rien du tout ici d’un appel au vote mais tout d’un appel pressant à l’esprit (auto)critique, à la nécessité péguyste de « voir ce qu’on voit » et d’en tirer les conséquences.
Notes
1 – Pierre-André Taguieff, Qui est l’extrémiste ?, Intervalles, Paris, 2022, p. 160.
2 – Christophe Bourseiller, La France en colères, Paris, Cerf, 2024, p. 14.
3 – Alexandre Dorna, Le leader charismatique, Desclée de Brower, Paris, 1998 ; Le populisme, Paris, PUF (QSJ ?), 1999 ; Faut-il avoir peur de l’homme providentiel ?, Paris, Bréal, 2012.
4 – Walter Benn Michaels, La diversité contre l’égalité, Paris, Raisons d’agir, 2009.
5 – Jean-Claude Milner, De l’école, Paris, Verdier, 2009 (1984).
6 – « Ceci étant, la mouvance d’ultra-droite reste réduite à 3 000 individus environ, elle progresse très peu sur la longue durée. Et ni le RN ni Reconquête ! n’ont intérêt à se diaboliser en accueillant en leur sein des radicaux qui, d’ailleurs, les trouvent trop prudents. » Jean-Yves Camus, Le Figaro Vox, 28 novembre 2023 ; « Ainsi, la France insoumise n’est pas à proprement parler un mouvement d’extrême gauche, puisqu’elle agit dans un cadre légal et souhaite parvenir à la magistrature suprême par la voie électorale », note Christophe Bourseiller (op. cit., p. 81-82) qui établit le même constat pour le RN puisque postulant que « l’extrémiste lutte pour un changement radical de société et veut y parvenir par la violence » (p. 161.)
8 – « Bardella chez les francs-maçons ! La Grande Loge nationale de France [sic] a reçu le patron du RN pour un déjeuner très select. Au menu : immigration, insécurité… mais pas un mot sur Le Pen père et sur le FN qui voulaient la disparition des francs-macs… » (Tweet du Canard enchaîné du 21 février 2024)
9 – Renaud Dély, L’assiégé – Dans la tête de Dominique Venner, le gourou caché de l’extrême droite, JC Lattès, 2024, p. 236. Cette excellente biographie romancée (« Dans la tête de… »), instructive et bien menée, de cette figure archétypale de l’extrême droite, montre de fait à quel point le RN de 2024 n’est pas, idéologiquement, d’extrême droite…
10 – Matraque, bâton.
11 – Samuël Tomei, « L’extrême droite en Italie, quelles conséquences pour les francs-maçons », entretien paru sur le site Hiram.be, 28 septembre 2022 (https://www.hiram.be/lextreme-droite-en-italie-quelle-consequence-pour-les-francs-macons/).
12 – Voir « L’université à la renverse », dossier, Humanisme, n° 329, Décembre 2020.