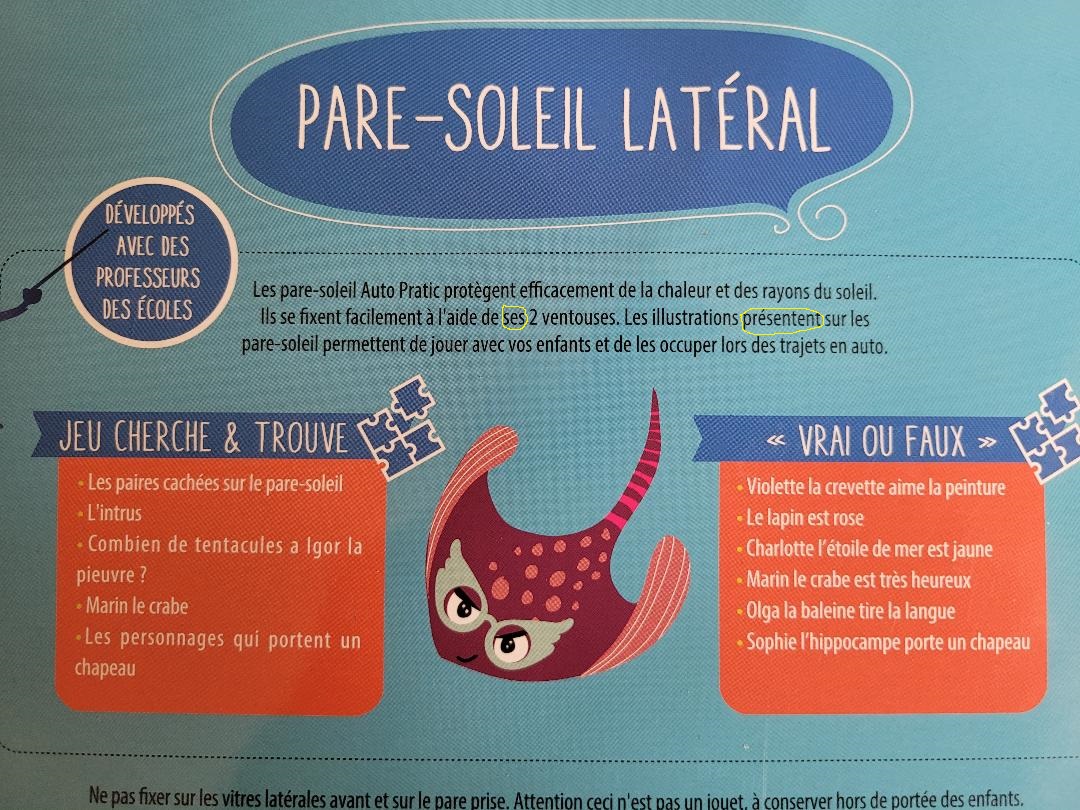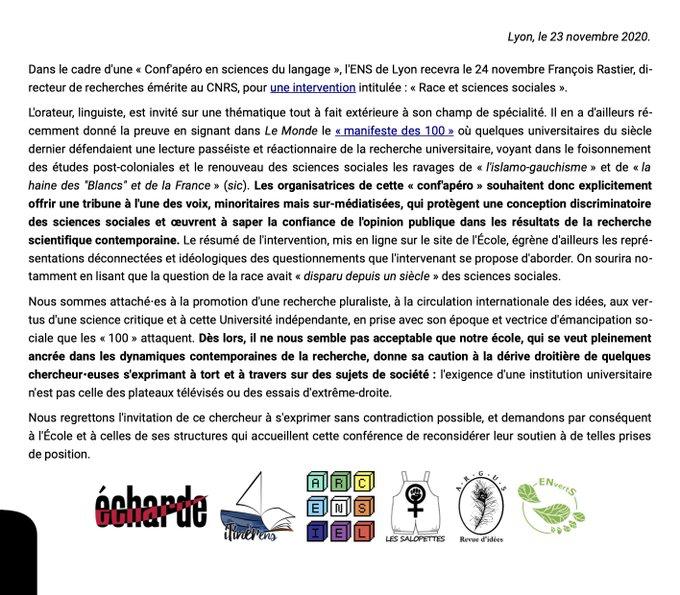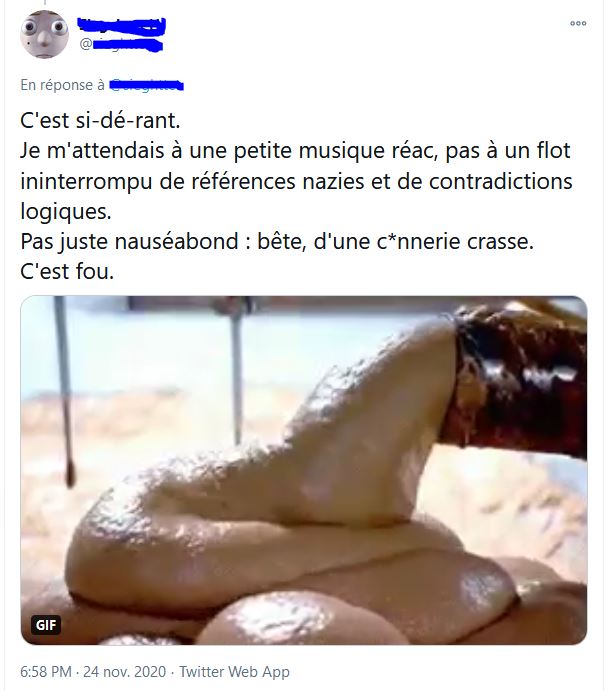François Rastier examine les postulats, les incohérences, les contradictions et les difficultés de l’écriture dite « inclusive ». Il montre comment ce nouveau conformisme édifie un monde de substitution en recourant à la magie incantatoire et à son corollaire moralisateur, le tabou linguistique. Ainsi, un séparatisme militant et rudement injonctif s’affirme et entend disposer exclusivement, en la pliant à ses objectifs particuliers, d’une langue qui appartient pourtant à tous ceux qui en usent.
De longue date, des mouvements politiques ou religieux veulent modifier la langue pour affirmer leurs objectifs et imposer leur influence, aussi bien par des interdits que par des prescriptions. Ce fut le cas en Allemagne du mouvement nationaliste de la Sprachreinigung (littéralement nettoyage de la langue), qui voulut éradiquer de la langue allemande les mots d’origine étrangère. Opposant en règle générale une langue militante à la langue commune, ces mouvements ne sont pas démocratiques, car la langue commune est indéniablement un bien commun qu’aucun groupe ne peut s’approprier. Le plus souvent, ils se limitent à des jargons de cercle qui multiplient les signes de reconnaissance, et même dans des régimes tyranniques, les efforts pour officialiser une langue de bois ne survivent pas aux forces politiques qui l’imposent.
À présent, des mouvements identitaires, raciaux, sexuels ou religieux ont repris le combat linguistique pour bannir des mots, en imposer d’autres (souvent euphémiques), et vont même jusqu’à vouloir modifier la syntaxe et les graphies.
Quelques normes inclusives
La municipalité de Lyon et d’autres administrations, divers départements universitaires, des grandes écoles, sans parler de partis et d’associations, utilisent et recommandent l’écriture dite inclusive.
Le Livre blanc égalité femmes-hommes : de la déclaration d’intention à l’expérimentation (3 juin 2020) se fonde sur la charte signée par la Conférence des grandes écoles et la Conférence des présidents d’université à l’initiative des ministres Geneviève Fioraso et Najat Vallaud-Belkacem le 28 janvier 2013. Rédigée en écriture inclusive, cette charte, toujours en vigueur, la légitime.
Le Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, (HCE), instance consultative auprès du Premier ministre, a publié en 2015 un guide pratique toujours proposé en page d’accueil et qui promeut, plus explicitement encore, sous forme de recommandations numérotées, l’écriture inclusive.
Cette forme d’écriture s’appuie sur trois postulats qui dépassent la question de l’orthographe : la langue détermine la pensée ; la langue française est machiste1 ; il faut donc modifier la langue française pour qu’elle devienne féministe.
La référence théorique, rappelée en première phrase du Manuel d’écriture inclusive édité par « l’Agence de communication d’influence » Mots-clés, est notamment la conception du « discours » formulée par Michel Foucault : « Le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer » (p. 4, citation tirée de L’ordre du discours, 1971, p. 12). Cette conception purement sophistique du discours ne peut cependant prétendre modeler la langue. Faire du discours, quel qu’il soit, le lieu d’une lutte politique pour la prise du pouvoir fait de son usage une éristique constante — et suppose en outre une conception totalitaire du pouvoir, qui s’exercerait sans la médiation d’institutions et indistinctement sur tous.
Aussi ces postulats sont-ils erronés, car toute langue peut exprimer toutes les pensées les plus contradictoires ; il en découle qu’aucune langue n’est par elle-même machiste ou féministe, socialiste ou totalitaire ; en outre, la catégorie grammaticale du genre n’a rien de commun avec la sexualité, et les sociétés qui parlent des langues sans genre, comme le persan ou le japonais, ne souffrent pas moins de discriminations que d’autres ; enfin, l’évolution d’une langue n’obéit pas aux décisions réglementaires ni aux pressions de groupes militants.
1. Les premières modifications exigées portent sur le lexique, notamment pour la féminisation des noms de métier. Le lexique de toute langue est ouvert et évolue avec les usages : les archères et les grutières en témoignent. Au demeurant, chaque femme reste libre de se faire désigner par la forme de son choix : préfet ou préfète, chef ou cheffe, auteur, auteure ou autrice, etc.
2. En deuxième lieu, on exige l’abolition de la règle d’accord qui voudrait que dans les énumérations, le genre grammatical masculin l’emporte sur le genre grammatical féminin : Les paquets et les lettres sont arrivés (et non arrivées).
Cette règle se justifie car le genre masculin en français est non-marqué et se prête donc à des emplois neutres ou impersonnels : ex. il pleut ; il a été trouvé un porte-monnaie ; c’est vrai ; je le pense2. À cela le Guide pratique du Haut Conseil oppose : « En français, le neutre n’existe pas : un mot est soit masculin, soit féminin » (p. 8). Cependant beaucoup de mots français, comme les adverbes, n’ont pas la catégorie du genre. D’autre part le neutre reste bien attesté : par exemple, des pronoms comme ça ou on sont neutres. Le rapport conclut cependant par une affirmation, « Le masculin n’est pas plus neutre que le suffrage n’a été universel jusqu’en 1944 » (ibid.), qui assimile bizarrement l’usage grammatical et la loi électorale.
La règle s’appuie sur des précédents qui auraient été obscurcis par les grammairiens masculinistes, notamment deux vers de Racine : « Mais le fer, le bandeau, la flamme est toute prête » et « Ce peuple a le cœur et la bouche ouverte à vos louanges », qui évoquent plutôt la licence poétique où l’euphonie a sa part ; et cette plaisanterie de la Sévigné, à l’intention d’un ami grammairien enrhumé : « Je la suis aussi […] je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement »3. Ces maigres exemples ne suffisent pas à réviser l’histoire de la langue ni à imposer à présent une règle de proximité.
Rappelons que l’on ne peut conclure du genre grammatical au sexe biologique, ni a fortiori au gender imaginaire, inférences sans fondement linguistique mais non sans enjeux fantasmatiques. La professeure Éliane Viennot stigmatise cette « règle scélérate » (sic) et a mis en ligne pour l’abolir une pétition qui fait appel à l’émotion sans trop s’embarrasser des faits linguistiques4.
Par exemple, au lieu de Les relevés et les feuilles d’impôts sont arrivés, il faudrait écrire sont arrivées, par égard pour la féminité des feuilles d’impôts et pour mettre fin à l’oppression masculiniste des relevés. Les fondements « épistémologiques » de cette prise de position transparaissent dans ce propos d’Éliane Viennot : « on a nommé e féminin le e non-accentué et e masculin le e correspondant au son é — qu’on se met parallèlement à doter d’un accent (tant il est vrai, sans doute, que l’homme se caractérise par un petit quelque chose en plus, qui monte quand il est dur) »5.
Quoi qu’il en soit des promesses de ce symbolisme évocatoire, l’accord de proximité n’est pas employé par ses tenants de façon cohérente. Le manuel du Haut Conseil à l’Égalité propose un exemple rassurant, Les hommes et les femmes sont belles, qui accrédite au passage un stéréotype laudatif souvent jugé sexiste. Il se garde de pratiquer et même d’évoquer l’accord de proximité pour les mots désignant des inanimés, des abstraits, ce qui suggère que l’application conséquente de la règle en soulignerait le ridicule.
3. Enfin, nous l’avons vu, l’introduction d’une ponctuation particulière, tantôt le point dit médian, tantôt le point intercalaire, tantôt le tiret, tantôt le slash, permettrait de décliner dans un même mot les différents genres : ex. tou.te.s6. Cette prescription va cependant à l’encontre d’un principe fondamental des langues : dans une position déterminée, on ne peut avoir qu’un seul signe, que ce soit à l’oral ou à l’écrit ; d’où l’usage des redoublements, comme les adresses du type Françaises, Français. Français.e.s serait imprononçable — ou ralentirait inutilement la lecture. La situation empire encore pour des formules comme des acteur.ice.s blanc.he.s (Unef-Sorbonne).
En outre, des contradictions militantes s’exacerbent et contribuent à la multiplication des dialectes inclusifs. Les inclusivistes mainstream (notamment LGBT) affirment l’inexistence du masculin générique et a fortiori du neutre, pour parvenir à un binarisme tel que tout mot serait féminin ou masculin, et séparent donc dans la graphie, par des points, le masculin du féminin comme dans tou.te.s. Symboliquement, dans l’hypothèse controuvée que les genres grammaticaux représentent les sexes, ils parviennent ainsi à les séparer. Par cette opération, ils réalisent symboliquement la sombre prophétie de Vigny : « Les deux sexes mourront chacun de son côté »7.
De fait, en écriture inclusive, des formules banales qui incluent les deux sexes ne peuvent être écrites : Catherine Kintzler a montré que l’écriture inclusive ne pouvait permettre de désigner un couple hétérosexuel par une formule comme Chers tous deux. C’est là une des conséquences de ses principes séparatistes8.
En revanche, les auteurs refusant tout binarisme — souvent au nom des TQI : trans, queers et intersexes — adoptent une stratégie opposée : multiplier les formes neutres et les graphies syncrétiques. Ils promeuvent ainsi des formes comme toustes (mélange de tous et de toutes) iel (mélange fusionnel de il et elle), voire des flexions comme aex9.
En somme, pour contrôler les usages linguistiques, des voies complémentaires s’ouvrent. À l’oral, on peut multiplier des formules où les unités se suivent dans un ordre stéréotypé. Le figement peut se poursuivre jusqu’à la création de sigles comme LGBTBQI+, ou CC du PCUS, qui valent ensuite comme des signaux de reconnaissance.
Les composés néologiques sont un puissant moyen de figement – et d’intimidation pseudo-théorique : ex. hétéropatriarcal. À son tour, hétéropatriacal entre dans des séries péjoratives comme capitalisme hétéropatriarcal, fréquentes chez des auteurs comme Paul Beatriz Preciado.
L’écrit se prête bien à ces codifications quand elles exploitent la sémiotique graphique, en usant par exemple de capitales encomiastiques pour le E du féminin10 ; ou pour certains mots, comme BLACK dans le New York Times : « The Times has changed its style on the term’s usage to better reflect a shared cultural identity »11. On se demande pourquoi la ségrégation typographique positive du mot BLACK refléterait une « identité culturelle », qui plus est ; mais peu importe : dans les chancelleries de jadis, les capitales étaient utilisées pour les titulatures des souverains.
On ignore encore quel bénéfice les femmes pourraient tirer de ces usages, à moins de penser que l’orthographe puisse comme par magie transformer la réalité sociale. D’ailleurs, de nombreuses firmes usent dans leur communication de l’écriture inclusive, sans pour autant concéder l’égalité salariale. Partageant à présent les mêmes principes managériaux, les administrations comme les entreprises ont perçu le bénéfice qu’elles pouvaient tirer, pour accroître leur contrôle social, d’un nouveau conformisme aux dehors charitablement paternalistes ou plutôt maternalistes.
Les politiciens ne sont pas en reste : par exemple, le président chilien Sebastian Piñera s’est adressé publiquement à « todos, todas y todes » (todes étant un neutre néologique en espagnol) pour ne pas oublier les queer, trans et intersexes, alors que l’IVG n’est toujours pas légalisée ; de même en Argentine, où la communication du président péroniste Alberto Fernández n’oublie pas l’inclusivisme.
L’écrivaine argentine Claudia Piñeiro concluait cependant en mars 2019 son éloge du langage inclusif au 8e Congrès international de la langue espagnole : « Quoi de mieux que transformer la langue pour faire la révolution ? »12. Lui répondant par avance, Ludwig Hevesi avait raillé un poète italien anti-impérialiste contraint de célébrer un empereur allemand : « Ne pouvant chasser les Césars, il fit du moins sauter les césures »13.
À ce compte, par magie inclusive, les présidents argentin et chilien, l’un péroniste, l’autre milliardaire pinochétiste, seraient révolutionnaires.
La sombre prophétie de Malraux selon laquelle ce siècle serait mystique risque de s’avérer sur le mode dégradé de la superstition. Comme l’époque est aux panacées de savants providentiels, aux remèdes salvateurs snobés par les élites, qui sait si l’écriture inclusive n’est pas une de ces thériaques ?
Sa première indication est celle d’une rectification de la pensée : dans un plaidoyer, un promoteur de l’écriture inclusive souligne qu’en user « c’est s’astreindre à penser la mixité, la diversité ». Cette astreinte de la pensée permettrait paradoxalement l’émancipation, ce qui évoque le schème quelque peu ascétique d’un exercice spirituel14.
En outre, la formule inclusive est évocatoire, puisqu’elle inclurait les femmes dans le langage. Ainsi, elle fonctionne tout à la fois comme un signal dénotatif (le –e désignerait la femme), mais aussi comme un symbole magique, puisque la formule en vient à inclure ce qu’elle désigne. Le texte inclusif devient un petit monde de substitution qui révolutionne le monde injuste.
Toutefois, les femmes ne sont pas incluses pour autant, car parler de quelque chose ou de quelqu’un n’est pas l’inclure, de même que le taire n’est pas l’exclure. Nous retrouvons ici un vieil usage superstitieux du langage, le mantra évocatoire. Il s’inverse cependant dans un autre usage, celui du tabou linguistique, puisque à mesure que des formules sont prescrites, d’autres sont interdites. Par exemple une étudiante argentine déclare : « Quand je dis “todos” au lieu de “todes”, j’ai l’impression de mal faire car avec “todos”, je n’inclus pas tout le monde, alors je me corrige tout de suite » (Montoya, loc. cit.). Une fois la culpabilité reconnue par la croyante, la correction, par un barbarisme ou néologisme neutre, entraîne la suppression de la forme plurielle, jugée peccante.
Ignace de Loyola ne manque pas de rappeler que les évocations malignes doivent être chassées. Il aura été entendu, et, prudente, l’Association nord-américaine des joueurs de Scrabble (Naspa) entend bannir 225 mots ayant trait au genre, à l’origine ethnique ou à l’orientation sexuelle de la liste des termes utilisés en compétition. L’exaltation de certains mots se double ainsi de la condamnation de bien d’autres.
Revenons à présent du genre grammatical au sexe qu’il est supposé représenter, pour préciser quelle image symbolique de la société dessine l’écriture inclusive.
(i) La prohibition d’usages communs du masculin est liée, souvent explicitement, à la dénonciation du patriarcat — du moins le patriarcat « blanc », apparemment le seul à vouloir tout dominer. Une guerre semble se perpétuer, du Scum manifesto de 196715 aux manifestations de juillet 2020 avec le slogan : « un violeur à l’Intérieur, sortons les sécateurs ». L’émasculation serait une victoire finale.
(ii) On prohibe de fait l’hétérosexualité, dans la mesure où l’on ne peut désigner par une expression inclusive un couple composé d’un homme et d’une femme. Dans une logique identitaire, il reste impossible de concevoir que deux personnes de sexes différents puissent être complémentaires : d’où l’opprobre jetée sur l’hétérosexualité, création patriarcale. Quand cette logique s’applique à la langue, elle exclut alors les formes qui pourraient désigner syncrétiquement les deux genres et évoqueraient ainsi des copulations exécrables.
(iii) On crée une indistinction de genre, et, croit-on, de sexe par des formes neutres ou syncrétiques. Ce programme peut être rattaché à celui de la déconstruction, qui après l’inversion des valeurs, promeut l’indistinction catégorielle16.
Opérant une ségrégation imaginaire des sexes, mais bien réelle des scripteurs et des lecteurs, l’écriture inclusive reste omniprésente dans la cancel culture, et il n’est plus de tribune dénonciatrice qui ne se pare de ses marques. Les cibles sont des variables, mais le discours varie moins encore que les incriminations : elles agrègent race, sexe, genre, religion et domination de manière à constituer des camps affrontés.
Bien que cela dépasse le propos de cette note, rappelons enfin que des distinctions fondatrices pour la linguistique semblent souverainement ignorées par les réformateurs : entre le signe linguistique et le signal ; entre la langue et l’écriture17 ; entre le morphème et la chaîne de caractères ; entre une langue et un code ; entre sens et référence ; enfin entre description et imposition de normes. Les théoriciens de l’écriture inclusive à la française sont d’ailleurs des spécialistes de littérature et de stylistique : autrices ou auteurs de thèses sur Marguerite de Navarre, Balzac, Sarraute, etc., ils développent une vision évocatrice du langage, sans s’arrêter outre mesure à son fonctionnement effectif.
À mesure que l’entreprise scientifique se voit récusée, le mythe peut s’édifier.
Quelques difficultés
L’écriture inclusive suscite des difficultés pour les non-militants : les enfants en apprentissage, puisqu’elle rompt avec les règles de prononciation et de ponctuation qu’ils sont en train d’acquérir — et les associations de parents d’élèves y sont donc unanimement opposées ; les étrangers qui se heurtent à des usages mystérieux ; les lecteurs qui ont des difficultés de déchiffrement, pourcentage non négligeable ; les dyslexiques et les dyspraxiques ; enfin les simples lecteurs. L’Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques (Aphpp) a d’ailleurs saisi l’Association des maires de France ainsi que la nouvelle Défenseure des droits, Claire Hédon. Les études disponibles relèvent en effet des difficultés de lecture et d’écriture.
Paradoxalement, l’écriture dite inclusive exclut donc la majorité. En outre, les différents groupes prescripteurs ont des usages incohérents entre eux, et les normes dites inclusives ne sont presque jamais observées de façon régulière : une association de parents d’élèves a ainsi détaillé comment un texte de l’Inspection académique de Lyon ne parvenait pas à respecter de manière continue les principes de l’écriture inclusive qu’il prônait pourtant. Quand même les partisans de l’écriture inclusive hésitent et varient, à plus forte raison ce mode d’écriture insécurise les rédactrices et rédacteurs à qui leurs tutelles l’imposent18.
L’écriture inclusive se réduit donc à des signes de reconnaissance pour des communautés militantes, qu’elles soient politiques, sexuelles ou religieuses — dans le cas des féministes islamiques19. Elle apparaît alors comme fédératrice, sinon « intersectionnelle » : par exemple, dans son communiqué de presse du 23 mars 2019, l’Unef-Sorbonne Université s’indignait20 que « des acteur.ice.s blanc.he.s » puissent porter des masques ou maquillages sombres dans la mise en scène d’une pièce d’Eschyle, Les Suppliantes. Ce syndicat se félicita ensuite que des voies de fait aient empêché physiquement la tenue du spectacle : cette atteinte aux libertés universitaires et à la liberté de création, coup de semonce d’une cancel culture en France, fut saluée par divers manifestes en écriture inclusive, dont celui des 343 Racisé.e.s.
Des « communautés » sont certes libres d’exprimer ce genre de prétentions, mais non de faire pression pour les imposer ; toutefois, elles ont pour ce faire trouvé des relais dans différentes organisations. Leurs usages et leurs éléments de langage sont repris par divers organismes et administrations. Des personnalités importantes donnent l’exemple. Préfaçant avec enthousiasme un collectif décolonial intitulé Sexualités, identités et corps colonisés (éditions du CNRS, 2019), Antoine Petit, président du CNRS, déclare que « la race est devenue la nouvelle grille de lecture du monde sur laquelle s’intègre la grille de genre ». Ce genre se donne à voir quand il évoque « les relations entre anciens colonisateurs.trices et ex-colonisé.e.s » (p. 13). Donnant un dernier gage, il évoque aussi les chercheur.e.s, inventant au passage le mot chercheure au détriment de chercheuse, jusqu’alors attesté — preuve supplémentaire que l’écriture inclusive multiplie les barbarismes.
Soutenu par des organismes officiels, une sorte de séparatisme militant se fait jour. Écrit par Laélia Véron et Maria Candea, un manuel promu par la Direction générale à la langue française et aux langues de France, la DGLFLF, s’intitule ainsi Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique. L’ouvrage promeut une conception politique de la langue, notamment celle qui préside à l’écriture inclusive, comme au chapitre 5 « Masculinisation et féminisation du français. La langue comme champ de bataille » et au chapitre 6 « Langue française et colonialisme. La langue comme étendard ? ».
Champ de bataille, étendard, une conception polémique s’affirme. La DGLFLF finance en outre un podcast édifiant animé par les mêmes auteures : Parler comme jamais21.
Le français toutefois n’appartient à personne mais à tous ceux qui en usent et aucun groupe ne peut prétendre en disposer à sa guise. Le principe selon lequel chaque « identité » doit s’inscrire dans la langue est évidemment un facteur de division.
Pourquoi politiser la langue ?
Dans la recherche comme dans l’enseignement, chacun reçoit régulièrement des messages administratifs en écriture inclusive. Des revues, des colloques intègrent l’écriture inclusive dans leur feuille de style. Des appels d’offres, des profils de poste sont rédigés ainsi, contraignant de fait ceux qui répondent à faire de même, si bien que des ruptures d’égalité se font jour au profit des partisans de l’écriture inclusive. Bref, même enrobée de bons sentiments, la doctrine inclusive n’est ni cool, ni progressiste, ni émancipatrice, car elle crée et entretient des confusions sur la langue comme sur la société.
En 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, encore vilipendée par Éliane Viennot, consacrait le français comme langue officielle ; et la République, garante de l’unité nationale, a maintenu ce principe, comme en témoigne l’article 2 de la Constitution. L’emploi d’une langue commune et l’accord sur ses usages sont des facteurs importants d’unité — et les querelles artificielles restent un facteur de division.
Derrière le prétexte charitable de rendre les femmes « visibles », il s’agit bien à présent, comme l’affirme par ailleurs Norman Ajari, philosophe et idéologue décolonial, de « Casser la République en deux »22. L’écriture inclusive devient un moyen de contribuer à ce programme mobilisateur.
Élaborée et diffusée par des groupes militants LGBT, puis reprise par divers organismes, l’écriture inclusive, même s’il est trop tôt pour en parler au passé, aura été un des ces multiples « sujets de société » qui font l’ordinaire des médias et des réseaux sociaux. Mais elle aura détourné l’attention des problèmes fondamentaux, qu’il s’agisse des droits à l’éducation et au travail, des inégalités salariales et même du contrôle des naissances — au motif qu’il ne concerne pas les LGBT23.
L’écriture inclusive devient de plus en plus politisée. Le premier acte majeur du nouveau maire écologiste (EELV) de Lyon aura été de faire adopter par sa majorité l’usage de l’écriture inclusive. Un député de l’opposition, membre du Rassemblement national, Sébastien Chenu, a déposé le 28 juillet une proposition de loi « visant à interdire l’usage de l’écriture inclusive par toute personne morale ou privée bénéficiant d’une subvention publique ». Ce dépôt donne par contraste une caution « de gauche » aux partisans de l’écriture inclusive et permet au Rassemblement national de se poser en principal défenseur des principes de l’unité républicaine. Peu importe que ce projet vienne ou non en débat, l’effet d’aubaine est là : une division peut s’installer au plan politique entre une écriture « blanche » et une écriture « intersectionnelle », pour participer d’un affrontement spéculaire des extrêmes au détriment de la plupart des citoyens.
Le Premier ministre a récemment annoncé la préparation d’une loi contre les séparatismes. On ignore si elle tiendra compte du séparatisme linguistique, mais déjà règne une sorte d’anarchie bureaucratique qui voit s’opposer en faveur de l’écriture inclusive la charte Fioraso-Vallaud Belkacem de 2013, le rapport 2015 du Haut Conseil pour l’Égalité, des pratiques de la DGLFLF et, d’autre part, contre son usage, l’Académie française et les services du Premier ministre. Peu importe ici l’activité législative, les usagers de la langue française attendent de toutes façons une clarification. Une position publique unifiée donnerait un signal utile pour appuyer tous ceux qui dans la société civile refusent par souci d’unité de se voir imposer des normes inutiles et discriminatoires.
Si l’action publique devait être éclairée sur un tel sujet, il ne serait pas discourtois d’enquêter auprès des linguistes, des pychologues du développement, des orthophonistes notamment ; mais, à considérer leur communication, les décideurs du CNRS et des agences de moyens semblent acquis à l’écriture inclusive et l’on peut douter qu’ils financent des projets de recherche qui risqueraient de refroidir l’enthousiasme.
Épilogue
Qu’un parti politique ait pris pour nom Génération.s et pour sigle G·s mérite enfin l’attention. S’agit-il d’inclure plusieurs générations ou de faire de ce point intermédiaire un signe de ralliement des multiples mouvements qui affichent leur inclusivité ? Quelle conception de la politique se profile ainsi ? Une approche véritablement politique, au sens démocratique du terme, du langage conduirait à le dépolitiser, en évitant de faire d’un jargon un « étendard » sur un « champ de bataille ». Après tout, le langage, du moins en démocratie, sert aussi à parler avec ses ennemis, alors que les régimes extrémistes n’en usent que pour les stigmatiser inlassablement — et pour imposer leurs usages aux citoyens qui n’en peuvent mais. Au demeurant, le fait que le langage inclusif puisse se voir adopté par des firmes dangereuses, des politiciens d’extrême droite et des islamistes montre que ses attendus populistes ne sont pas incompatibles avec des politiques répressives.
Quoi qu’il en soit, deux constats laissent perplexe.
- Aucun organisme inclusiviste, officiel ou non, n’emploie l’écriture inclusive de façon cohérente et continue. Par exemple, le parti Génération.s orthographie son propre nom de trois façons différentes sur son site officiel. Ses fondateurs disent son nom tantôt en détachant les syllabes [ʒe.ne.ʁa.sjɔ̃], tantôt en énonçant, comme en dictée, Génération point S.
- Aucun des manifestes et manuels déjà nombreux que nous avons étudiés ne suit ses propres recommandations : soit elles ne sont pas véritablement applicables, soit elles ne servent qu’à formuler des signes de ralliement. Par les méthodes de la linguistique de corpus, on pourrait en outre montrer que les formes inclusives (mis à part les exemples) se concentrent au début des textes, tout particulièrement dans le premier décile, ce qui suggère une fonction d’affichage.
Bizarrement, alors qu’ils prônent une hypercorrection inclusive, les pratiquants ne dédaignent pas les solécismes et ne s’inquiètent pas des barbarismes que l’écriture inclusive leur permet de produire, comme, nous l’avons vu, chercheure sous la plume du président du CNRS. Par exemple, le Haut Conseil à l’Égalité écrit : « Constatant l’inapplication de la première circulaire de 1986, le Premier ministre a réitérée [sic] cette obligation dans une circulaire du 6 mars 1998 […] » (pour une analyse, voir supra Kintzler, note 3).
La récente pétition demandant « l’abrogation » de la proposition de loi déposée par le Rassemblement national contre l’écriture inclusive fut rédigée par une coach en écriture inclusive, qui répète : « Il est important de répéter et répéter les choses et les mots justes afin de s’en imprégner, de connaître leur sens, leur histoire et de les comprendre. S’en imprégner pour que l’inconscient ne croit [sic] plus en cette règle qui affirme que le masculin l’emporte sur le féminin »24.
Inutile de chagriner encore le lecteur par un étalage de bévues qui pourraient n’être qu’un indice de dérégulation parmi tant d’autres : récurrentes, elles ne sont pas de simples coquilles ou négligences, mais elles deviennent significatives, puisque ici les prescriptions militantes et le mépris des conventions communément admises se complètent. Si les inclusivistes ne peuvent ou ne veulent appliquer leurs propres normes, pourquoi appliqueraient-ils les autres ? Ils semblent vouloir aussi en édicter pour s’affranchir des autres.
Dans tous les courants identitaires, les normes externes paraissent insupportables : c’est le pouvoir qui est en jeu, comme le souligne justement Raphaël Haddad, auteur d’un manuel inclusif. En effet, la vocation du français inclusif semble bien être de remplacer le français standard, et comme l’écrit Alphératz, auteure d’un autre manuel : « Si les manuels et les grammaires deviennent inclusives, la distorsion de la régularité risque d’affecter non plus les discours, mais aussi la langue, où la régularité (le français standard) pourrait devenir distorsion, et la distorsion (le français inclusif) régularité » ( loc. cit., p. 67)25.
Si la dictature des identités individuelles et collectives pousse chacune à édicter ses propres normes et à s’affranchir des autres, l’incorrection et l’hypercorrection peuvent aller de pair et relever d’un même projet « révolutionnaire » conduit dans une irresponsabilité communicative. Un principe de bon plaisir militant met alors en jeu le principe de réalité : dans toute tradition culturelle, il est crucial de pouvoir établir, au sens philologique du terme, les documents à interpréter de façon à les objectiver de manière critique, et à les instituer ainsi en biens communs qui puissent être transmis. C’est précisément ce que refuse l’idéologie déconstructionniste, qui prône en la matière une incurie stratégique, en invoquant au besoin l’ouverture infinie des interprétations.
Avec la correction de la langue, qu’il s’agisse de l’orthographe, mais aussi du lexique et de la syntaxe, c’est non seulement la tradition culturelle qui est en jeu, mais aussi la culture comme mouvement international de création des œuvres artistiques ou théoriques. Or, traditionnellement, dans le courant de la déconstruction dont se recommandent les principaux théoriciens de l’inclusivisme, la culture est suspecte à divers titres et se voit accusée tantôt d’être juive, et/ou coloniale donc blanche, et/ou masculiniste. Voici par quels biais principaux.
(i) Heidegger fit d’abord cette déclaration identitaire dans son discours du rectorat : « Le monde spirituel d’un peuple n’est pas la superstructure d’une culture, non plus que l’arsenal des connaissances et des valeurs utiles, mais la puissance de la plus profonde préservation de ses forces issues de la terre et du sang »26. Le monde spirituel s’oppose à la culture, car elle ne définit aucune identité, à la différence de la terre et du sang, selon l’idéologie Blut und Boden. La culture reste en quelque sorte déracinée, autant dire qu’elle est un instrument des Juifs : « S’approprier la ’’culture’’ comme instrument de pouvoir, s’en prévaloir et se donner pour supérieur, c’est fondamentalement un comportement juif » 27.
(ii) S’appuyant sur Heidegger, Derrida élabora le programme de déconstruction qui euphémise mais radicalise la destruction (Destruktion ou Abbau) que prônait le maître. Derrida a en effet transposé et étendu la récusation heideggérienne de la culture, en postulant sa « colonialité essentielle » 28, ce qui vise évidemment la colonisation occidentale. Dès lors, il pose que l’« inculture radicale » devient une « chance paradoxale »29 . Il inverse ainsi le préjugé colonialiste qui faisait des peuples conquis des peuples sans culture.
(iii) L’oppression coloniale et l’oppression machiste vont de pair, comme l’a établi la théorie de l’intersectionnalité. Déjà Valerie Solanas assurait que la culture « permet aux hommes de se glorifier de leur faculté d’apprécier « ’’les belles choses’’, de voir un bijou à la place d’une crotte » (op.cit., p. 19). Elle en concluait : « La vénération pour ’’l’Art’’ et la ’’Culture’’ distrait les femmes d’activités plus importantes et plus satisfaisantes, les empêche de développer activement leurs dons, et parasite notre sensibilité de pompeuses dissertations sur la beauté profonde de telle ou telle crotte » (op. cit., p. 20). Le livre de Solanas est toujours présenté comme un « must-read absolu »30 (Les Inrocks, 2019) et Avital Ronell, philosophe post-féministe heideggérienne, dans sa longue introduction à une réédition récente (Verso Books, 2016), convoque à son propos Derrida et Butler – sans parler de Médée et d’Antigone.
Ainsi, dans les programmes identitaires que développent la déconstruction et les Cultural Studies qui en sont issues, l’incurie prend la valeur programmatique d’un combat contre la culture. Cet arrière-plan n’est pas toujours perceptible pour les partisans de l’écriture inclusive, mais elle ne prend tout son sens, si l’on peut dire, que dans cette guerre sans fin.
N.B. — J’ai plaisir à remercier ici Yana Grinshpun.
Notes