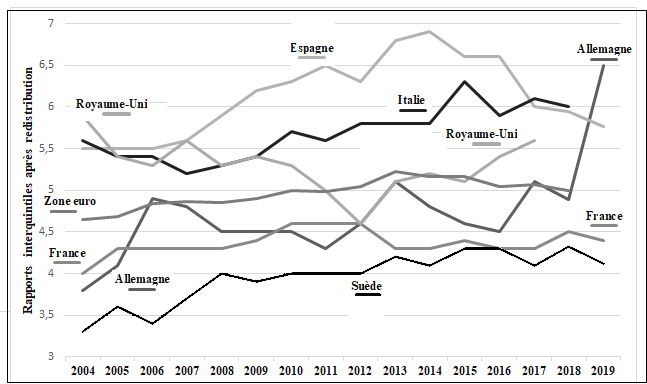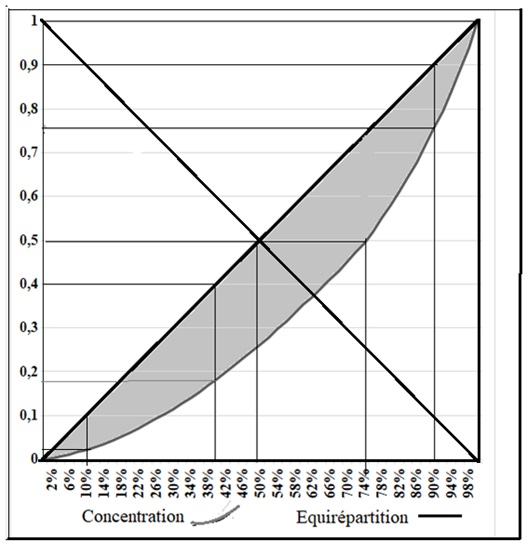Quentin Bérard1 nous invite à relire (ou à lire) Cornelius Castoriadis en prenant quelque distance avec les lectures convenues qui depuis des années l’enrôlent un peu trop facilement au service de l’agitation gauchiste, de la cause des migrants, du néo-marxisme ou du pacifisme et de l’écologisme contemporains, voire de la « déconstruction » et du « décolonialisme ». Ces opérations de récupération s’effectuent au prix de l’escamotage du contenu de bien des textes. L’auteur offre et commente ici de substantiels extraits qui placent Castoriadis hors de la bien-pensance contemporaine. L’objet n’est pas de l’assigner à une autre position, ce qui réitérerait en l’inversant le geste d’embrigadement, mais de montrer en quoi il fait œuvre et, en rencontrant son ambition de penser les basculements de son époque, de s’en inspirer pour penser ceux de la nôtre.
Première partie.
Lire la seconde partie
« Tout a été déjà dit. Tout est toujours à redire.
Ce fait massif, à lui seul, pourrait conduire à désespérer.
L’humanité semblerait sourde ; elle l’est, pour l’essentiel »2.
Introduction
Cornelius Castoriadis (1922 – 1997) semble devenu, au fil des vingt-cinq années qui se sont écoulées depuis sa mort, une sorte de classique silencieux, connu sans être reconnu – ou l’inverse. Ainsi, un travail universitaire de sciences sociales se doit de citer son opus magnum, au moins, L’institution imaginaire de la société (1975) ; tout journaliste doit savoir prononcer son nom et, grossièrement, placer quelques-unes de ses formules les plus connues comme « l’époque du conformisme généralisé », « le délabrement de l’Occident » ou encore « la montée de l’insignifiance » ou « le monde morcelé », quelquefois à contre-emploi ; et un militant approximativement de gauche aura, a minima, lu ou entendu une fois son entretien avec Daniel Mermet3 en 1996 ou sa conférence-débat avec Daniel Cohn-Bendit « De l’écologie à l’autonomie »4 de 1981, voire pour les plus radicaux, son quasi-manifeste « Racines subjectives et logique du projet révolutionnaire »5 de 1964 permettant d’habiller commodément sa subversion d’auto-institution sociale explicite et d’anti-totalitarisme.
La présence fantomatique de C. Castoriadis hante donc les cercles politico-intellectuels d’une « gauche » plus ou moins militante. À travers articles, revues, livres, radios, conférences, thèses ou mémoires, blogs et causeries diverses, on convoque commodément et sans frais l’engagement de celui-ci pour la démocratie directe, l’autonomie individuelle ou la justice sociale. Permettant de pimenter un peu la litanie des « penseurs » plus conventionnels mais usés jusqu’à la corde, son nom dépayse quelque peu et sonne comme garant d’une profondeur estimée subversive et/ou intellectuelle pour les partisans de cet indéfinissable « autre monde possible » face à leurs ennemis héréditaires proclamés : oligarchie, libéralisme, capitalisme, droite ou extrême droite, xénophobie, racisme et tutti quanti. Et c’est ainsi que l’on croise, inopinément et plus ou moins explicitement, un Castoriadis enrégimenté au service de l’agitation gauchiste ou de la cause des migrants, du néo-marxisme ou du pacifisme et de l’écologisme contemporains, voire de la « déconstruction » et du « décolonialisme »…
Mais ces opérations routinières de récupération, dont la gauche est experte depuis un siècle, se font évidemment au prix de l’escamotage d’un élément de taille : le contenu des textes, dont la simple lecture (il faudrait préciser en cet an de grâce 2023 : une lecture complète, attentive et honnête) évente un procédé que C. Castoriadis a passé sa vie à analyser, dénoncer et contrer. Ce n’est pas seulement qu’il ne reconnaissait plus le sempiternel et dilatoire clivage droite / gauche – « Les gens découvrent maintenant ce que nous écrivions il y a trente ou quarante ans […] à savoir que l’opposition droite/gauche n’a plus aucun sens » écrivait-il… il y a également trente ou quarante ans6 – mais surtout que la gauche, ses extrémités, ses déclinaisons et tous leurs rapiéçages idéologiques faisaient intégralement, fondamentalement et centralement partie du problème. Il écrivait, en 1977 :
« Compilation, détournement et déformation des idées des autres, abondamment cités lorsqu’ils sont « fashionables », tus (ou cités « à côté » : procédé qui se propage) lorsqu’ils ne le sont pas. Dans l’accélération de l’histoire, la nouvelle vague des divertisseurs fait franchir un nouveau cran à l’irresponsabilité, à l’imposture et aux opérations publicitaires. Pour le reste, elle accomplit bien sa fonction. Ces clowneries ne dérangeront pas la « gauche » officielle : elles ne peuvent que la conforter et la rassurer. »7
Le quart de siècle qui s’est écoulé depuis que sa voix s’est éteinte n’a fait que précipiter une dérive que l’insurrectionnalisme, l’islamo-gauchisme, l’« indigénisme », le « néo-féminisme », « l’écologie décoloniale », le racialisme, le wokisme ou le « sans-frontiérisme » poussent à la caricature. La dissidence de C. Castoriadis vis-à-vis de la bien-pensance contemporaine est totale : non seulement à propos de la « gauche » en général, partis, syndicats, groupuscules ou intellectuels de service (les « divertisseurs »), des mouvements sociaux, de l’héritage des années soixante, du féminisme ou de l’écologie mais plus encore sur la question de l’identité occidentale, du racisme, de la colonisation, de l’islam ou de l’immigration.
I – La gauche et ses excroissances
C. Castoriadis était parvenu, au début des années soixante au sein du groupe-revue « Socialisme ou Barbarie » (1945-1967) fondé avec Claude Lefort, « au point où il fallait choisir entre rester marxistes et rester révolutionnaires »8 – phrase aujourd’hui redevenue incompréhensible pour beaucoup. Leurs travaux de l’époque auront finalement consisté en une réfutation du marxisme menée de l’intérieur, mettant à nu son caractère clairement idéologique et les tropismes magico-religieux de ceux qui s’en réclament ou qui, de nos jours, et c’est bien pire, en sont imbibés sans même le savoir en en reprenant les schémas les plus messianiques. Il écrivait, en 1959 :
« Tout ce qui a existé et existe comme forme instituée au mouvement ouvrier — partis, syndicats, etc., — est irrémédiablement et irrévocablement fini, pourri, intégré dans la société d’exploitation. Il ne peut pas y avoir de solutions miraculeuses, tout est à refaire au prix d’un long et patient travail. »9
Les « révolutionnaires »
Cette ambition n’a pas été relevée, évidemment, et plus de quarante ans après, le constat de celui qui s’est dit révolutionnaire jusqu’à son ultime texte10 reste cruellement actuel :
« Il y a un paradoxe tragi-comique dans le spectacle de gens qui se prétendent révolutionnaires, qui veulent bouleverser le monde et qui en même temps cherchent à s’accrocher à tout prix à un système de référence, qui se sentiraient perdus si on leur enlevait ce système ou l’auteur qui leur garantit la vérité de ce qu’ils pensent. Comment ne pas voir que ces gens se placent eux-mêmes dans une position d’asservissement mental par rapport à une œuvre qui est déjà là, maîtresse de la vérité, et qu’on n’aurait plus qu’à interpréter, raffiner, etc. (en fait : rafistoler…). »11
Les écrits lumineux de C. Castoriadis sur les mois de mai-juin 1968, à la fois enthousiastes et très sévères quant à l’absence de perspectives des émeutiers et leur inévitable récupération12, semblent écrits pour les insurrectionnalistes actuels, qu’ils soient sur canapé ou Blacks Blocs. Ce qu’il nomme le « révoltisme » – on psalmodie aujourd’hui la « convergence des luttes » – repose en réalité sur la croyance en un « privilège politico-historique des pauvres » repris de l’« héritage chrétien »13 :
« Comme le réformisme, le « révoltisme » ou bien est totalement incohérent, ou bien est d’une secrète mauvaise foi. Aucun politique, aucun homme qui pense et essaie de faire quelque chose relativement à la société, ne peut jamais proposer ou prendre une disposition sans s’interroger sur les répercussions que cette disposition pourra avoir sur les autres parties du système. […] ou bien [le « révoltiste »] est incohérent, ou bien il est un révolutionnaire qui refuse de s’avouer tel, c’est-à-dire nourrit le secret espoir qu’un jour toutes ces révoltes pourront quelque part se sommer, se cumuler, s’additionner en une transformation radicale. Allons plus loin, puisqu’aussi bien le « révoltisme » semble aujourd’hui gagner du terrain auprès de gens très honorables et fort proches. Quel en est le « fondement » philosophique ? […] [que] toute société est essentiellement aliénée, l’aliénation tient à l’essence du social. (Conséquence immédiate : l’idée d’une société non aliénée est une absurdité.) »14
Cette conception, profondément a-politique, n’est finalement que la rationalisation ou l’intellectualisation de la disparition de tout projet de société, y compris et surtout au sein des populations elles-mêmes. Cela aurait engendré, mécaniquement, la contre-offensive oligarchique de la fin des années 70 :
« D’où est donc venue la force de ce pseudo-libéralisme depuis quelques années ? Je pense que, pour une grande partie, elle vient de ce que la démagogie « libérale » a su capter le mouvement et l’humeur profondément anti-bureaucratique et anti-étatique qui remuent la société depuis le début des années 60. […] L’échec des mouvements des années 60 a convergé avec les tendances profondes du capitalisme bureaucratique, poussant les gens à l’apathie et à la privatisation. »15
Les mouvements sociaux
La gauche assagie n’est pas plus cohérente : à l’occasion du mouvement lycéen de 1986 qu’il salue tout en déplorant l’absence totale de perspective des manifestants, il pointe
« ‟l’inconsistance des nouveaux républicains”. C’est-à-dire des anciens gauchistes ou communistes reconvertis à des idéaux républicains ou démocratiques, et qui à partir du moment où le mouvement était là, se sont mis à applaudir à tout rompre sans se demander une seule seconde si, dans une république ou une démocratie il est concevable qu’une section particulière de la population impose sa volonté contre ceux qui passent pour être la représentation nationale et même contre la Constitution. Dans le langage de droite, qui a poussé des hurlements horrifiés, « c’est la rue qui fait la loi », etc. ; mais ce n’est pas parce que la droite hurle comme ça, c’est son rôle, que je trouverai moins incohérents les « républicains » qui disent « bravo ». »16
Critique qu’il reprend lors du mouvement de novembre-décembre 1995 contre la réforme des retraites initiée par le ministre Alain Juppé, à l’occasion duquel il a refusé de signer tous les textes en circulation :
« Le premier (celui proposé par [la revue] Esprit) approuvait le plan Juppé, en dépit de quelques réserves théoriques, et était inacceptable pour moi. Le second (connu comme « liste Bourdieu ») était imprégné de la langue de bois de la gauche traditionnelle et invoquait la « République » – laquelle ? – comme s’il y avait une solution simplement « républicaine » aux immenses problèmes posés actuellement. Un mélange d’archaïsme et de fuite. »17. Il ne s’attarde pas sur la « gauche politique [et] les organisations syndicales [qui] ont encore une fois exhibé leur vide. Elles n’avaient rien à dire sur la substance des questions. Le Parti socialiste, gérant loyal du système établi, a demandé de vagues négociations. Les deux directions syndicales, CGT. et FO., ont sauté dans le train du mouvement après son déclenchement, en essayant de redorer leur blason. À cet égard, rien de nouveau. ».
Son regard sur les manifestants eux-mêmes reste tout aussi désespérément d’actualité :
« Ce qui est neuf, en revanche, et très important, c’est le réveil social auquel on vient d’assister. En surface, les revendications étaient catégorielles et le mouvement semblait se désintéresser de la situation générale de la société. Mais il était évident, à considérer les réactions des grévistes aussi bien que l’attitude de la population dans sa majorité, qu’au cours de cette lutte il y avait autre chose : un profond rejet de l’état de choses existant en général. Ce rejet, les grévistes n’ont pu l’exprimer que par des revendications particulières. Comme celles-ci, par leur nature même, ne tiennent pas compte de la situation générale, on aboutit forcément à une impasse. »
C. Castoriadis insistera sur le « corporatisme » des grévistes, faisant réagir les animateurs de Radio Libertaire qui l’interviewaient l’année suivante18, et sera mis en demeure de s’expliquer sur ces positions, jugées « gênantes » par l’auditoire, en 1997 lors de sa dernière conférence publique19.
« Toute la Gauche occidentale ment »
En réalité, c’est bien toute la gauche qui, pour lui, est devenue l’artisan de l’effondrement politico-intellectuel occidental et fournisseur officiel de sa dénégation en même temps que de sa rationalisation. L’article méconnu « Illusion et vérité politiques »20, écrit en 1978-1979 mais édité en 2013, contient des pages qui mériteraient d’être reproduites ici in extenso :
« […] ce que l’on appelle aujourd’hui la Gauche est, extérieurement, l’héritier de mouvements et de courants qui s’étaient voulus, et avaient effectivement été jusqu’à un certain point, les protagonistes de la clarification, de la dénonciation des mensonges du pouvoir, du dévoilement des mystifications, de la lutte pour la vérité sociale et politique. Au départ, la Gauche a dénoncé, démystifié, éclairé. Au bout de sa carrière, elle est devenue, dans tous les pays, arracheur de dents politique. […] Pour que l’illusion moderne de la Gauche marche, il faut que le partisan de la Gauche coopère activement à sa propre mystification, y mette du sien, pallie les contradictions flagrantes et les stupidités manifestes de la propagande des partis, s’invente des raisons et des rationalisations, bref : participe. Dans un domaine du moins, on aurait tort d’accuser les partis de Gauche d’être hypocrites lorsqu’ils parlent d’autogestion : ils font ce qu’ils peuvent pour encourager l’autogestion de la mystification, l’auto-mystification de leurs partisans. Impossible, en effet, pour ceux-ci d’être simplement nourris par les mensonges de leurs Partis à l’état cru ; il faut encore qu’ils les métabolisent, il faut aussi et surtout qu’ils transforment périodiquement leurs propres organes de métabolisation, car la nature de la matière première change. On doit constater que, malgré leur étonnante inventivité et créativité, ils auraient difficilement pu, au-delà d’un certain point, continuer de remplir cette tâche surhumaine sans le secours vital d’une foule d’enzymes d’une grande variété occupant les sites successifs de la chaîne métabolique qui va du cerveau des Partis au cerveau des électeurs : les Intellectuels de Gauche, grands, moins grands et tout petits. »
À l’époque de ce texte, la gauche était passée par le stalinisme plus ou moins déclaré, le trotskisme, le maoïsme ou le situationnisme, le titisme et tous les tiers-mondismes, algérien, cubain, chinois, vietnamien, le régionalisme et l’humanitarisme et s’apprêtait à s’adonner au mitterrandisme, au droit-de-l’hommisme, à l’antiracisme pour aujourd’hui verser sans retenue dans l’immigrationnisme, le multiculturalisme et l’anti-autoritarisme et culminer dans une collaboration de plus en plus explicite avec un nouveau totalitarisme à visée mondiale – le totalitarisme musulman encore appelé islamisme21. Plus que jamais, ces lignes de Castoriadis résonnent, sans même évoquer les comportements électoraux où l’électeur de gauche ne s’embarrasse même plus d’auto-mystification : son besoin de croire s’attache seulement à un stimulus pavlovien d’un côté et à un ennemi ontologique souvent inconsistant de l’autre (C. Castoriadis, par exemple, n’a cessé de dénoncer l’ineptie de l’usage du terme « libéralisme » pour décrire un quelconque état de fait économique existant). Bref, : « Toute la Gauche occidentale ment »… L’origine de cette dégénérescence continue qui ne s’embarrasse d’aucun bilan – et s’enfonce derechef aujourd’hui dans une surenchère de radicalité creuse – est à chercher loin.
L’héritage ambigu des mouvements des années soixante
La critique de cette gauche institutionnelle ou pseudo-révolutionnaire, que C. Castoriadis n’a cessé de formuler, n’est donc absolument pas une accusation d’insuffisance ou de manque de radicalité – reposant sur un spontanéisme qu’elle ne quitte que pour se bureaucratiser, sa subversion est vide. Pire, ses idéologues les plus en vue (Lacan, Foucault, Althusser, Bernard-Henri Lévy, etc.) et leur « nihilisme pseudo-subversif » en rationalisent les échecs, comme ce fût le cas pour celui de Mai 68 :
« Ce que les idéologues fournissent après coup, c’est à la fois une légitimation des limites (des limitations, en fin de compte : des faiblesses historiques) du mouvement de Mai : vous n’avez pas essayé de prendre le pouvoir, vous avez eu raison, vous n’avez même pas essayé de constituer des contre-pouvoirs, vous avez encore eu raison, car qui dit contre-pouvoir dit pouvoir, etc. ; et une légitimation du retrait, du renoncement, du non-engagement ou de l’engagement ponctuel et mesuré : de toute façon, l’histoire, le sujet, l’autonomie, ne sont que des mythes occidentaux, cette légitimation sera du reste rapidement relayée par la chanson des nouveaux philosophes à partir du milieu des années 70 : la politique vise le tout, donc elle est totalitaire, etc. (et elle en explique aussi le succès). Avant de se replier sur les « résidences secondaires » et la vie privée, et pour ce faire, les gens ont eu besoin d’un minimum de justification idéologique (tout le monde n’ayant pas, hélas, la même admirable liberté à l’égard de ses dires et actes d’hier que tel ou tel autre, par exemple). C’est ce que les idéologues continuaient à fournir, sous des emballages légèrement modifiés. (…) pour les dizaines ou centaines de milliers de gens qui avaient agi en mai-juin mais ne croyaient plus à un mouvement réel, qui voulaient trouver une justification ou légitimation à la fois à l’échec du mouvement et à leur propre privatisation commençante tout en gardant une « sensibilité radicale », le nihilisme des idéologues, lesquels s’étaient en même temps arrangés pour sauter sur le train d’une vague « subversion », convenait admirablement. »22
C. Castoriadis constate :
« En un sens Mai 68 n’est sorti du stade de la fête révolutionnaire que pour entrer dans la décomposition. Cette constatation conduit à l’interrogation, la plus grave de toutes aujourd’hui, sur le désir et la capacité des hommes de prendre en main leur propre existence sociale. »23
Il note :
« En cela aussi, le capitalisme est une nouveauté anthropologique absolue, la culture établie s’effondre de l’intérieur sans que l’on puisse dire, à l’échelle macro-sociologique, qu’une autre, nouvelle, est déjà préparée « dans les flancs de l’ancienne société ». » 24
C. Castoriadis dresse ainsi un bilan calamiteux de ces courants subversifs depuis un demi-siècle, bilan aussi inaudible aujourd’hui que celui du soutien de l’URSS ou de la Chine maoïste pour les générations précédentes :
« Les grands mouvements qui ont secoué depuis vingt ans les sociétés occidentales – jeunes, femmes, minorités ethniques et culturelles, écologistes – ont certes eu (et conservent potentiellement) une importance considérable à tous points de vue, et il serait léger de croire que leur rôle est terminé. Mais actuellement, leur reflux les laisse en l’état de groupes non seulement minoritaires, mais fragmentés et sectorisés, incapables d’articuler leurs visées et leurs moyens en termes universels à la fois objectivement pertinents et mobilisateurs. Ces mouvements ont ébranlé le monde occidental, ils l’ont même changé – mais ils l’ont en même temps rendu moins viable encore. Phénomène frappant mais qui, finalement, n’est pas surprenant : car, s’ils ont pu fortement contester le désordre établi, ils n’ont ni pu ni voulu assumer un projet politique positif. Le résultat net provisoire qui a suivi leur reflux a été la dislocation accentuée des régimes sociaux, sans apparition de nouveaux objectifs d’ensemble ou de supports pour de tels objectifs. […] La société « politique » actuelle est de plus en plus morcelée, dominée par des lobbies de toute sorte, qui créent un blocage général du système. Chacun de ces lobbies est en effet capable d’entraver efficacement toute politique contraire à ses intérêts réels ou imaginaires ; aucun d’entre eux n’a de politique générale ; et, même s’ils en avaient une, ils ne posséderaient pas la capacité de l’imposer. »25
Conséquence :
« Jusqu’au début des années 70, et malgré l’usure manifeste des valeurs, cette société soutenait encore des représentations de l’avenir, des intentions, des projets. Peu importe le contenu, et que pour les uns cela ait été la révolution, le grand soir, pour les autres le progrès au sens capitaliste, l’élévation du niveau de vie, etc. Il y avait, en tout cas, des images apparaissant comme crédibles, auxquelles les gens adhéraient. Ces images se vidaient de l’intérieur depuis des décennies, mais les gens ne le voyaient pas. Presque d’un coup, on a découvert que c’était du papier peint – et l’instant d’après même ce papier peint s’est déchiré. La société s’est découverte sans représentation de son avenir, et sans projet – et cela aussi c’est une nouveauté historique. » 26
C. Castoriadis avait noté, dès 1959, que la contestation de la société pouvait être congruente avec un retrait dans la vie privée, qu’il appelle la « privatisation des individus », débouchant sur un désinvestissement de la vie politique elle-même : « [la privatisation] est d’une certaine façon le rejet en bloc de la société actuelle. »27. Il en reprend le constat vingt ans plus tard :
« La désintégration des rôles traditionnels exprime la poussée des individus vers l’autonomie et contient les germes d’une émancipation. Mais j’ai noté depuis longtemps l’ambiguïté de ses effets. Plus le temps passe, plus on est en droit de se demander si ce processus se traduit davantage par l’éclosion de nouveaux modes de vie que par la désorientation et l’anomie. »28
Les racines historiques de cette décomposition sociale, C. Castoriadis les explicitera dans de multiples textes29, les rattachant à des processus civilisationnels de long terme, mais au fond sans « explication » rationnelle univoque et dernière, conformément à sa philosophie de la création et de l’imaginaire, fondamentalement anti-déterministe. Mais les errements de la « gauche », dans ce contexte de délitement généralisé, ne sont pas qu’une de ses conséquences : ils en sont une des causes premières ou plutôt, afin d’être plus fidèle à sa pensée, un des principaux produits / producteurs, éléments auto-catalyseurs.
Ce regard acéré permet à C. Castoriadis d’anticiper : l’analyse de l’échec des mouvements contestataires des années 1960-70 et la rationalisation de cet échec par les idéologues du moment l’amènent à identifier une forme de contestation anomique qui se cristallisera au cours des années 2010, pour prendre finalement la forme du « wokisme » contemporain30.
II – Une anticipation du wokisme
C’est, par exemple, le cas des mouvements des femmes. C. Castoriadis, incontestablement favorable aux mouvements féministes pluriséculaires, anticipe en 1976 sans difficulté ce qui se donne aujourd’hui pour tel :
« Nous sommes en train de voir et de vivre là quelque chose qui dépasse même de loin la crise de la société capitaliste puisque ce qui est virtuellement détruit, c’est quelque chose – la définition de la « condition féminine », peut-être l’idée même d’une « condition féminine » – qui est antérieur à la constitution des sociétés dites « historiques ». […] Or, moyennant aussi le mouvement des femmes, nous assistons actuellement à une décomposition croissante de cette forme réglée, qui va de pair d’ailleurs avec la disparition de toute une série d’autres repères et pôles de référence des individus des groupes, de la société, relatifs à leur vie. On peut en dire autant des mouvements des jeunes, et même de l’évolution des enfants. »31
En 1993, le constat d’une « confusion des genres » – aujourd’hui à son paroxysme – est approfondi :
« Que les citoyens soient sans boussole est certain, mais cela tient précisément à ce délabrement, à cette décomposition, à cette usure sans précédent des significations imaginaires sociales. On peut le constater encore sur d’autres exemples. Personne ne sait plus aujourd’hui ce que c’est que d’être un citoyen mais personne ne sait même plus ce que c’est qu’être un homme ou une femme. Les rôles sexuels sont dissous, on ne sait plus en quoi cela consiste. Autrefois, on le savait, aux différents niveaux de société, de catégorie, de groupe. Je ne dis pas que c’était bien, je me place à un point de vue descriptif et analytique. Par exemple, le fameux principe : « la place d’une femme est au foyer » (qui précède le nazisme de plusieurs millénaires) définissait un rôle pour la femme : critiquable, aliénant, inhumain, tout ce que l’on voudra – mais en tous cas une femme savait ce qu’elle avait à faire : être au foyer, tenir une maison. De même, l’homme savait qu’il avait à nourrir la famille, exercer l’autorité, etc. De même dans le jeu sexuel : on se moque en France (et je pense, à juste titre), du juridisme ridicule des Américains, avec les histoires de harcèlement sexuel (qui n’ont plus rien à voir avec les abus d’autorité, de position patronale, etc.), les réglementations détaillées publiées par les universités sur le consentement explicite exigé de la femme à chaque étape du processus, etc., mais qui ne voit l’insécurité psychique profonde, la perte des repères identificatoires sexuels que ce juridisme essaie pathétiquement de pallier ? Il en va de même dans les rapports parents-enfants : personne ne sait aujourd’hui ce que c’est que d’être une mère ou un père. »32
Et il ne serait pas difficile, non plus, de convoquer ici les propos de C. Castoriadis sur ce dernier point (« Il y a […] une usure de l’épreuve de réalité pour les enfants : rien de dur à quoi ils se cognent, il ne faut pas les priver, pas les frustrer, pas leur faire de la peine, il faut toujours les « comprendre »33) ou concernant les positions des écologistes (« [dont la] composante politique est inadéquate et insuffisante […] et tend à faire de ces mouvements des sortes de lobbies. Et quand il y a prise de conscience de la dimension politique, elle me semble insuffisante. »34), des néo-ruraux (« on assiste actuellement à un renouveau de la mythologie du bon sauvage, de retour à des états naturels, qui sont des comportements de fuite et d’impuissance »35), des pacifistes (« moi, petit Européen, je veux survivre – que les autres crèvent si ça les amuse »36) ou encore la création artistique (« la culture contemporaine est, en première approximation, nulle. »37).
C. Castoriadis s’indignait, il y a aujourd’hui presque cinquante ans, d’une même vacuité sur le terrain politico-intellectuel :
« Qu’est-ce qui se passe actuellement, quel est l’infâme salmigondis qui est à la mode à Paris depuis des années ? À tous les coins de rue, du Bois de Vincennes jusqu’au Bois de Boulogne, on fait de l’iconoclasme. Et évidemment, on fait de l’iconoclasme de l’iconoclasme précédent, et la surenchère de l’iconoclasme, etc. Le résultat final est la nullité, le vide total du « discours subversif » contemporain, devenu simple objet de consommation et par ailleurs forme parfaitement adéquate du conservatisme idéologique « de gauche ». »38
C’est peu de dire que le nec plus ultra de l’intelligentsia de l’époque le laisse de marbre :
« Le « discours dominant » d’un certain milieu « contestataire » aujourd’hui, cet horrible salmigondis qu’est le freudo-nietzschéo-marxisme, c’est rigoureusement le n’importe quoi. »39
Ce « n’importe quoi » (la formule est redondante), c’est l’interminable dégradation du marxisme et de ses courants attenant, son hybridation avec la désorientation globale, ce que l’on a nommé le post-modernisme qui débouche aujourd’hui sur l’appel des déconstructionnistes :
« Les « généalogies », les « archéologies » et les « déconstructions », si l’on s’en contente et si on les prend comme quelque chose d’absolu, restent quelque chose de superficiel et représentent en fait une fuite devant la question de la vérité – fuite caractéristique et typique de l’époque contemporaine. La question de la vérité exige que nous affrontions l’idée elle-même, que nous osions, le cas échéant, en affirmer l’erreur ou en circonscrire les limites – bref, que nous essayions de la mettre à sa place. »40
Très loin de ces considérations, la critique s’obstine à ne prendre pour objet que l’Occident, et lui seul :
« Je ne discuterai pas ici cette dernière conception, ressuscitée aujourd’hui par différents mouvements (féministe, noir, etc.) qui condamnent la totalité de l’héritage gréco-européen comme produit de « mâles blancs morts ». Je me demande pourquoi ne condamne-t-on pas, sur le même principe, l’héritage chinois, islamique ou aztèque, produits par des mâles morts, respectivement jaunes, blancs ou « rouges ». »41
Cette démission généralisée se retrouve logiquement à des niveaux bien plus profonds, provoquant un « effondrement de l’auto-représentation de la société », un vide identitaire dont la simple évocation de nos jours déclenche un orage d’anathèmes :
« la société présente ne se veut pas comme société, elle se subit elle-même. Et si elle ne se veut pas, c’est qu’elle ne se peut ni maintenir ou se forger une représentation d’elle-même qu’elle puisse affirmer et valoriser, ni engendrer un projet de transformation sociale auquel elle puisse adhérer et pour lequel elle veuille lutter. »42
C. Castoriadis constatera, des années plus tard et sans réellement de surprise, la persistance par défaut de la nation comme représentation collective :
« L’imaginaire national résiste d’autant plus que toutes les autres croyances s’effondrent. La nation est le dernier pôle d’identification. Encore paraît-il bien fragile. Au début des années 80, alors que la menace russe était encore présente, une majorité de Français pensait qu’il fallait négocier en cas d’invasion. Les « vrais » nationalistes assistent plus ou moins impuissants aux conséquences de la diffusion mondiale du capitalisme. D’abord, les centres de décision peuvent de moins en moins être nationaux. Ensuite, les cultures nationales se dissolvent dans une soupe mondiale, qui pour l’instant est atroce, mais qui pourrait et devrait être autre chose. Les identités nationales se diluent de plus en plus, sans que rien ne vienne les remplacer. Elles se survivent donc dans une affirmation crispée : « nous sommes des Français », « nous sommes des Allemands », etc. La nation est une forme qui en droit est historiquement dépassée, mais qui en fait ne l’est nullement. C’est une grande antinomie de l’époque. »43
Lire la seconde partie
Notes de la première partie