Le 25 mars 2019, à la Sorbonne, la troupe de théâtre antique Démodocos a été physiquement empêchée de représenter une pièce d’Eschyle, Les Suppliantes, au motif que des comédiens auraient porté des masques noirs. Cela s’inscrit dans une série d’actions de censure au nom d’un prétendu « antiracisme » qui organise et arbitre une inquiétante compétition victimaire dont le principe est la segmentation de l’humanité en « identités » intouchables. On ne s’étonnera pas que le théâtre, « lieu de la métamorphose et non pas des identités », soit éminemment visé. Sabine Prokhoris a publié ici même un article consacré à Kanata de Robert Lepage.
Mezetulle s’honore d’accueillir à présent, pour la première fois, un texte dramatique. Écrite par François Vaucluse, Arbitres de la Race est une brève, hilarante et grinçante comédie bouffe où les personnages s’avancent démasqués. Dans le Nota bene qui suit la distribution, l’auteur précise que bien des passages sont empruntés à des propos « publics et authentiques, orthographe comprise » ; s’il n’avait pris soin de les placer entre guillemets, il pourrait être taxé d’outrance et d’invraisemblance !
François Vaucluse
Arbitres de la Race
Comédie bouffe en un prologue, trois scènes et un épilogue
Argument
Le 25 mars 2019, à la Sorbonne, les comédiens de la troupe Démodocos ont été physiquement empêchés de représenter une pièce d’Eschyle, Les Suppliantes, au motif que des comédiens auraient porté des masques noirs. Un communiqué d’étudiants daté du 28 mars a remercié les auteurs de ces voies de fait et ceux qui ont « soutenu notre mobilisation », en mentionnant la Brigade anti-négrophobie, l’association les groupes « La BAFFE, RAFFAL, maisnoncestpasraciste, le CRAN » ; la section locale de l’UNEF a renchéri. La Brigade anti-négrophobie a également soutenu, sinon revendiqué, ainsi que la Ligue de Défense des Noirs Africains : « Victoire on a obtenu l’annulation de la pièce de théâtre à La Sorbonne qui voulait utiliser du Blackface ! »
Début mars, peu après l’ouverture de l’exposition Toutânkhamon à la Grande halle de la Villette, la Ligue de défense des noirs africains manifestait à plusieurs reprises pour en interdire l’accès et dénoncer « la falsification & le blanchissement de l’histoire Africaine ».
Enfin, dès le 4 avril, dans une tribune largement diffusée, deux universitaires, Mame-Fatou Niang et Julien Suaudeau avaient demandé qu’un tableau de Hervé Di Rosa, commémorant la libération de l’esclavage, et qu’ils jugeaient raciste, soit retiré de l’Assemblée nationale.
En moins d’un mois, largement soutenues sinon inspirées par les milieux indigénistes et décoloniaux, ces trois actions médiatiques concomitantes se sont accompagnées de campagnes diffamatoires et de diverses menaces sur les réseaux sociaux. Ciblant des institutions symboliques, la Sorbonne, le Musée de la Villette, l’Assemblée nationale, elles concourent à accréditer la thèse d’un racisme d’État.
Sous protection policière et sur invitations, une unique représentation des Suppliantes s’est tenue enfin le 21 mai à la Sorbonne.
Distribution de la première
- La ligue ADN : Ligue de Défense des Noirs Africains.
- J’ai-du-cran : Conseil Représentatif des Associations Noires (CRAN).
- L’arbitre fascinant : Éric Fassin, professeur de sociologie.
- La fille en trans·e : La porte-parole LGBT de l’UNEF.
- L’Ombre de la Sulamite : Naomi Campbell.
- L’Ombre de Darius : Jafar Panahi.
- L’Ombre d’Eschyle : Démosthène Agraphiotis.
- Brunet-latin-grec : Philippe Brunet, alias Brunetto Latini.
- Les 343 racisé·e·s : Mediapart.
- Le Grand Ancien : Kémi Séba (inspirateur de la Brigade Antinégrophobie et de la LDNA, alliées du CRAN).
- Le thiase des sycophantes : LeGnoo (pseudonyme collectif).
- Luneffe : La porte-parole LGBT de l’Union des étudiants de France (UNEF).
- Le diable blanc (cornes carmin, masque de céruse) : [nom de l’auteur].
- Le kebab.
- Les z-« étudiant·e·s de la Sorbonne ».
- Un Péruvien masqué.
- L’ombre de Toutânkhamon.
- Les fantômes de l’Opéra.
- Le récitant.
- La récitante.
N.B. : Tous les passages entre guillemets sont publics et authentiques, orthographe comprise.
Prologue, devant le rideau
Luneffe : « Communiqué de presse concernant la pièce de théâtre « Les Suppliantes », possiblement représentée à La Sorbonne lundi, qui a fait usage du blackface, un choix de mise en scène raciste sur lequel nous interpelons. »
Brunet-latin-grec : Dans Les Suppliantes, « il est question d’immigrés d’abord mal accueillis par un roi autochtone. Puis qui tentent d’imposer leurs lois à leur terre d’accueil. Cette pièce parle aussi de femmes qui ne veulent pas se faire dicter leurs comportements par des hommes et qui sont d’ailleurs prêtes à recourir à la violence pour s’en affranchir. Ces thèmes mériteraient de nourrir le débat. Nous devons nous emparer de ces sujets si nous ne voulons pas que la société se défasse ».
Les z-« étudiant·e·s de la Sorbonne » : « Nous affirmons avec force et fermeté que ces événements constituent une double injure. Il s’agit d’une injure aux valeurs fondatrices de Sorbonne Université, qui s’affirme depuis sa création comme le fer de lance de l’innovation, de la recherche et de la création dans les Arts, en France comme en Europe ; mais aussi une insulte au rôle de Sorbonne Université dans la société ».
Le diable blanc : Ces « événements » ?
Ces voies de fait où J’ai-du-cran voit sa « victoire » ?
Les z- « étudiant·e·s de la Sorbonne » : « Les choix scéniques de M. Brunet portent atteinte aux valeurs de l’institution. […] La Sorbonne, la troupe Démodocos et M. Brunet ont eu un an pour s’interroger sur la pertinence de la mise en scène des Suppliantes. Une année sacrifiée et gâchée par un aveuglement sourd, cette situation en est une conséquence logique. Tant qu’il n’y aura pas remise en question, nous, Étudiantes et Étudiants de Sorbonne Université, refusons toute représentation de la pièce. »
Le diable blanc : J’entends cet aveuglement, bien qu’il soit sourd.
L’Ombre d’Eschyle : « Notre cité n’apprécie pas les longs discours ».
Les 343 racisé·e·s : « Des militant·e·s antiracistes ont empêché la représentation du spectacle des Suppliantes mis en scène par Philippe Brunet. Spectacle dans lequel les comédiennes à la peau blanche interprétant les Danaïdes étaient grimées en noir et portaient des masques cuivrés ».
Le diable blanc : Bigre, blanches noircies, portant « masques cuivrés » :
ces trois couleurs décèlent des chattes diaboliques ;
par bonheur, grâce à vous nul n’a vu ces horreurs.
Les 343 racisé·e·s : « Nous affirmons notre liberté et notre indépendance de pensée et de création, et déclarons par la présente la mort de votre monde raciste et colonialiste. Cher·es signataires de la tribune “Pour Eschyle”, bonjour à tous·tes. Dans votre monde en décrépitude, nous n’existerions pas : il faudrait alors nous singer, nous grimer, nous imiter ? »
Le diable blanc : Vous n’existeriez pas, pourtant je vous imite ?
Sacrebleu, me voici au royaume des ombres.
Scène 1. À l’Université de Saint-Denis
L’arbitre fascinant (docte et portant beau dans sa toge noire) : « Le sexe est une catégorie du savoir (et non de la réalité elle-même). D’ailleurs, inscrit dans l’état civil, n’est-il pas institué par l’État ? ».
Le diable blanc : L’État, bien que civil,
m’a donc fait naître à la date qu’il veut.
Donc la vie et la mort, catégories du savoir, sont instituées par l’État.
Car son Reich éternel a droit de vie et mort ?
L’arbitre fascinant : « Celui-ci a le pouvoir de le redéfinir en reconnaissant d’un côté la possibilité du changement de sexe, de l’autre l’existence de personnes intersexuées, soit deux manières de remettre en cause l’évidence d’un ordre binaire réputé ’’naturel’’ ».
Le diable blanc : L’État se contredit ou a-t-il l’esprit large ?
Voulez-vous à sa place
pouvoir arbitrer les sexes et les races ?
L’arbitre fascinant : « Dans le champ scientifique, le sexe peut désormais être appréhendé comme une construction – non seulement sociale mais aussi politique ».
Le diable blanc : Idole du forum, reine du trot aux courses,
est bien une pouliche,
et l’on parie sur elle, non sur lui.
Ou la biologie n’est-elle plus une science ?
Regrettons le bon temps de l’amibe asexuée,
Pullulons désormais par scissiparité.
L’Ombre de la Sulamite : « Nigra sum ».
L’arbitre fascinant : « Dire de personnes qu’elles sont « blanches » (ou « non-blanches »), ce n’est donc nullement revenir à la race biologique. Au contraire, c’est les caractériser, non par leur couleur de peau, mais par leur position sociale. Ainsi, quand on étudie la « blanchité », l’abstraction du concept protège d’une vision substantialiste (« les Blancs ») ».
Le diable blanc : Ouf, je suis un concept et point une substance.
Et concept dominant !
Mobutu, Mugabe, vous étiez donc des Blancs ?
Le Grand Ancien : « L’homme blanc est le diable » ; Susan Sontag l’a dit :
« La race blanche est le cancer de l’espèce humaine ».
Luneffe : « On ne peut pas parler de racisme envers les personnes blanches ». « Les dominé·e·s étant assimilé·e au personne non blanches et les dominant·e·s aux personnes blanche ».
Le diable blanc : Je vous sens quelque peu
fâché·e·s avec le nombre, sinon avec le genre.
L’orthographe est sans doute un complot dominant,
solécismes en renfort, décolonisons-la !
Le Grand Ancien : Jacques Derrida n’a-t-il pas dénoncé « la colonialité essentielle de la culture » ?
Le thiase des sycophantes : « Face à la suprématie blanche, voilà ce qu’on propose » :
J’ai-du-cran : Pour sauver notre race, détruisons la pensée.
L’inculture abattra l’impérialisme blanc.
Le thiase des sycophantes : « Les fondations de l’Opéra de Bordeaux sont celles des bateaux des traites négrières […]. C’est de pareilles présences du passé que vient PAR ESSENCE le patrimoine occidental dont presque tous les Occidentaux se glorifient çà et là » .
L’arbitre fascinant : « Le discours actuel des sciences sociales, internationales davantage que françaises d’ailleurs, plutôt que d’opposer le sexe à la race comme le vrai au faux, les rapproche dans une même logique de construction sociale ».
Le diable blanc : Vrai sexe et fausse race ? Passons un compromis :
J’invente donc le sexe et vous créez la race.
Que vous semble à présent cette co-construction ?
L’arbitre fascinant : « L’approche critique de la race, qui caractérise aujourd’hui ce champ d’études au sein des sciences sociales, est ainsi la figure inversée du racisme scientifique. C’est d’ailleurs pourquoi elle connaît un écho important dans les milieux militants d’un antiracisme qui se revendique ’’politique’’ ».
Le diable blanc : La « figure inversée » est celle de Narcisse :
Identité chéri·e, qui « connaît un·e Écho ».
Foin du racisme scientifique, le voici politique.
Hitler disait des Juifs qu’ils sont « race mentale ».
Ma race est donc mentale, suis-je alors condamné ?
Le Grand Ancien : « Je rêve de voir les Blancs, les Arabes et les Asiatiques s’organiser pour défendre leur identité propre. Nous combattons tous ces macaques qui trahissent leurs origines, de Stéphane Pocrain à Christiane Taubira en passant par Mouloud Aounit. […] Les nationalistes sont les seuls Blancs que j’aime. Ils ne veulent pas de nous et nous ne voulons pas d’eux. […] Parce qu’il y aurait eu la Shoah, je n’ai rien le droit de dire sur mon oppresseur sioniste ? ».
J’ai-du-cran : « Philippe Brunet, descendant de samouraï japonais dans la mise en scène de cette présentation, est la transfiguration de l’Antillais tel que décrit par Frantz Fanon : ’’L’Antillais se caractérise par son désir de dominer l’autre’’ ».
Brunet-latin-grec : Vous m’aviez blanchisé, me voici Antillais ?
Magies du métissage !
Scène 2. Place de la Sorbonne
Le diable blanc (essoufflé) : Dernière nouvelle, Martin Sellner, chef des identitaires autrichiens, a voulu empêcher qu’on représente une pièce de Jelinek au Burgtheater.
J’ai-du-cran : Il défendait son identité blanche contre une juive nobélisée et antinazie.
Et nous, notre identité noire contre Eschyle. Chacun son bonhomm·e !
Le diable blanc : Mais Jelinek mettait en scène des demandeurs d’asile, tout comme les Danaïdes suppliantes !
Et Sellner est l’ami de Tarrant, le tueur de Christchurch, correspondant fidèle et qui l’a financé.
J’ai-du-cran : Tarrant se défendait contre les racisé·e·s musulman·e·s.
Le diable blanc : Moi, comment me défendre ?
Suis-je diable, contre les anges ?
Ou blanc, contre juifs et muslims ?
Les 343 racisé·e·s : Diable intersectionnel, défends-toi contre tous.
Le diable blanc (racinien) : Mais un Blanc est coupable et ne peut se défendre.
Que ne suis-je, mon Diable, une diablesse trans ?
À défaut genderfluid, queer, bigenr.e, asexuel.le ?
(À part, en bafouillant) : La peste soit ce rôle écrit en inclusif·ve,
Je me perds, à vrai dire, dans ces sexes des anges,
Quarterons bi·s, mulâtre·esse·s genré·e·s.
Mon binarisme impur me condamne à jamais.
Je ne connais qu’un genre, et c’est le genre humain.
Le thiase des sycophantes : « Il y a aussi un effacement des genres et des positions sociales, une femme n’est socialement pas un homme, une domestique n’est pas une danseuse, un soldat n’est pas une nourrice, une travailleuse du sexe n’est pas une acrobate ».
La fille en trans·e : « En tant que femme transgenre racisée, je suis intersectionnelle. Mais ma racisation fait de moi une personne plus privilégiée qu’une personne afro-descendante et c’est à cause du colorisme qui crée un privilège entre les personnes racisées ».
L’Ombre de la Sulamite : Qu’est-ce que le colorisme ?
La fille en trans·e : Tous ces grands blacks me snobent,
pourtant je suis lesbienne. Et mexicaine, en plus !
Le diable blanc : Certes au nom fort latin.
La fille en trans·e : Et pourtant Guevara…
J’ai-du-cran : Qu’il reste sur son mur avec son béret basque,
et donc blanc.
Les Danaïdes sont filles de l’Égypte, et donc noires.
L’Ombre de la Sulamite : Comme elles, « je suis noire et belle ».
J’ai-du-cran : Et tu fricotes avec un Salomon ?
Filles de Danaos, vous devez être noires !
Refusez le blackface !
(D’un ton sentencieux) : Timéo Danaos et dona ferentes.
L’Ombre de la Sulamite : Mais qu’est-ce que le blackface ?
Le diable blanc (à part) : Des comédiens grimés, cela vient d’Amérique.
J’ai-du-cran (qui a entendu) : Nous nous l’approprions ! C’est dans notre culture.
Le diable blanc : Mais l’Othello de Welles ?
J’ai-du-cran : Nous abhorrons ce Blanc
né dans le Wisconsin et mort à Hollywood :
que cet illusionniste, élève d’Houdini,
cède à Sidney Poitier une tombe usurpée !
L’Ombre de Darius : J’étais l’empereur perse ;
il fallait bien qu’un vivant me secoure,
car seul un acteur vif sait incarner une ombre.
L’Ombre d’Eschyle : Tu dis bien, Darius. Mais les ombres n’ont pas
de chair, et le poète les rend visibles à tous.
Les fantômes de l’Opéra : Nous refusons bien haut qu’on s’approprie nos spectres !
Nos syndicats sont là pour vous en dissuader.
Le thiase des sycophantes (ils sortent à l’aveuglette) :
Pour jouer Œdipe roi,
On cherche parricides
(grecs bien évidemment) ;
il faut qu’ils soient aveugles
ou du moins non-voyants.
Le diable blanc (à part) :
Puisqu’on choisit son genre, on peut choisir sa race
Alors c’est décidé, ma transition commence !
Mais puis-je me noircir sans risquer le blackface ?
Hélas un dominant à jamais le demeure,
Je reste condamné par ma propre blancheur.
(il reste pensif un moment) :
Les nouveaux-nés sont-ils de futurs dominants ?
Le rappeur Nick Conrad a chanté la réponse (il allume un ghetto blaster, à tue-tête) :
« Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs,
attrapez-les vite et pendez leurs parents,
écartelez-les pour passer le temps,
divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands.
Fouettez-les fort faites-le franchement,
que ça pue la mort que ça pisse le sang ».
Le thiase des sycophantes (revenu sur scène, en chœur, sur les premières notes de la Cinquième de Beethoven) :
Pas d’amalgame ! Pas d’amalgame ! Pas d’amalgame !
C’est au second degré ! C’est au troisième degré !
Nick l’a bien dit sur RTL : « Je ne cherchais pas le buzz, ce clip est supposé amener à réfléchir et pas rester en surface. Je ne comprends pas les gens qui ne vont pas chercher en profondeur ».
Compris, diable herméneute au sabot fourchu ? Littéraliste obtus !
Le diable blanc : Deux questions me tracassent. Les Juifs sont-ils des Blancs ?
Comme Hérode faut-il tuer les innocents ?
Le thiase : Le privilège blanc doit s’expier au plus tôt !
« Le pire, c’est mon regard, lorsque dans la rue je croise un enfant portant une kippa. »
« Vous les Juifs […] je vous reconnaîtrais entre mille ».
L’Ombre de la Sulamite (visiblement dépassée) :
Reine du Cantique des cantiques,
Je suis belle, je suis noire et je suis presque juive,
Bref intersectionnelle, et mes gens d’Éthiopie
Suivent les lois de Moïse.
(Soudain prise d’un doute) :
Qu’appelez-vous le rap ? La harpe de David ?
(Le thiase s’esclaffe pendant que le rideau tombe).
Scène 3. Pendant ce temps, au snack de la Villette
Un Péruvien masqué : Vous mangez donc des frites ?
Louche appropriation : la patate est notre œuvre.
Vous l’avez extorquée pour pallier vos famines,
et McDo à présent nous revend des french fries.
Le diable blanc : La sauce des pizzas, c’est le sang des Incas ?
La tomate est andine et le cheval mongol,
la poule indochinoise et le vin géorgien…
Le kebab : Mais moi, je suis partout, gyro grec, shawarma arabe, al pastor espagnol.
Dönerwetter ! Suis-je donc ottoman ?
L’ombre de Toutânkhamon : Ôtez-moi d’un grand doute,
les quatre boomerangs retrouvés dans ma tombe,
à qui faut-il que je les rende ?
La Ligue ADN : Tu es des nôtres, pharaon noir.
Nous avons inventé le boomerang et les
Aborigènes viennent d’Afrique, à pied sec.
Les archéologues ont voulu te blanchir,
reviens pour les hanter !
Le diable blanc : Mais moi aussi, je viens d’Afrique !
C’était Lucy, ma grand-mémé,
comme celle de Yoyotte, l’antillais.
La Ligue ADN : « Europeans & family, votre génome est criminel, hypocrite, menteur ».
Le diable blanc : Le racisme nous tue, et non pas le génome.
Vous parlez donc anglais ?
C’est dans votre ADN ou dans mon DNA ?
La ligue ADN : Les Égyptiens sont noirs, donc nous les défendons.
Le diable blanc : Quand la statue du Pharaon est sombre, c’est la couleur du limon fertile qu’il fait abonder.
La ligue ADN : Faux, car l’on a brisé son nez bien négroïde.
Le diable blanc : Halte aux stéréotypes,
les nilotiques l’avaient grec,
et Leni Riefenstahl en atteste.
La victoire de Samothrace a bien perdu son nez
et comme vous la tête. D’ailleurs, Cheikh Anta Diop
a fait analyser une momie entière,
l’ADN a parlé, il est intarissable.
(à la cantonade) Mais chut ! Ces gens étaient berbères.
La ligue ADN (qui a entendu) : Mensonge d’Africains hâtivement blanchis !
Ce Brunet-latin-grec est un « sionniste » (sic) honteux !
Qu’il finisse en Enfer, Madame Belloubet !
Brunet-latin-grec : Hélas, j’y suis déjà, Dante m’y avait mis.
La ligue ADN : « Seule la Justice, bonne et bienveillante envers les vraies victimes des délinquants ethnohiérarchistes mettra fin à ce malaise sociétal qui se focalise sur le débat autour des choix d’une mise en scène d’une pièce d’Eschyle à la Sorbonne ».
Le diable blanc : Eschyle, délinquant ethnohiérarchiste ?
Tout s’éclaire, à présent. Il est vrai que les Grecs
Avaient colonisé Marseille et Syracuse,
inventé les barbares et la démagogie.
Ils ne blanchiront pas l’Égypte et la Sorbonne…
L’ombre d’Eschyle : « Je vois partout des problèmes désarmants ; tel un fleuve, une masse de malheurs s’abat sur moi ; je suis embarqué sur des abysses d’égarements, sur d’infranchissables flots sans havre pour les malheurs ».
La ligue ADN : « La #guerreÉgalitariste nous l’avons déjà gagnée par disruptivité de nos concepts et de nos idées ».
Le thiase des sycophantes : « Mais le problème du fascisme démocratique n’est pas l’extrême droite, c’est le système représentatif anthropocentrique, patriarco-colonial selon lequel le consensus social est obtenu par un pacte de libre communication entre individus humains égaux — définis par avance en termes de citoyenneté bourgeoise, neurodominante, hétéropatriarcale et blanche ».
Les 343 racisé·e·s : « Aujourd’hui, nous sommes outré.e.s, mais surtout fatigué.e.s. Nous n’avons pas l’énergie de vous rappeler que la censure est un outil d’État, et non pas le fait de quelques militant.e.s usant de leur droit à la protestation et à l’insurrection face à des représentations négrophobes et racistes. ».
Le diable blanc : Prenez quelque repos avant l’insurrection.
Les 343 racisé·e·s : « Nos identités sont des cloîtres ».
Le diable blanc : Vous vous êtes reclus·e·s,
Méditez-donc dans leur silence.
Le rideau tombe.
Épilogue. L’humanité retrouvée
Préambule dit le 15 mai 2019, lors de la première représentation à la Sorbonne,
par Philippe Brunet, metteur en scène des Suppliantes, et Dido Lykoudis, comédienne.
La récitante :
Je suis Philippe Brunet. Helléniste, né français d’une mère nippone.
Le récitant :
Je suis Dido Lykoudis, comédienne, j’ai deux mères, la Grèce et l’Éthiopie. Je viens apporter le soutien de l’amitié à Eschyle.
La récitante :
Le grec ancien est la source à laquelle j’ai voulu boire, comme les japonais boivent à la source du bouddhisme et de Dionysos.
Le récitant :
L’Amharic est la langue qu’on entend quand je parle le grec d’Eschyle, je me suis abreuvée aux sources du Nil, là où poussent les flûtes de l’Abyssinie ; un jour, j’ai fui jusqu’aux rives de France.
La récitante :
Dans la langue française, j’ai entendu les pas des poètes qui scandaient jadis en latin, en grec ancien : je les entends qui cheminent encore sur les passerelles de soie que tissent les caravanes entre l’Europe et l’Asie.
Le récitant :
J’ai fui l’Éthiopie parce que le corps devenait tabou, parce que je ne voulais pas transformer ma culture en folklore, parce que mes cousins les Égyptiades voulaient m’enfermer, j’avais 20 ans, j’ai erré, aujourd’hui mon visage d’Iô a l’âge de mon errance…
La récitante :
Je ne bougerai plus de ce sol, j’ai mille visages, noirs, blancs, rouges, mille coiffes, mille porte-voix grimaçants, mille pieds qui arpentent pour moi les pontons du théâtre.
Le récitant :
Je me ressouviens exactement du moment où j’ai posé mes pas d’étrangère sur cette terre d’asile, étrangère parce que noire, barbare parce que grecque.
La récitante :
Je suis nègre de toutes les souffrances et de toutes les beautés de la négritude, barbare parlant grec devant l’assemblée incrédule des enfants de Platon et d’Érasme,
Le récitant :
Je suis libre, mes tresses d’abyssinienne répondent au sourire des statues archaïques de l’Acropole, si colorées que Charles Maurras les traitait de chinoises, je suis donc chinoise aussi,
La récitante :
Insulté, menacé, je tresse des strophes pour vous saluer et vous implorer la bienvenue, et d’avance, Mme la Ministre, M. le Ministre, M. le Recteur, M. le président de Sorbonne Université, MM. les professeurs d’Université, etc., chère Ariane, cher André, Mmes et MM. les professeurs, les journalistes, les comédiens, les saltimbanques, les étudiants, les élèves, de toutes couleurs, et par delà les murs de cette salle prestigieuse, tous les Noirs, et tous les autres, vous tous, les Argiens réunis en assemblée, ce soir vous adresser tous mes remerciements…
Le récitant :
Mes yeux, agrandis par le maquillage, tentent d’échapper aux cent yeux du chien mauvais qui me surveille et me traque.
La récitante : Je suis le masque.
Le récitant : Je suis la Suppliante.
Notes
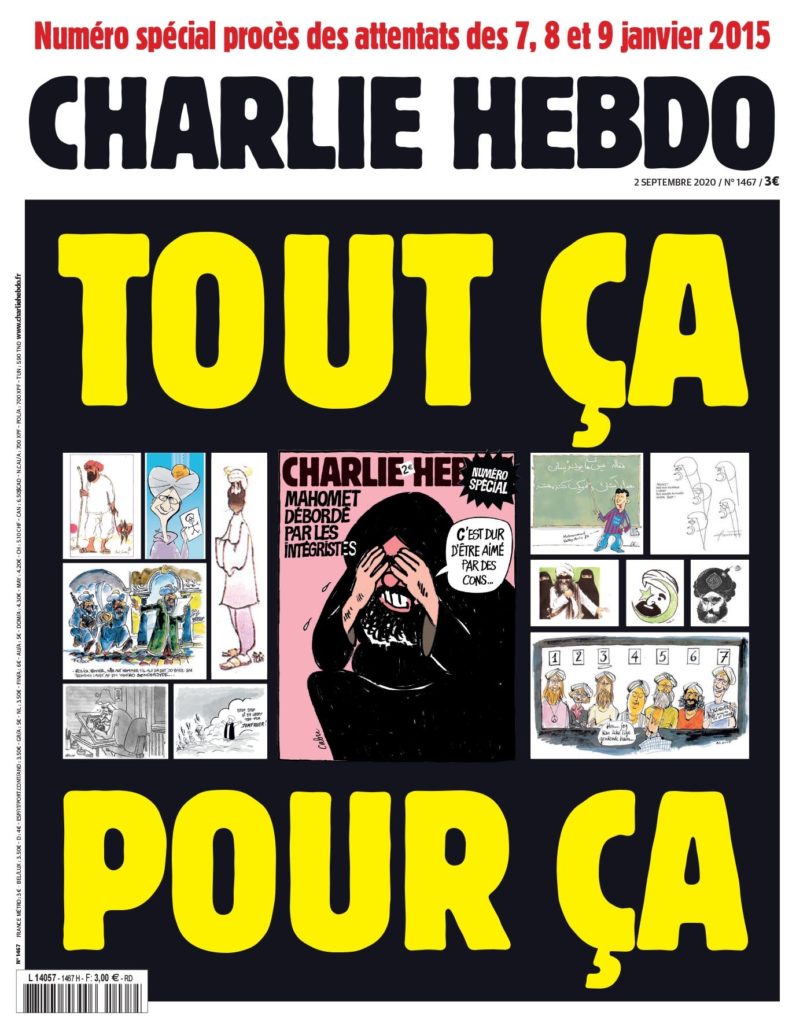
.gif)